Face à la déferlante des IA créatives et génératives, le droit d’auteurs est quelque peu déstabilisé sur ses bases traditionnelles. La qualification d’« œuvre de l’esprit » bute sur ces robots déshumanisés. Le code de la propriété intellectuelle risque d’en perdre son latin, sauf à le réécrire.
Par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par les entreprises, notamment en communication, est de plus en plus répandue. Des logiciels tels que Stable Diffusion, Midjourney, Craiyon, ou encore Dall·E 2 permettent de créer des images à partir d’instructions en langage naturel (le « text-to-image »). Il est également possible de créer du texte avec des outils tels que le robot conversationnel ChatGPT lancé en novembre 2022 par OpenAI (
1), voire de la musique avec Flow Machines de Sony (
2).
Flou artistique sur le droit d’auteur
Les usages sont assez variés : illustration d’un journal, création d’une marque, textes pour un site Internet, un support publicitaire ou pour un post sur les réseaux sociaux, création musicale, publication d’une œuvre littéraire complexe, …, et bientôt produire des films. Les artistes s’en sont emparés pour développer une forme d’art appelé « art IA », « prompt art » ou encore « GANisme » (
3). Et, parfois, les artistes transforment les résultats obtenus en NFT (
4), ces jetons non-fongibles authentifiant sur une blockchain (chaîne de blocs) un actif numérique unique. Pour produire un texte, une image ou une musique sur commande, le logiciel a besoin d’être nourri en textes, images ou musiques préexistantes et en métadonnées sur ces contenus (« deep learning »). Plus le logiciel dispose d’informations fiables, plus le résultat sera probant. Comme toute nouveauté technologique, l’utilisation de ces logiciels soulève de nombreuses questions juridiques. La question centrale en matière de propriété intellectuelle est de savoir à qui appartiennent les droits – s’ils existent – sur les contenus générés par l’IA ?
En droit français, une œuvre est protégeable si elle est originale. L’originalité est définie comme révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qui ne peut être qu’un être humain. Il faut donc déterminer qui est l’auteur, ou qui sont les auteurs d’une image, d’un texte ou d’une musique créés via une instruction donnée à un logiciel. Il faut aussi déterminer qui peut en être titulaire des droits. Il pourrait s’agir des auteurs des œuvres préexistantes, de nous-mêmes lorsque nous avons donné une instruction au logiciel, ou encore de l’auteur du logiciel (par exemple la société Stability AI qui développe Stable Diffusion). Les entités exploitant ces logiciels contribuent au processus permettant d’obtenir des textes, images ou des musiques inédites, dans la mesure où ce sont ces générateurs de contenus qui proposent un résultat comprenant un ensemble de choix plutôt qu’un autre. Ainsi, c’est la part d’« autonomie » des logiciels d’IA qui jette le trouble dans la conception traditionnelle du droit d’auteur. Un tribunal de Shenzhen (Chine) avait jugé en 2019 qu’un article financier écrit par Dreamwriter (IA mise au point par Tencent en 2015) avait été reproduit sans autorisation, reconnaissant ainsi que la création d’une IA pouvait bénéficier du droit d’auteur. Néanmoins, la contribution du logiciel se fait de manière automatisée et, à notre sens, l’usage technique d’un logiciel pour créer une image, un texte ou une musique ne donne pas au propriétaire du logiciel de droits sur l’image, sur le texte ou la musique : en l’absence d’une intervention humaine sur le choix des couleurs, des formes ou des sons, aucun droit d’auteur ou de coauteur ne peut être revendiqué au nom du logiciel. Le 21 février 2023, aux Etats-Unis, l’Office du Copyright a décidé que des images de bande dessinée créées par l’IA Midjourney ne pouvaient pas être protégées par le droit d’auteur (
5).
Les conditions d’utilisation de ces générateurs de textes, d’images ou de musiques peuvent le confirmer. Dans le cas de Dall·E 2, les « Terms of use » prévoient expressément que OpenAI transfère à l’utilisateur tous les droits sur les textes et les images obtenus, et demande même que le contenu ainsi généré soit attribué à la personne qui l’a « créé » ou à sa société. Stability AI octroie une licence de droits d’auteur perpétuelle, mondiale, non exclusive, gratuite, libre de redevances et irrévocable pour tous types d’usage de Stable Diffusion, y compris commercial. Mais en l’absence, selon nous, de tout droit transférable, ces dispositions semblent constituer de simples précautions.
Droits de la personne utilisant le logiciel
Il est donc essentiel, pour toute personne qui souhaite utiliser, à titre commercial ou non, les contenus créés via des outils d’IA, générative ou créative, de vérifier si la société exploitant le site en ligne où il les crée lui en donne les droits et à quelles conditions. Dès lors que l’apport créatif de la personne qui donne les instructions au générateur d’images, de textes ou de musique est limité à la production d’une idée mise en œuvre par le logiciel, et que les idées ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, il est douteux qu’un tribunal reconnaisse la qualité d’auteur à cette personne. Puisque l’utilisateur du logiciel ne conçoit pas mentalement, à l’avance, le contenu obtenu, il est difficile d’avancer que ce contenu porte « l’empreinte de sa personnalité ». Mais surtout, on pourrait aller jusqu’à dénier la qualification d’œuvre de l’esprit aux images, textes ou musiques créés par l’IA. En effet, le code de la propriété intellectuelle (CPI) n’accorde la protection du droit d’auteur qu’à des « œuvres de l’esprit » créées par des humains.
« Œuvre de l’esprit » inhérente à l’humain
Faute d’action positive créatrice de la part d’un humain, on pourrait avancer qu’aucun « esprit » n’est mobilisé, donc qu’aucune « œuvre de l’esprit »protégeable par le droit d’auteur n’est créée. S’ils ne sont pas des « œuvres de l’esprit », les contenus ainsi créés seraient alors des biens immatériels de droit commun. Ils sont appropriables non pas par le droit d’auteur (
6) mais par la possession (
7) ou par le contrat (conditions générales octroyant la propriété à l’utilisateur). Il s’agit alors de créations libres de droit, appartenant au domaine public. Cela fait écho à d’autres types d’« œuvres » sans auteur comme les peintures du chimpanzé Congo ou les célèbres selfies pris en 2008 par un singe macaque. Sur ce dernier exemple, les juridictions américaines avaient décidé que l’autoportrait réalisé par un singe n’était pas une œuvre protégeable puisqu’il n’a pas été créé par un humain, sujet de droits. En revanche, dès lors que le résultat obtenu est retravaillé et qu’un apport personnel formel transforme ce résultat, la qualification d’« œuvre de l’esprit » peut être retenue, mais uniquement en raison de la modification originale apportée au résultat produit par le logiciel. Ce cas de figure est d’ailleurs prévu dans la « Sharing & Publication Policy » de Dall·E 2 qui demande à ses utilisateurs modifiant les résultats obtenus de ne pas les présenter comme ayant été entièrement produits par le logiciel ou entièrement produits par un être humain, ce qui est davantage une règle éthique, de transparence, qu’une exigence juridique.
En droit français, une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante sans la participation de son auteur est dite « composite » (
8). Si les œuvres préexistantes sont dans le domaine public, leur libre utilisation est permise (sous réserve de l’éventuelle opposition du droit moral par les ayants droit). En revanche, incorporer sans autorisation une œuvre préexistante toujours protégée constitue un acte de contrefaçon. Si, par exemple, on donne l’instruction « Guernica de Picasso en couleurs », on obtiendra une image qui intègre et modifie une œuvre préexistante. Or les œuvres de Picasso ne sont pas dans le domaine public et les ayants droit doivent pouvoir autoriser ou interdire non seulement l’exploitation de l’image obtenue et en demander la destruction, mais peutêtre aussi interdire ou autoriser l’usage des œuvres de Picasso par le logiciel. La production et la publication par un utilisateur d’un « Guernica en couleurs » pourraient donc constituer une contrefaçon ; mais l’intégration de Guernica dans la base de données du logiciel (deep learning) pourrait à elle seule constituer également un acte contrefaisant (
9). En effet, le CPI sanctionne le fait « d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés » (
10). Le caractère « manifeste » de la mise à disposition, et la qualification de « mise à disposition » elle-même pourraient être discutés.
Mais c’est surtout la directive européenne « Copyright » de 2019 (
11) qui pourrait venir en aide aux exploitants d’IA génératrices de contenus en offrant une sécurisation de leur usage d’œuvres préexistantes protégées. Elle encadre l’exploitation à toutes fins, y compris commerciales, d’œuvres protégées pour en extraire des informations, notamment dans le cas des générateurs de textes, d’images ou de musiques. Elle prévoit également une possibilité pour les titulaires de droits sur ces œuvres d’en autoriser ou interdire l’usage, hors finalités académiques. Une telle autorisation peut difficilement être préalable et les exploitants, OpenAI par exemple, mettent donc en place des procédures de signalement de création de contenu contrefaisant (
12). Le site Haveibeentrained.com propose, quant à lui, de vérifier si une image a été fournie comme input à des générateurs d’images et de signaler son souhait de retirer l’œuvre de la base de données. Mais les artistes se plaignent déjà de la complexité qu’il y a à obtenir un tel retrait (
13).
On le voit, l’irruption des créations de l’IA perturbe le droit de la propriété intellectuelle, dont les outils actuels sont insuffisants pour répondre aux questionnements suscités. On peut imaginer que l’IA permettra un jour de produire de « fausses » sculptures de Camille Claudel, en s’adjoignant la technologie de l’impression 3D, ou encore de faire écrire à Rimbaud ou à Mozart des poèmes et des symphonies d’un niveau artistique équivalent – voire supérieur ! – qu’ils auraient pu écrire et jouer s’ils n’étaient pas morts si jeunes. La question de l’imitation du style d’auteurs encore vivant n’est d’ailleurs pas sans soulever d’autres débats.
Risque de déshumanisation de la création
Un avenir possible de l’art pourrait être dans la déshumanisation de la création, ce qui non seulement rendrait indispensable une refonte du premier livre du CPI, sous l’impulsion du règlement européen « AI Act » en discussion (
14), mais susciterait en outre des questionnements éthiques. Si le public prend autant de plaisir à lire un roman écrit par une machine ou à admirer une exposition d’œuvres picturales créées par un logiciel, voire à écouter une musique composée et jouée par l’IA, les professions artistiques survivront-elles à cette concurrence ?
@
 Le calme avant la tempête ? Le monde du cinéma n’échappera pas au tsunami de l’intelligence artificielle. Le Festival de Cannes, qui tient sa 78e édition sur la Croisette durant presque deux semaines (13-24 mai 2025), commence à prendre en compte les films réalisés en tout ou partie par des IA génératives. L’événement international du 7e Art, organisé chaque année par l’Association française du festival international du film (AFFIF), dont Thierry Frémaux (photo) est le délégué général depuis 18 ans, inclut la « Compétition immersive » pour la seconde année consécutive.
Le calme avant la tempête ? Le monde du cinéma n’échappera pas au tsunami de l’intelligence artificielle. Le Festival de Cannes, qui tient sa 78e édition sur la Croisette durant presque deux semaines (13-24 mai 2025), commence à prendre en compte les films réalisés en tout ou partie par des IA génératives. L’événement international du 7e Art, organisé chaque année par l’Association française du festival international du film (AFFIF), dont Thierry Frémaux (photo) est le délégué général depuis 18 ans, inclut la « Compétition immersive » pour la seconde année consécutive.
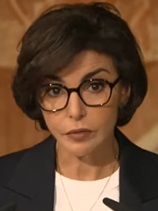
 L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par les entreprises, notamment en communication, est de plus en plus répandue. Des logiciels tels que Stable Diffusion, Midjourney, Craiyon, ou encore Dall·E 2 permettent de créer des images à partir d’instructions en langage naturel (le « text-to-image »). Il est également possible de créer du texte avec des outils tels que le robot conversationnel ChatGPT lancé en novembre 2022 par OpenAI (
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par les entreprises, notamment en communication, est de plus en plus répandue. Des logiciels tels que Stable Diffusion, Midjourney, Craiyon, ou encore Dall·E 2 permettent de créer des images à partir d’instructions en langage naturel (le « text-to-image »). Il est également possible de créer du texte avec des outils tels que le robot conversationnel ChatGPT lancé en novembre 2022 par OpenAI ( Si l’étude de l’Arcom sur la photographie en ligne – en deux parties, l’une sur le volet économique et l’autre sur les usages des internautes – fait grand cas de Google Images, qui est « de loin le moteur de recherche le plus utilisé pour la recherche d’images », aucune mention n’est cependant faite sur l’ancien projet de redevance sur les images indexées par les Google, Yahoo, Microsoft Bing ou autres Qwant. Cette taxe « Google Images » est bien prévue par la loi « Création » du 7 juillet 2016. Mais depuis six ans, elle n’a jamais vu le jour. A la lumière de l’étude de l’Arcom, le ministère de la Culture va-t-il finalement l’instaurer ?
Demander des comptes aux moteurs Pour mémoire, loi « Création » du 7 juillet 2016 prévoit en effet un « dispositif relatif aux services automatisés de référencement d’images », à la suite d’un amendement déposé par Jean-Pierre Leleux, alors sénateur, et adopté : « Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant d’assurer la rémunération des auteurs d’œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement s’approprient aujourd’hui sans autorisation et mettent à la disposition du public sur Internet », était-il justifié (
Si l’étude de l’Arcom sur la photographie en ligne – en deux parties, l’une sur le volet économique et l’autre sur les usages des internautes – fait grand cas de Google Images, qui est « de loin le moteur de recherche le plus utilisé pour la recherche d’images », aucune mention n’est cependant faite sur l’ancien projet de redevance sur les images indexées par les Google, Yahoo, Microsoft Bing ou autres Qwant. Cette taxe « Google Images » est bien prévue par la loi « Création » du 7 juillet 2016. Mais depuis six ans, elle n’a jamais vu le jour. A la lumière de l’étude de l’Arcom, le ministère de la Culture va-t-il finalement l’instaurer ?
Demander des comptes aux moteurs Pour mémoire, loi « Création » du 7 juillet 2016 prévoit en effet un « dispositif relatif aux services automatisés de référencement d’images », à la suite d’un amendement déposé par Jean-Pierre Leleux, alors sénateur, et adopté : « Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant d’assurer la rémunération des auteurs d’œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement s’approprient aujourd’hui sans autorisation et mettent à la disposition du public sur Internet », était-il justifié (