Le rapport du gouvernement au Parlement sur la rémunération pour la copie privée préconise d’« exclure explicitement » le « hors connexion » qui permet aux internautes d’écouter ou de visionner un contenu sans être en ligne. Alors que les ayants droit veulent taxer ces « copies de confort ».

Ce rapport du gouvernement au Parlement sur la rémunération pour copie privée, publié le 31 octobre dernier, a été réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), lesquelles dépendent respectivement de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, et de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Parmi les 22 propositions faites par le gouvernement, il y en a une qui concerne le sort des copies dites de confort permettant d’écouter du contenu hors connexion ou offline.
Commission copie privée : réunion en vue
Faut-il taxer ces copies pour rémunérer la copie privée, ce droit des internautes de reproduire une œuvre pour y avoir accès dans le cadre d’un cercle restreint familial ? La réponse du gouvernement est non. « Encourager la commission [pour la rémunération de la] copie privée à clarifier le statut des copies dites de confort permettant les écoutes hors connexion, et à suivre la proposition de la mission IGF-IGAC préparatoire au présent rapport de les exclure explicitement du champ de la rémunération pour copie privée », préconise le rapport dans sa proposition n° 11.
Cette commission pour la rémunération de la copie privée, présidée depuis un an par le conseiller d’Etat Thomas Andrieu (photo), est donc appelée à ne pas taxer le hors connexion. Et ce, contrairement à la demande des ayants droit des industries culturelles de taxer ces copies de confort, sous prétexte que cela génèrerait – selon eux – un manque à gagner devant être rémunéré. Contacté par
Edition Multimédi@, le président de cette commission dite « L311-5 » (
1) nous indique que « la commission (copie privée) se réunira avant la fin de l’année et les conclusions du rapport IGF-IGAC seront à l’ordre du jour ». Les ayants droit, qui bénéficient d’un avantage lors des votes face aux représentants des industriels et des consommateurs en raison de la répartition des sièges, ont fait savoir à la mission gouvernementale qu’une rémunération pour copie privée se justifiait pour le offline du streaming. Ce n’est pas l’avis du gouvernement : « La question du traitement des possibilités d’écoute hors connexion offertes par les plateformes de streaming a été soulevée auprès de la mission [IGF-IGAC], certains ayants droit considérant que ces “téléchargements” constituent des copies privées devant être compensées. A ce stade, ces téléchargements à partir de plateformes de streaming payantes sont mesurés par les études d’usages mais ne sont pas inclus dans le volume de copies privées. En l’absence d’une décision de justice tranchant ce point, un faisceau d’indices amène à considérer que ces copies de confort ne relèveraient pas du champ de la copie privée créant un préjudice et devant donner lieu à compensation », estime le rapport. Si ces téléchargements aboutissent bien à une copie du fichier musical ou vidéo sur le terminal de l’utilisateur (smartphone, ordinateurs, tablette, …), cette copie est exploitable uniquement sur la plateforme de streaming : elle ne peut être transférée ou dupliquée. A cela s’ajouter le fait que ces copies sont éphémères et attachées à l’abonnement de l’utilisateur au service de streaming en question. Ces copies de confort permettent des écoutes hors connexion qui ne sont possibles que pendant la durée de l’abonnement au service payant. C’est par exemple le cas pour Deezer qui propose cette facilité dans son abonnement payant premium, afin de permettre au bénéficiaire de télécharger des albums et des playlists pour les écouter hors connexion quand il n’a pas de connexion Wifi disponible ou de réseau accessible. « Les plateformes de streaming rencontrées par la mission ont assuré que la possibilité de visionnage ou d’écoute hors connexion était prévue dans les contrats de licence et donne lieu à rémunération, dans les mêmes conditions que les écoutes ou visionnages classiques », souligne en plus le rapport, même s’il est difficile d’obtenir des informations certaines sur ce partage dans le cadre de ces contrats de licence soumis au secret des affaires.
Réguler pour mieux rémunérer le offline ?
Les copies de confort pour le hors connexion font-elles l’objet d’un traitement spécifique dans le contrat et d’une rémunération distincte, comme l’exige implicitement le code de la propriété intellectuelle (CPI) lorsque celui-ci dit que la cession d’un droit (droit de représentation ou droit de reproduction) n’emporte pas celle de l’autre (
2) ? De plus, selon le même CPI, « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (
3). La mission part donc du principe que les contrats de licence entre plateformes de streaming et ayants droit sont conformes au CPI. En mettant en garde cependant : « Dans le cas contraire, ou si les termes des contrats sont trop vagues, l’exception de copie privée pourrait être invoquée ». Tout en excluant a priori une éventuelle taxe « copie privée » sur le hors connexion, le gouvernement suggère néanmoins aux parlementaires la mise en place d’« une régulation de la rémunération spécifique de la copie pour lecture hors connexion, par des tarifs négociés en commun entre toutes les plateformes et les OGC [organisme de gestion collective des droits d’auteur, ndlr] concernés, au niveau européen ».
Faisceau de quatre indices contre une taxe
La généralisation du streaming payant avec copie de confort pour une lecture offline justifie, selon les auteurs du rapport, de veiller à la rémunération des créateurs (auteurs et artistes-interprètes). Environ 70 % du prix des abonnements est reversé aux ayants droits – 55 % pour les producteurs et 15 % pour les organismes de gestion collective –, à charge pour eux de reverser aux auteurs et artistes interprètes la rémunération qui leur revient selon les indications fournies par les plateformes sur le comptage des streams. Mais quelle part concerne le hors connexion ? Sur ce point, c’est le flou artistique. Alors que le hors connexion est de plus en plus répandu. « Cette possibilité existe dans le cadre d’abonnements payants (offres premium) et constitue le plus souvent le facteur démarquant par rapport aux offres gratuites (freemium) de ces mêmes plateformes », relève le rapport gouvernemental. Selon les représentants des industries culturelle, ces copies à usage privé et de source licite dérogent au droit exclusif d’autorisation d’exploitation des ayants droit et génèrent un manque à gagner devant être rémunéré. Mais la mission IGF-IGAC a convaincu le gouvernement qu’un « faisceau d’indices » tend à exclure les copies de confort de la rémunération de la copie privée :
• Bien qu’elles soient physiquement stockées dans la mémoire du terminal de l’abonné, ces copies sont cryptées, de sorte qu’il est impossible pour l’utilisateur de les dupliquer ou de les transférer (elles ne peuvent sortir de l’univers de la plateforme) ;
• Ces copies sont éphémères puisqu’au bout de quinze jours sans reconnexion de l’utilisateur, la plateforme les supprime ;
• Ces copies donnent déjà lieu à une rémunération car, pour les plateformes de streaming musical telles que Deezer ou Spotify, les écoutes hors connexion sont comptabilisées dans le nombre total d’écoutes qui sert de base à la rémunération des ayants droit ;
• L’examen des conditions tarifaires de certains organismes de gestion collective montre que la rémunération qu’elles ont négociée avec les plateformes de streaming prend en compte les copies de confort.
Et le rapport de prendre l’exemple de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) pour l’écoute ou la visualisation de la musique en streaming par abonnement : la rémunération correspond à 15 % des recettes d’abonnement, assortie d’« un minimum de 1,20 euro hors taxe par abonné et par mois dans le cas d’une offre permettant la portabilité ainsi que l’écoute et la visualisation hors connexion » (
4).
Toutes ces questions autour des copies de confort au regard de l’articulation entre droit exclusif et exception de copie privée amènent le gouvernement à appeler les parlementaires à « une réflexion plus large (…) concernant la juste contribution des plateformes de streaming, payantes et non payantes, au financement de la création culturelle ». Le rapport n’évoque cependant pas la dernière tentative de taxer le streaming pour « financer de façon pérenne » le Centre national de la musique (CNM), selon les députés à l’origine de trois amendements déposés fin septembre dernier mais tous rejetés en octobre (
5) dans le cadre du projet de loi de finance 2023.
Tout en écartant une éventuelle taxe sur les copies de confort, qui reviendrait à taxer le streaming, le rapport « IGF-IGAC » du gouvernement reproche en outre à la commission copie privée le manque de transparence dans sa méthodologie de fixation des barèmes et de reversement de la rémunération en question.
Taxe « copie privée » : 300 millions d’€/an
Les études d’usage sont jugées trop anciennes (2017 et 2018 pour les dernières). Ce sont quand même près de 300 millions d’euros qui sont collectés. La taxe est prélevée sur le prix des appareils permettant le stockage numérique (smartphones, tablettes, clés USB, CD/DVD, disques durs externes, etc.) – par l’unique organisme français mandaté pour collecter la redevance pour la copie privée : Copie France (
6), lequel n’a pas vraiment apprécié ce rapport « IGF-IGAC » (
7). Le gouvernement appelle aussi à une meilleure gouvernance de la commission copie privée. Sa réunion prévue avant la fin de l’année s’annonce donc chargée, alors même que son rapport 2021 n’a pas encore été publié. « Nous le publierons début 2023 », nous indique Thomas Andrieu.
@
Charles de Laubier
 L’arrêté du 6 février 2025 portant extension de l’accord sur la chronologie des médias daté du même jour (1) étend les règles à l’ensemble des services de diffusion, y compris aux plateformes vidéo non-signataires de cet accord trouvé en janvier dernier. Si les recours devant le Conseil d’Etat de respectivement Netflix et Amazon Prime Video – lesquels les ont chacun confirmé en avril – traduisent des tensions persistantes entre plateformes, professionnels et régulateurs, ils n’équivalent pas à une remise en cause du système.
L’arrêté du 6 février 2025 portant extension de l’accord sur la chronologie des médias daté du même jour (1) étend les règles à l’ensemble des services de diffusion, y compris aux plateformes vidéo non-signataires de cet accord trouvé en janvier dernier. Si les recours devant le Conseil d’Etat de respectivement Netflix et Amazon Prime Video – lesquels les ont chacun confirmé en avril – traduisent des tensions persistantes entre plateformes, professionnels et régulateurs, ils n’équivalent pas à une remise en cause du système.
 Le normalien de 37 ans Gaëtan Bruel (photo) prend ce lundi 17 février ses fonctions pour trois ans de président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), après avoir été officialisé par décret présidentiel signé le 5 février. Soit… le même jour où le projet de loi de finances 2025 a été adopté par l’Assemblée nationale, dans la foulée du rejet de la motion de censure déposée par La France insoumise (LFI) contre le gouvernement Bayrou (
Le normalien de 37 ans Gaëtan Bruel (photo) prend ce lundi 17 février ses fonctions pour trois ans de président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), après avoir été officialisé par décret présidentiel signé le 5 février. Soit… le même jour où le projet de loi de finances 2025 a été adopté par l’Assemblée nationale, dans la foulée du rejet de la motion de censure déposée par La France insoumise (LFI) contre le gouvernement Bayrou (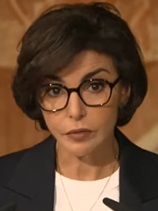
 Ce rapport du gouvernement au Parlement sur la rémunération pour copie privée, publié le 31 octobre dernier, a été réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), lesquelles dépendent respectivement de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, et de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Parmi les 22 propositions faites par le gouvernement, il y en a une qui concerne le sort des copies dites de confort permettant d’écouter du contenu hors connexion ou offline.
Commission copie privée : réunion en vue
Faut-il taxer ces copies pour rémunérer la copie privée, ce droit des internautes de reproduire une œuvre pour y avoir accès dans le cadre d’un cercle restreint familial ? La réponse du gouvernement est non. « Encourager la commission [pour la rémunération de la] copie privée à clarifier le statut des copies dites de confort permettant les écoutes hors connexion, et à suivre la proposition de la mission IGF-IGAC préparatoire au présent rapport de les exclure explicitement du champ de la rémunération pour copie privée », préconise le rapport dans sa proposition n° 11.
Cette commission pour la rémunération de la copie privée, présidée depuis un an par le conseiller d’Etat Thomas Andrieu (photo), est donc appelée à ne pas taxer le hors connexion. Et ce, contrairement à la demande des ayants droit des industries culturelles de taxer ces copies de confort, sous prétexte que cela génèrerait – selon eux – un manque à gagner devant être rémunéré. Contacté par Edition Multimédi@, le président de cette commission dite « L311-5 » (
Ce rapport du gouvernement au Parlement sur la rémunération pour copie privée, publié le 31 octobre dernier, a été réalisé par l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), lesquelles dépendent respectivement de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, et de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Parmi les 22 propositions faites par le gouvernement, il y en a une qui concerne le sort des copies dites de confort permettant d’écouter du contenu hors connexion ou offline.
Commission copie privée : réunion en vue
Faut-il taxer ces copies pour rémunérer la copie privée, ce droit des internautes de reproduire une œuvre pour y avoir accès dans le cadre d’un cercle restreint familial ? La réponse du gouvernement est non. « Encourager la commission [pour la rémunération de la] copie privée à clarifier le statut des copies dites de confort permettant les écoutes hors connexion, et à suivre la proposition de la mission IGF-IGAC préparatoire au présent rapport de les exclure explicitement du champ de la rémunération pour copie privée », préconise le rapport dans sa proposition n° 11.
Cette commission pour la rémunération de la copie privée, présidée depuis un an par le conseiller d’Etat Thomas Andrieu (photo), est donc appelée à ne pas taxer le hors connexion. Et ce, contrairement à la demande des ayants droit des industries culturelles de taxer ces copies de confort, sous prétexte que cela génèrerait – selon eux – un manque à gagner devant être rémunéré. Contacté par Edition Multimédi@, le président de cette commission dite « L311-5 » (