Il rêve de rentrer dans le club des dix milliardaires qui possèdent des pans entiers de la presse française, mais – à défaut d’avoir pu s’emparer de médias traditionnels (écarté il y a un an par Marianne puis par La Croix) – l’évangélisateur Pierre-Edouard Stérin lance sa croisade médiatique dans le monde digital.
 Il y a un an, en juillet 2024, la filiale française CMI France du magnat tchèque Daniel Kretinsky – l’un des dix milliardaires détenant des pans entiers des médias français (1) – cessait toute discussion avec un parvenu milliardaire en quête lui aussi d’influence médiatique, Pierre-Edouard Stérin (photo), qui voulait s’emparer de Marianne. Pour un catholique identitaire bien à droite voire à l’extrême droite, conservateur limite traditionnaliste, tenter de s’approprier l’hebdomadaire laïc et anti-néolibéral cofondé par feu Jean-François Khan (intellectuel de gauche devenu centriste), c’était osé mais voué à l’échec. La rédaction de Marianne, devenue « souverainiste », avait dans un premier temps (le 21 juin 2024) voté pour « la poursuite des négociations sur les garanties d’indépendance » (2) avec Pierre-Edouard Stérin via son family office Otium Capital. Mais la Société des rédacteurs de Marianne (SRM) avait in extremis changé d’avis, à la suite de révélations dans la presse sur les liens étroits de ce prétendant avec l’extrême droite, et vote (le 27 juin 2024) « à l’unanimité contre le rachat du magazine par Pierre-Edouard Stérin » (3). C’est notamment une enquête parue la veille dans Le Monde, et intitulée « “Versailles connection” : comment le milliardaire Pierre-Edouard Stérin place ses pions au RN » (4), qui jettent un froid sur les négociations menées avec ce libertarien conservateur par Daniel Kretinsky et son représentant en France Denis Olivennes (pourtant réputé de gauche, devenu lui aussi centriste).
Il y a un an, en juillet 2024, la filiale française CMI France du magnat tchèque Daniel Kretinsky – l’un des dix milliardaires détenant des pans entiers des médias français (1) – cessait toute discussion avec un parvenu milliardaire en quête lui aussi d’influence médiatique, Pierre-Edouard Stérin (photo), qui voulait s’emparer de Marianne. Pour un catholique identitaire bien à droite voire à l’extrême droite, conservateur limite traditionnaliste, tenter de s’approprier l’hebdomadaire laïc et anti-néolibéral cofondé par feu Jean-François Khan (intellectuel de gauche devenu centriste), c’était osé mais voué à l’échec. La rédaction de Marianne, devenue « souverainiste », avait dans un premier temps (le 21 juin 2024) voté pour « la poursuite des négociations sur les garanties d’indépendance » (2) avec Pierre-Edouard Stérin via son family office Otium Capital. Mais la Société des rédacteurs de Marianne (SRM) avait in extremis changé d’avis, à la suite de révélations dans la presse sur les liens étroits de ce prétendant avec l’extrême droite, et vote (le 27 juin 2024) « à l’unanimité contre le rachat du magazine par Pierre-Edouard Stérin » (3). C’est notamment une enquête parue la veille dans Le Monde, et intitulée « “Versailles connection” : comment le milliardaire Pierre-Edouard Stérin place ses pions au RN » (4), qui jettent un froid sur les négociations menées avec ce libertarien conservateur par Daniel Kretinsky et son représentant en France Denis Olivennes (pourtant réputé de gauche, devenu lui aussi centriste).
Echecs de Stérin sur Marianne et La Croix
Pourtant, ce n’est pas faute pour Pierre-Edouard Stérin (51 ans) de ne pas connaître Daniel Kretinsky (50 ans), puisque les deux milliardaires avaient – avec Stéphane Courbit (« élevé dans une culture athée de “bouffeurs de curés” » puis « devenu catholique pratiquant », d’après Paris Match) – fait une offre début 2023 pour tenter de racheter le numéro deux français de l’édition Editis à Vincent Bolloré. Mais l’inquiétude suscitée par Pierre-Edouard Stérin dissuade celui-ci de poursuivre dans ce trio, tandis que Stéphane Courbit le quitte aussi pour d’autres raisons, laissant le Tchèque s’emparer seul d’Editis (5) en juin 2023. Gros-Jean comme devant après la déconvenue que lui a infligée Marianne un an après, voici que ce chrétien militant a continué à croire en sa bonne étoile médiatique en tentant de mettre un pied dans la porte entrouverte de Bayard Presse, l’éditeur du quotidien catholique (de gauche) La Croix, propriété de la congrégation des Augustins de l’Assomption (appelée aussi congrégation des Assomptionnistes). Ce groupe confessionnel publie aussi Continuer la lecture

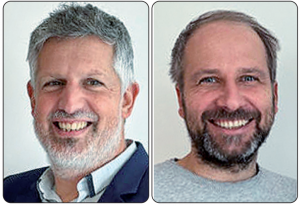 Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant.
Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant. Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.
Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.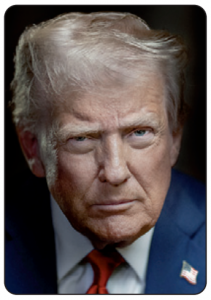 FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?
FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?