Dans le monde, 2,6 milliards d’êtres humains ne sont toujours pas connectés à Internet. Face à cette fracture numérique mondiale persistante, l’Isoc (Internet Society) cofondée en 1992 par Vinton Cerf – devenu « évangéliste » chez Google – a du mal à lever des fonds à la hauteur de sa promesse d’un Internet « pour tous ».
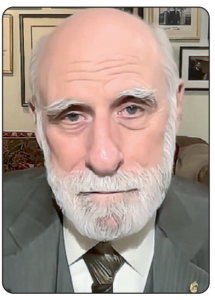 L’Américain Vinton Cerf (photo), qui a co-inventé avec son compatriote Robert Kahn le protocole Internet TCP/IP (1) – après s’être inspiré en mars 1973, lors d’une visite à Louveciennes, des travaux du Français Louis Pouzin (2) sur le datagramme (commutation de paquets) –, a lancé le 24 novembre dernier un appel aux dons pour financer l’Internet Society (Isoc). Vinton Cerf a cofondé, avec Robert Kahn et Lyman Chapin cette organisation américaine à but non lucratif le 11 décembre 1992 – il y a 33 ans presque jour pour jour. L’informaticien « Vint » (82 ans) et l’électronicien « Rob » (86 ans), qui ont tous les deux travaillé dans les années 1970 autour du réseau Arpanet créé au sein du département de la Défense des Etats-Unis, sont considérés comme étant parmi les « pères d’Internet », avec le frenchie « Louis » (94 ans). L’Isoc est née avec Internet dans le but de « faciliter, soutenir et promouvoir l’évolution et la croissance d’Internet en tant qu’infrastructure mondiale de communication pour la recherche » (3). Mais c’est bien grâce à l’Europe et à l’invention du Web par le Britannique Tim Berners-Lee – travaillant alors au Cern en Suisse, dans le « Building 31 » situé à la frontière sur territoire français (4) – que cet Internet, d’accord très technique et académique, deviendra grand public à partir du milieu des années 1990. L’Isoc, organisation institutionnelle d’Internet, est dans le même temps devenue la « maison mère » des communautés techniques IETF (5) et IAB (6).
L’Américain Vinton Cerf (photo), qui a co-inventé avec son compatriote Robert Kahn le protocole Internet TCP/IP (1) – après s’être inspiré en mars 1973, lors d’une visite à Louveciennes, des travaux du Français Louis Pouzin (2) sur le datagramme (commutation de paquets) –, a lancé le 24 novembre dernier un appel aux dons pour financer l’Internet Society (Isoc). Vinton Cerf a cofondé, avec Robert Kahn et Lyman Chapin cette organisation américaine à but non lucratif le 11 décembre 1992 – il y a 33 ans presque jour pour jour. L’informaticien « Vint » (82 ans) et l’électronicien « Rob » (86 ans), qui ont tous les deux travaillé dans les années 1970 autour du réseau Arpanet créé au sein du département de la Défense des Etats-Unis, sont considérés comme étant parmi les « pères d’Internet », avec le frenchie « Louis » (94 ans). L’Isoc est née avec Internet dans le but de « faciliter, soutenir et promouvoir l’évolution et la croissance d’Internet en tant qu’infrastructure mondiale de communication pour la recherche » (3). Mais c’est bien grâce à l’Europe et à l’invention du Web par le Britannique Tim Berners-Lee – travaillant alors au Cern en Suisse, dans le « Building 31 » situé à la frontière sur territoire français (4) – que cet Internet, d’accord très technique et académique, deviendra grand public à partir du milieu des années 1990. L’Isoc, organisation institutionnelle d’Internet, est dans le même temps devenue la « maison mère » des communautés techniques IETF (5) et IAB (6).
L’Isoc : grande mission, petits moyens
« Bonjour, je m’appelle Vint Cerf. J’ai été président fondateur de l’Internet Society en 1992. Et nous voilà en 2025, et l’[Isoc] poursuit sa mission. Je souhaite que vous compreniez que donner de votre temps, de votre énergie, et même un peu de votre argent à l’[Isoc] lui permettra d’accomplir sa mission principale : faire en sorte qu’Internet soit vraiment pour tout le monde », a déclaré le 24 novembre dans un appel aux dons – en vidéo diffusée sur YouTube – celui qui est non seulement le cofondateur de l’Internet Society, où il n’a plus de fonctions exécutives depuis les années 2000, mais aussi vice-président de Google où il a été recruté il y a 20 ans comme « Chief Internet Evangelist ». Et l’icône du Net d’ajouter : (suite)

 Les annonceurs publicitaires veulent à tout prix une « sécurité » ou une « protection » pour leurs marques lorsqu’elles s’exposent dans le monde numérique (réseaux sociaux, presse en ligne, …). Cette exigence de « brand safety » (protection de la marque) est de plus en plus doublée d’une demande de « brand suitability » (adéquation à la marque). Objectif des annonceurs : trier sur le volet – de façon automatisée pour la publicité qui est jusqu’à 90 % programmatique – les sites web ou les plateformes sur lesquels les publicités de leurs marques auront le droit de s’exposer, sans risque de se retrouver sur des contenus qu’ils jugent indésirables.
Les annonceurs publicitaires veulent à tout prix une « sécurité » ou une « protection » pour leurs marques lorsqu’elles s’exposent dans le monde numérique (réseaux sociaux, presse en ligne, …). Cette exigence de « brand safety » (protection de la marque) est de plus en plus doublée d’une demande de « brand suitability » (adéquation à la marque). Objectif des annonceurs : trier sur le volet – de façon automatisée pour la publicité qui est jusqu’à 90 % programmatique – les sites web ou les plateformes sur lesquels les publicités de leurs marques auront le droit de s’exposer, sans risque de se retrouver sur des contenus qu’ils jugent indésirables. Surblocages provoqués par des mots-clés
Surblocages provoqués par des mots-clés  Tobias Holzmüller (photo), le PDG de la Gema, qui est en Allemagne ce que la Sacem est en France, peut être fier du verdict historique obtenu en première instance du tribunal régional de Munich le 11 novembre 2025 : la manière dont OpenAI gère actuellement ChatGPT viole les lois européennes applicables sur le droit d’auteur. « Pour la première fois en Europe, l’argument en faveur de l’utilisation par les systèmes d’IA générative d’œuvres protégées par le droit d’auteur a été examiné juridiquement et statué en faveur des créateurs des œuvres », s’est félicitée la Société pour les droits d’exécution musicale et de reproduction mécanique (Gema).
Tobias Holzmüller (photo), le PDG de la Gema, qui est en Allemagne ce que la Sacem est en France, peut être fier du verdict historique obtenu en première instance du tribunal régional de Munich le 11 novembre 2025 : la manière dont OpenAI gère actuellement ChatGPT viole les lois européennes applicables sur le droit d’auteur. « Pour la première fois en Europe, l’argument en faveur de l’utilisation par les systèmes d’IA générative d’œuvres protégées par le droit d’auteur a été examiné juridiquement et statué en faveur des créateurs des œuvres », s’est félicitée la Société pour les droits d’exécution musicale et de reproduction mécanique (Gema). Roberto Viola (photo), le directeur général de la DG Connect – l’entité de la Commission européenne chargée de mettre en œuvre toute la stratégie numérique des Vingt-sept – est un homme discret. Cet Italien, qui a fêté le 1er septembre 2025 ses 10 ans à la tête de cette « direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie » (DG Cnect, son nom officiel), fait peu d’apparitions médiatiques et n’accorde que de rares interviews. Ses interventions grand public sont presqu’inexistantes, tant il réserve ses quelques apparitions à certaines conférences ou rencontres spécialisées (régulation numérique, innovations, cybersécurité, intelligence artificielle, …).
Roberto Viola (photo), le directeur général de la DG Connect – l’entité de la Commission européenne chargée de mettre en œuvre toute la stratégie numérique des Vingt-sept – est un homme discret. Cet Italien, qui a fêté le 1er septembre 2025 ses 10 ans à la tête de cette « direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie » (DG Cnect, son nom officiel), fait peu d’apparitions médiatiques et n’accorde que de rares interviews. Ses interventions grand public sont presqu’inexistantes, tant il réserve ses quelques apparitions à certaines conférences ou rencontres spécialisées (régulation numérique, innovations, cybersécurité, intelligence artificielle, …).