Les sites web pornographiques sont plus que jamais dans le collimateur en Europe quant à leur obligation de contrôler l’âge de leurs millions d’utilisateurs, afin d’interdire les mineurs (moins de 18 ans en général). C’est en outre un marché mondial du « divertissement pour adulte » difficile à évaluer.
(Le 16 juin 2025, jour de la parution de cet article dans Edition Multimédi@, le tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’arrêté du 26 février 2025)
 « L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.
« L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.
Haro européen sur les sites porno
Cet arrêté ministériel paru le 6 mars 2025 au Journal Officiel – cosigné par la ministre de la Culture Rachida Dati et la ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz – a été pris pour que les nouveaux pouvoirs de l’Arcom, présidée par Martin Ajdari (photo), s’appliquent à une liste de dix-sept sites pornographiques annexée à l’arrêté, dans un délai de trois mois après sa publication. A savoir, à partir du 7 juin 2025. Ces sites-là sont tous basés hors de France mais, raison d’être de cet arrêté, « dans un autre Etat membre de l’Union européenne » (1) : Pornhub, Youporn, Redtube, xHamster, XHamsterLive Tnaflix, Heureporno, XVideos Xnxx, SunPorno, Tukif, Reference-sexe, Jacquie et Michel, iXXX, Cam4, Tukif.love et LiveJasmin.
Si un site pornographique ne se conforme pas à une mise en demeure prononcée par l’Arcom, celle-ci peut le sanctionner d’une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial (le plus élevé des deux montants étant retenu). « Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive », prévient en outre la loi de 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique », dite LCEN (2). L’Arcom est déjà intervenue auprès de six sites porno situés, eux, en France ou en-dehors de Union européenne (UE). « Cinq d’entre eux ont, en responsabilité, fait le choix de mettre en place une solution de vérification de l’âge. Le dernier, n’ayant pas rendu disponibles l’identité de son fournisseur, ni son adresse, en violation de la loi, a été bloqué et déréférencé des principaux moteurs de recherche », a indiqué le régulateur français. Concernant les sites listés dans l’arrêté du 6 mars, il a précisé que (suite)

 Edition Multimédi@ revient sur l’amende de 150 millions d’euros infligée à Apple en France le 31 mars 2025 par l’Autorité de la concurrence, laquelle considère que le dispositif de demande de consentement des utilisateurs d’Apple pour l’exploitation de leurs données personnelles – App Tracking Transparency (ATT) – est anticoncurrentiel. Bien qu’étant la première dans cette affaire à mettre à l’amende la marque à la pomme, la France n’est pas la seule à accuser le fabriquant d’iPhone et d’iPad – dirigé par Tim Cook (photo de gauche) – d’abus de position dominante et de violation de la directive européenne « ePrivacy ».
Edition Multimédi@ revient sur l’amende de 150 millions d’euros infligée à Apple en France le 31 mars 2025 par l’Autorité de la concurrence, laquelle considère que le dispositif de demande de consentement des utilisateurs d’Apple pour l’exploitation de leurs données personnelles – App Tracking Transparency (ATT) – est anticoncurrentiel. Bien qu’étant la première dans cette affaire à mettre à l’amende la marque à la pomme, la France n’est pas la seule à accuser le fabriquant d’iPhone et d’iPad – dirigé par Tim Cook (photo de gauche) – d’abus de position dominante et de violation de la directive européenne « ePrivacy ». Les groupes audiovisuels publics en sont membres, que cela soit France Télévisions, Radio France et France Médias Monde dans l’Hexagone, l’ARD en Allemagne, la Rai en Italie, la NPO aux Pays-Bas, la STR en Suède, la PRT en Pologne, et bien d’autres encore. Car l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui fête en ce mois de mars ses 75 ans, représente aujourd’hui la quasi-totalité des médias publics détenus par leurs Etats membres respectifs dans les Vingt-sept, mais aussi quelques homologues publics présents un peu partout dans le monde, soit au total 68 entreprises publiques éditant 113 médias publics de radiodiffusion – télévisions et radios – dans 56 pays.
Les groupes audiovisuels publics en sont membres, que cela soit France Télévisions, Radio France et France Médias Monde dans l’Hexagone, l’ARD en Allemagne, la Rai en Italie, la NPO aux Pays-Bas, la STR en Suède, la PRT en Pologne, et bien d’autres encore. Car l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui fête en ce mois de mars ses 75 ans, représente aujourd’hui la quasi-totalité des médias publics détenus par leurs Etats membres respectifs dans les Vingt-sept, mais aussi quelques homologues publics présents un peu partout dans le monde, soit au total 68 entreprises publiques éditant 113 médias publics de radiodiffusion – télévisions et radios – dans 56 pays. Il y a un an – le 25 mars 2024 – pas moins de cinq enquêtes avaient été ouvertes contre trois géants américains du numérique : Apple (iOS/ iPadOS//App Store/Safari), Alphabet (Google/ Android/YouTube/Chrome) et Meta Platforms (Facebook/Instagram/WhatsApp/Messenger), soupçonnés d’enfreindre les nouvelles règles européennes sur les marchés numériques, autrement de violer le Digital Markets Act (DMA). La Commission européenne avait alors prévenu qu’elle avait l’intention de clore ces procédures « dans un délai de 12 mois » à partir de cette date-là (
Il y a un an – le 25 mars 2024 – pas moins de cinq enquêtes avaient été ouvertes contre trois géants américains du numérique : Apple (iOS/ iPadOS//App Store/Safari), Alphabet (Google/ Android/YouTube/Chrome) et Meta Platforms (Facebook/Instagram/WhatsApp/Messenger), soupçonnés d’enfreindre les nouvelles règles européennes sur les marchés numériques, autrement de violer le Digital Markets Act (DMA). La Commission européenne avait alors prévenu qu’elle avait l’intention de clore ces procédures « dans un délai de 12 mois » à partir de cette date-là (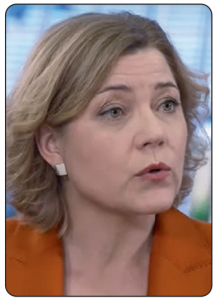 Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».
Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».