Le potentiel « champion européen » de l’IA générative, Mistral AI, a beau être valorisé près de 6 milliards d’euros depuis l’an dernier, son chiffre d’affaires 2024 est 200 fois inférieur. Pour mettre les bouchées doubles, la licorne française peut compter sur le chef de l’Etat Emmanuel Macron qui joue les VRP.
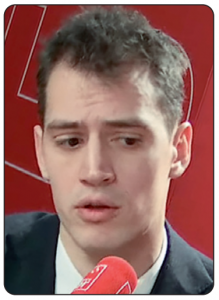 La licorne française Mistral AI, aux ambitions aussi grandes que sa valorisation de 5,8 milliards d’euros – atteinte il y a un an maintenant, à la faveur de sa dernière levée de fonds de 600 millions d’euros bouclée en juin 2024 –, a un besoin urgent de financements supplémentaires. Son PDG cofondateur Arthur Mensch (photo) l’avait confirmé à l’agence Bloomberg en février, notamment pour financer un centre de données qu’il prévoit de créer en France. « Bien sûr, en tant que start-up, on vous demande aussi de lever plus de fonds. C’est certainement un sujet qui nous préoccupe », avait-il confié (1). Le jeune patron (32 ans) avait annoncé ce projet de data center au journal de 20h de TF1, le 9 février (2). De plusieurs milliers de mètres carrés, il sera construit dans l’Essonne (département du sud de Paris), sur le plateau de Saclay, pour un investissement de « plusieurs milliards d’euros ». Si le calendrier de construction et d’ouverture reste à préciser, ce centre de données va permettre à « la pépite française » d’entraîner sur le sol français – au nom de la « souveraineté numérique » de la France – ses grands modèles de langage pour ses IA génératives. Mais cela suppose donc une prochaine levée de fonds pour Mistral AI, qui n’a généré en 2024 que 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, si l’on en croit le site Sifted.eu du Financial Times spécialisé dans les start-up (3). C’est à des années-lumière des 10 milliards de dollars annualisés que l’américain OpenAI (dont ChatGPT) a atteint en juin 2025 (4).
La licorne française Mistral AI, aux ambitions aussi grandes que sa valorisation de 5,8 milliards d’euros – atteinte il y a un an maintenant, à la faveur de sa dernière levée de fonds de 600 millions d’euros bouclée en juin 2024 –, a un besoin urgent de financements supplémentaires. Son PDG cofondateur Arthur Mensch (photo) l’avait confirmé à l’agence Bloomberg en février, notamment pour financer un centre de données qu’il prévoit de créer en France. « Bien sûr, en tant que start-up, on vous demande aussi de lever plus de fonds. C’est certainement un sujet qui nous préoccupe », avait-il confié (1). Le jeune patron (32 ans) avait annoncé ce projet de data center au journal de 20h de TF1, le 9 février (2). De plusieurs milliers de mètres carrés, il sera construit dans l’Essonne (département du sud de Paris), sur le plateau de Saclay, pour un investissement de « plusieurs milliards d’euros ». Si le calendrier de construction et d’ouverture reste à préciser, ce centre de données va permettre à « la pépite française » d’entraîner sur le sol français – au nom de la « souveraineté numérique » de la France – ses grands modèles de langage pour ses IA génératives. Mais cela suppose donc une prochaine levée de fonds pour Mistral AI, qui n’a généré en 2024 que 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, si l’on en croit le site Sifted.eu du Financial Times spécialisé dans les start-up (3). C’est à des années-lumière des 10 milliards de dollars annualisés que l’américain OpenAI (dont ChatGPT) a atteint en juin 2025 (4).
Prochaine levée de fonds indispensable
Comme la licorne n’est, par définition, pas cotée en Bourse, elle ne publie pas ses comptes et ne divulgue pas non plus ses résultats financiers. Contactée par Edition Multimédi@, la direction de Mistral AI n’a pas souhaité nous indiquer ni ses revenus ni ses prévisions. Le 7 mai dernier, à l’occasion du lancement de « Le Chat Enterprise » (assistant conversationnel dont la version grand public « Le Chat » a été lancée en février), Arthur Mensch s’est voulu rassurant quant à la (suite)

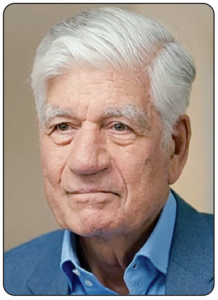 Le président d’honneur du groupe publicitaire Publicis, Maurice Lévy (photo), est depuis dix mois maintenant PDG de Solocal (ex-PagesJaunes) et actionnaire majoritaire via sa holding luxembourgeoise Ycor Management (
Le président d’honneur du groupe publicitaire Publicis, Maurice Lévy (photo), est depuis dix mois maintenant PDG de Solocal (ex-PagesJaunes) et actionnaire majoritaire via sa holding luxembourgeoise Ycor Management ( Ils s’appellent Amazon Data Services (AWS), Equinix, OVHcloud, Data4, Telehouse, Digital Realty, Atos, Scaleway, ou encore Microsoft Azure. Ce sont les opérateurs de centres de données, dont le marché français – à l’instar de ce qui se passe dans le monde – explose pour répondre à la forte demande de l’intelligence artificielle et des services de cloud. « On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques », définit officiellement le code des postes et des communications électroniques (CPCE). Et « on entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données » (
Ils s’appellent Amazon Data Services (AWS), Equinix, OVHcloud, Data4, Telehouse, Digital Realty, Atos, Scaleway, ou encore Microsoft Azure. Ce sont les opérateurs de centres de données, dont le marché français – à l’instar de ce qui se passe dans le monde – explose pour répondre à la forte demande de l’intelligence artificielle et des services de cloud. « On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques », définit officiellement le code des postes et des communications électroniques (CPCE). Et « on entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données » ( Il y a un an – le 25 mars 2024 – pas moins de cinq enquêtes avaient été ouvertes contre trois géants américains du numérique : Apple (iOS/ iPadOS//App Store/Safari), Alphabet (Google/ Android/YouTube/Chrome) et Meta Platforms (Facebook/Instagram/WhatsApp/Messenger), soupçonnés d’enfreindre les nouvelles règles européennes sur les marchés numériques, autrement de violer le Digital Markets Act (DMA). La Commission européenne avait alors prévenu qu’elle avait l’intention de clore ces procédures « dans un délai de 12 mois » à partir de cette date-là (
Il y a un an – le 25 mars 2024 – pas moins de cinq enquêtes avaient été ouvertes contre trois géants américains du numérique : Apple (iOS/ iPadOS//App Store/Safari), Alphabet (Google/ Android/YouTube/Chrome) et Meta Platforms (Facebook/Instagram/WhatsApp/Messenger), soupçonnés d’enfreindre les nouvelles règles européennes sur les marchés numériques, autrement de violer le Digital Markets Act (DMA). La Commission européenne avait alors prévenu qu’elle avait l’intention de clore ces procédures « dans un délai de 12 mois » à partir de cette date-là (