Ce n’est pas la Trump Media & Technology Group (TMTG), société cotée en Bourse, qui a lancé le 16 juin 2025 la marque Trump Mobile assortie de son smartphone T1, ni même The Trump Organization. En fait, c’est la filiale DTTM Operations, gestionnaire de la marque « Trump », qui a octroyé une licence à T1 Mobile.
 Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.
Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.
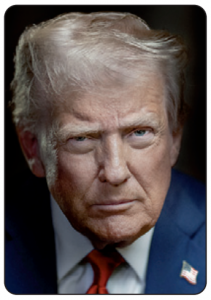 FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?
FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?
« Trump Mobile, ses produits et services ne sont pas conçus, développés, fabriqués, distribués ou vendus par la Trump Organization ou l’une de leurs sociétés affiliées ou dirigeants respectifs. T1 Mobile LLC utilise le nom et la marque de commerce “Trump” conformément aux termes d’un contrat de licence limité qui peut être résilié ou révoqué selon ses termes », prévient le site web Trumpmobile.com, édité par la société T1 Mobile, tout en précisant : « Trump Mobile ne possède, n’exploite ou ne contrôle pas ces services et n’est pas responsable de leur disponibilité, de leurs performances ou de leurs conditions d’utilisation». Seule la société DTTM Operations, qui gère les marques déposées associées à Donald Trump – dont les marques « Trump Mobile » et « T1 » déposées le 12 juin dernier (1) auprès de l’Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) –, a un lien contractuel avec la société tierce T1 Mobile. Enregistrée en (suite)

 « L’année 2025 est une étape importante pour le Forum sur la gouvernance de l’Internet, car elle marque l’occasion du 20e anniversaire du forum, et c’est un moment charnière pour façonner et améliorer le dialogue multipartite pour les années à venir », souligne Karianne Oldernes Tung (photo), ministre norvégienne de la Numérisation et de la Gouvernance publique. Son pays vient d’organiser durant une semaine (23-27 juin 2025) la 20e édition de l’Internet Governance Forum (IGN), à Lillestrøm, ville située à environ 18 km au nord-est de la capitale de la Norvège, Oslo.
« L’année 2025 est une étape importante pour le Forum sur la gouvernance de l’Internet, car elle marque l’occasion du 20e anniversaire du forum, et c’est un moment charnière pour façonner et améliorer le dialogue multipartite pour les années à venir », souligne Karianne Oldernes Tung (photo), ministre norvégienne de la Numérisation et de la Gouvernance publique. Son pays vient d’organiser durant une semaine (23-27 juin 2025) la 20e édition de l’Internet Governance Forum (IGN), à Lillestrøm, ville située à environ 18 km au nord-est de la capitale de la Norvège, Oslo.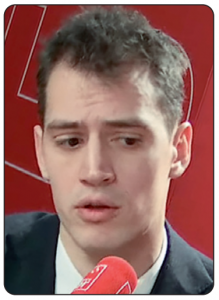 La licorne française Mistral AI, aux ambitions aussi grandes que sa valorisation de 5,8 milliards d’euros – atteinte il y a un an maintenant, à la faveur de sa dernière levée de fonds de 600 millions d’euros bouclée en juin 2024 –, a un besoin urgent de financements supplémentaires. Son PDG cofondateur Arthur Mensch (photo) l’avait confirmé à l’agence Bloomberg en février, notamment pour financer un centre de données qu’il prévoit de créer en France. « Bien sûr, en tant que start-up, on vous demande aussi de lever plus de fonds. C’est certainement un sujet qui nous préoccupe », avait-il confié (
La licorne française Mistral AI, aux ambitions aussi grandes que sa valorisation de 5,8 milliards d’euros – atteinte il y a un an maintenant, à la faveur de sa dernière levée de fonds de 600 millions d’euros bouclée en juin 2024 –, a un besoin urgent de financements supplémentaires. Son PDG cofondateur Arthur Mensch (photo) l’avait confirmé à l’agence Bloomberg en février, notamment pour financer un centre de données qu’il prévoit de créer en France. « Bien sûr, en tant que start-up, on vous demande aussi de lever plus de fonds. C’est certainement un sujet qui nous préoccupe », avait-il confié ( « Je le jure », ont été les premiers mots de Hugo Travers – en levant la main droite – en réponse au président de la « commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs »,de l’Assemblée nationale, qui l’invitait à prêter serment et « à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Connu sous son nom d’influenceur Hugo Décrypte (photo), le jeune homme de 28 ans a ainsi débuté son audition le 3 juin dernier. Il faisait partie des huit influenceurs interrogés sur leurs activités, et sur la filiale du chinois ByteDance.
« Je le jure », ont été les premiers mots de Hugo Travers – en levant la main droite – en réponse au président de la « commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs »,de l’Assemblée nationale, qui l’invitait à prêter serment et « à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Connu sous son nom d’influenceur Hugo Décrypte (photo), le jeune homme de 28 ans a ainsi débuté son audition le 3 juin dernier. Il faisait partie des huit influenceurs interrogés sur leurs activités, et sur la filiale du chinois ByteDance. « L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.
« L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.