Les « fake streams » (faux clics) et les « fake artists » (faux artistes) ne datent pas d’hier dans le streaming musical, mais l’intelligence artificielle accroît le phénomène de façon exponentielle. Pour faire face au fléau, l’industrie musicale compte sur les plateformes et la justice.
 La manipulation de la musique en ligne, dans le but de percevoir des royalties de manière plus ou moins frauduleuse, repend de l’ampleur depuis que l’IA s’est invitée dans l’industrie musicale. Cela impacterait environ 10 % des streams au niveau mondial, selon certaines sources (1). Si l’on considère les 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires du streaming musical réalisés en 2024, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la fraude représenterait quelque 2 milliards d’euros l’an dernier.
La manipulation de la musique en ligne, dans le but de percevoir des royalties de manière plus ou moins frauduleuse, repend de l’ampleur depuis que l’IA s’est invitée dans l’industrie musicale. Cela impacterait environ 10 % des streams au niveau mondial, selon certaines sources (1). Si l’on considère les 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires du streaming musical réalisés en 2024, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la fraude représenterait quelque 2 milliards d’euros l’an dernier.
Phénomène du streaming artificiel
« La musique est confrontée à la menace croissante de la manipulation du streaming, où des acteurs malveillants volent de l’argent qui devrait aller aux artistes légitimes en générant un jeu artificiel de morceaux qu’ils ont téléchargés sur les services musicaux. C’est du vol. L’utilisation d’outils d’IA générative par des manipulateurs de flux a considérablement exacerbé le problème. L’IA permet de générer très rapidement et en grand volume des images d’artistes, des pochettes et des pistes, ce qui permet une manipulation plus facile et à grande échelle », fustige l’IFPI. « Les maisons de disques continueront à intenter des actions en justice contre les individus derrière les sites qui vendent des morceaux artificiels, mais l’impact réel peut être obtenu par le secteur en se regroupant pour prévenir la fraude », a prévenu la fédération de l’industrie musicale dans son dernier rapport annuel publié en mars dernier (2).
Aussi, quelle n’a pas été sa satisfaction le 17 juillet 2025 de voir un tribunal de São Paulo, au Brésil, rendre la première décision de justice dans le cadre de l’« Operation Authentica », initiative de l’IFPI pour cibler les services dans le monde fournissant de fausses interactions en ligne. La société Seguidores Marketing Digital, qui a fait appel de la décision, a été (suite)

 L’affaire « Pormanove », du nom du streamer vidéaste français Jean Pormanove mort en direct sur sa chaîne vidéo diffusée sur la plateforme Kick, n’a pas pu vous échapper. Elle défraie la chronique depuis cette nuit du 17 au 18 août, durant laquelle Raphaël Graven (son vrai nom) a perdu la vie, à 46 ans, après 298 heures de diffusion non-stop et après avoir subi – de façon soi-disant consentie – des humiliations, des violences, des insultes et des sévices en tout genre. Sa chaîne « Jeanpormanove » sur Kick était suivie par près de 200.000 abonnés, dont certains payants ou donateurs.
L’affaire « Pormanove », du nom du streamer vidéaste français Jean Pormanove mort en direct sur sa chaîne vidéo diffusée sur la plateforme Kick, n’a pas pu vous échapper. Elle défraie la chronique depuis cette nuit du 17 au 18 août, durant laquelle Raphaël Graven (son vrai nom) a perdu la vie, à 46 ans, après 298 heures de diffusion non-stop et après avoir subi – de façon soi-disant consentie – des humiliations, des violences, des insultes et des sévices en tout genre. Sa chaîne « Jeanpormanove » sur Kick était suivie par près de 200.000 abonnés, dont certains payants ou donateurs.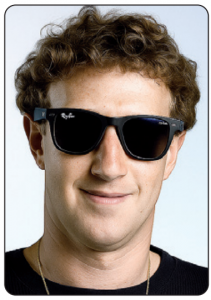 Meta, Snap, Xiaomi, Alibaba, TCL-RayNeo, Kopin Solos, Thunderobot, Google, Samsung, Apple, … La concurrence s’intensifie sur le marché mondial des lunettes connectées. Dix ans après l’échec des Google Glass, les fabricants américains et asiatiques s’y bousculent. Le groupe Meta Platforms, qui s’est associé sur plusieurs années avec le franco-italien EssilorLuxottica pour créer les Ray-Ban Stories en 2021 et les Ray-Ban Meta en 2023, mène la danse et s’apprête à lancer le 17 septembre une nouvelle paire boostée à l’intelligence artificielle.
Meta, Snap, Xiaomi, Alibaba, TCL-RayNeo, Kopin Solos, Thunderobot, Google, Samsung, Apple, … La concurrence s’intensifie sur le marché mondial des lunettes connectées. Dix ans après l’échec des Google Glass, les fabricants américains et asiatiques s’y bousculent. Le groupe Meta Platforms, qui s’est associé sur plusieurs années avec le franco-italien EssilorLuxottica pour créer les Ray-Ban Stories en 2021 et les Ray-Ban Meta en 2023, mène la danse et s’apprête à lancer le 17 septembre une nouvelle paire boostée à l’intelligence artificielle. Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – ont été rendues le 10 juillet 2025. L’arrêt est donc attendu entre octobre et janvier prochains. Statistiquement, la CJUE suit les conclusions de l’avocat général dans environ 70 % à 80 % des affaires. En substance : « Les Etats membres peuvent adopter des mesures de soutien pour garantir l’effectivité des droits des éditeurs de presse pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle » (
Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – ont été rendues le 10 juillet 2025. L’arrêt est donc attendu entre octobre et janvier prochains. Statistiquement, la CJUE suit les conclusions de l’avocat général dans environ 70 % à 80 % des affaires. En substance : « Les Etats membres peuvent adopter des mesures de soutien pour garantir l’effectivité des droits des éditeurs de presse pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle » (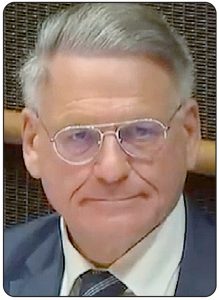 La vente par le groupe NRJ de sa chaîne Chérie 25 à CMA Média, filiale de l’armateur maritime CMA CGM (déjà propriétaire de BFMTV), s’est accélérée jeudi 24 juillet avec la signature d’un « protocole de cession, sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément de l’Arcom ». Et ce, trois jours après l’obtention par la direction de NRJ d’un « avis favorable unanime » des instances représentatives du personnel. Pour la première fois depuis 20 ans – NRJ 12 ayant été la première chaîne du groupe à être lancée (en mars 2005) –, le groupe de Jean-Paul Baudecroux (photo), son PDG fondateur, ne devrait pas allumer la télévision pour la saison 2025-2026, du moins sur la TNT (
La vente par le groupe NRJ de sa chaîne Chérie 25 à CMA Média, filiale de l’armateur maritime CMA CGM (déjà propriétaire de BFMTV), s’est accélérée jeudi 24 juillet avec la signature d’un « protocole de cession, sous condition suspensive de l’obtention de l’agrément de l’Arcom ». Et ce, trois jours après l’obtention par la direction de NRJ d’un « avis favorable unanime » des instances représentatives du personnel. Pour la première fois depuis 20 ans – NRJ 12 ayant été la première chaîne du groupe à être lancée (en mars 2005) –, le groupe de Jean-Paul Baudecroux (photo), son PDG fondateur, ne devrait pas allumer la télévision pour la saison 2025-2026, du moins sur la TNT (