RT et Sputnik ne diffusent plus en Europe depuis la décision et le règlement « PESC » du 1er mars. Saisi par RT France d’un recours en annulation de ces actes mais aussi d’un référé pour en suspendre l’exécution, le Tribunal de l’UE a rejeté le 30 mars ce référé. Retour sur ce blocage inédit.
Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats

Le 8 mars 2022, soit une semaine après la décision (
1) du Conseil de l’Union européenne (UE), RT France avait déposé un recours en annulation de cette décision relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE et du règlement afférent (
2), auprès du Tribunal de l’UE. La filiale de Russia Today a également déposé une demande en référé pour obtenir le sursis à l’exécution de ces derniers. Cette dernière demande a été refusée le 30 mars par le président du Tribunal, en raison de l’absence de caractère urgent.
La procédure au fond est accélérée
Selon l’ordonnance de rejet, RT France n’a pas suffisamment démontré l’existence d’un« préjudice grave et irréparable » (
3). Le média russe avait fait état d’un préjudice économique et financier, d’une grave atteinte à sa réputation, et plus largement « d’une entrave totale et durable à l’activité d’un service d’information et [le fait] que de tels actes seraient irrémédiables et particulièrement graves au sein de sociétés démocratiques » (
4). Quant au recours en annulation des deux actes (non législatifs), il suit son cours. Mais le président du Tribunal a précisé que « compte tenu des circonstances exceptionnelles en cause, le juge du fond a décidé de statuer selon une procédure accélérée » et que « dans l’hypothèse où RT France obtiendrait gain de cause par l’annulation des actes attaqués dans la procédure au fond, le préjudice subi (…) pourra faire l’objet d’une réparation ou une compensation ultérieure » (
5). RT France pourra faire appel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre l’ordonnance rejetant sa demande en référé. D’après le recours publié le 4 avril au JOUE, les bases légales invoquées par RT France reposent exclusivement sur des articles de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. La chaîne estime que les droits de la défense, le respect du contradictoire, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise et le principe de non-discrimination ont été méconnus (
6). Compte tenu de ces fondements, les débats porteront certainement sur l’indépendance et le rôle des médias dans une société démocratique.
• Comment en est-on arrivé là ? Dès le 27 février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l’interdiction de diffuser les médias russes Russia Today et Sputnik, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle estime en effet que ces médias – contrôlés par le Kremlin – diffusent des messages de propagande continues ciblant les citoyens européens, et menacent ainsi l’ordre et la sécurité de l’UE. Le 1er mars, le Conseil des ministres de l’UE a par conséquent adopté des mesures inédites, ordonnant de suspendre la diffusion et la distribution par tout moyen et sur tous les canaux des contenus provenant de ces médias.
Tous les opérateurs concernés ont immédiatement mis en œuvre le 2 mars 2022 ces mesures qui dérogent de manière inédite aux lois et procédures en la matière, notamment françaises.
• Quels sont les fondements juridiques européens ? Sur la procédure, la décision PESC du 1er mars 2022 se fonde sur l’article 29 du Traité sur l’UE et l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’UE. Ces deux articles présentent des moyens légaux pour sanctionner financièrement des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités non étatiques, dans le cadre de la PESC. Le Conseil de l’UE peut prendre seul des décisions, de manière unanime. Le Parlement, qui est habituellement le colégislateur, en est seulement informé. Par ailleurs, la CJUE est compétente que de manière très limitée lorsque des actes sont adoptés sur cette base. Elle peut notamment être saisie pour contrôler la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales (
7). Le Conseil de l’UE a recours habituellement à ces dispositions lorsqu’il souhaite stopper des échanges économiques visant à soutenir des groupes armés (
8), imposer des restrictions à l’entrée de l’UE ou encore geler les avoirs dans l’UE de personnes étrangères. Bien que le champ de ces actions soit limité, les textes européens offrent par ce biais un pouvoir unilatéral important aux gouvernements – d’où le caractère inédit, l’ampleur et la rapidité des sanctions à l’égard de ces médias russes.
Liberté d’expression et des médias
Sur les droits fondamentaux protégés par l’UE, fondements de la décision PESC du 1er mars, l’UE justifie son action sur la base de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, relatif à « la liberté d’expression et d’information » (
9). Ce texte ainsi que les décisions qui en découlent, à l’instar de la décision PESC contre RT et Sputnik, doivent être mis en œuvre et respectés par l’ensemble des Etats membres. En pratique, l’article 11 de la Charte renvoie à « la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ». Et l’article 11 d’ajouter : « La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés ». Pour autant, l’exercice de ces libertés peut être limité – par des lois – en raison d’objectifs d’intérêt général et s’il est nécessaire de protéger la sécurité nationale, l’intégrité du territoire ou la sûreté publique, entre autres (
10). Comme ces limites doivent respecter le principe de proportionnalité, le Conseil de l’UE justifie sa décision PESC par le respect notamment de la liberté d’entreprise, et précise qu’elle ne modifie pas l’obligation de respecter les constitutions des Etats membres. La protection de l’ordre et de la sécurité de l’UE a donc été centrale dans la motivation des Etats membres à adopter ces mesures exceptionnelles.
Suspensions et blocages exceptionnels
• Quelle mise en œuvre par les Etats membres ?
L’Arcom (ex-CSA), qui est l’autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, s’est immédiatement conformée à ces décisions d’urgence et a résilié le 2 mars sa convention avec RT France – Sputnik, lui, n’étant pas conventionné (
11), étant diffusé sur Internet. De la même manière, les fournisseurs d’accès à Internet, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ont immédiatement ou très rapidement bloqué l’accès au site en ligne et aux contenus de ces deux médias. On peut aussi se demander si l’application de cette décision par l’Arcom pourrait faire l’objet d’un recours devant un tribunal administratif français. Le Berec, lui, en tant qu’organisation européenne des régulateurs des télécoms, a par ailleurs précisé par le biais de deux communiqués (
12) que ces sanctions sont conformes à la régulation européenne sur l’« Internet ouvert ».
La mise en œuvre de ces sanctions européennes est exceptionnelle car elle a été d’application directe et immédiate. En principe, lorsqu’il est question d’interdire la diffusion d’un média étranger sur le territoire français, la loi impose de respecter un certain nombre de conditions. Pour ce qui est de l’interdiction de diffusion et de distribution de RT et de Sputnik en Europe, comme en France, aucune des dispositions légales courantes en la matière n’a été appliquée. Cette décision PESC déroge par conséquent aux modes habituels d’interdiction de diffusion d’un média et de contenus illicites en ligne, et également en matière de blocage de sites Internet. En effet, selon la loi française de 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion d’un média en France est en principe libre. Elle est dans certains cas soumise à l’autorisation préalable et à la conclusion d’une convention avec l’Arcom (
13). Selon cette même loi et le droit européen (
14), un média extra européen peut être rattaché à la compétence d’un Etat membre s’il est transmis principalement par un mode correspondant aux conditions de diffusion satellitaire (notamment par Eutelsat) décrites par les textes, et peut donc être soumis à des droits et obligations en France. Cependant, des raisons impérieuses doivent justifier une limite à l’exercice de cette liberté, notamment la sauvegarde l’ordre public ou la défense nationale (
15). En cas de manquement, l’Arcom peut s’adresser – via un courrier de mise en garde – aux opérateurs de réseaux satellitaires et aux services de médias audiovisuels, afin de faire cesser ce manquement. La procédure peut aller ensuite de la mise en demeure de cesser la diffusion du médias audiovisuel (service de télévision notamment) à la saisine du Conseil d’Etat afin qu’il ordonne en référé la cessation de la diffusion de ce média par un opérateur (
16). Depuis la loi de 2018 contre la manipulation de l’information, les pouvoirs de l’Arcom ont été étendus et elle peut prononcer la suspension provisoire de la diffusion d’un média et (
17), dans certains cas, peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention avec un média extra européen, dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, notamment par la diffusion de fake news (
18). Concernant le blocage des sites Internet en France, en l’occurrence ceux de RT France et de Sputnik, le code pénal et différentes lois, telles que la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), prévoient le retrait de contenus illicites, le blocage des sites et leur déférencement (
19). Cette loi autorise par exemple l’autorité judiciaire à prescrire toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un site web ou un média en ligne (
20). Dans des cas plus spécifiques, notamment la provocation à des actes terroristes et l’apologie publique de ces actes, ainsi que la pédopornographie, l’autorité administrative peut demander aux sites web ou autres intermédiaires en ligne de retirer les contenus en question. Concernant le blocage, il est mis en œuvre par les opérateurs télécoms sur la base d’une décision judiciaire ou administrative. Concernant le déréférencement, à savoir demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats de recherche associés à un mot, l’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques des sites en question afin de faire cesser le référencement (
21).
Faire face au reproche de censure ?
La France, en donnant son accord à la décision et au règlement PESC, a certainement considéré l’évidence de son application directe et immédiate, par opposition à la législation française inopérante dans un tel cas d’immédiateté. Le secrétaire d’Etat chargé du numérique, Cédric O, a d’ailleurs énoncé le souhait de revoir les règles de régulation – « y compris en ce qui concerne les médias » – dans les situations de conflits (
22). Plusieurs voix au sein de l’UE disent aussi vouloir travailler à un nouveau régime horizontal afin de lutter contre la désinformation, conscientes des difficultés en matière de transparence et de concertation que soulève une telle décision.
@
* Anne-Marie Pecoraro est avocate spécialisée en droit de la
propriété intellectuelle, des marques, des nouvelles technologies
 « L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.
« L’Arcom tient à rappeler sa détermination, partagée par les institutions européennes, à protéger les mineurs en ligne », a fait de nouveau savoir le régulateur français de l’audiovisuel le 3 juin, alors qu’un arrêté prévoit que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut – à partir du 7 juin 2025 – mette en demeure un éditeur pour que son service en ligne « pour adulte », ou sa plateforme de partage de vidéos aux contenus pornographiques, ne soit pas accessibles aux mineurs.
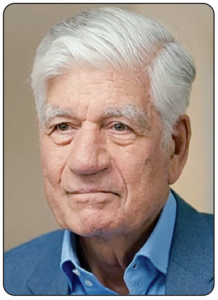 Le président d’honneur du groupe publicitaire Publicis, Maurice Lévy (photo), est depuis dix mois maintenant PDG de Solocal (ex-PagesJaunes) et actionnaire majoritaire via sa holding luxembourgeoise Ycor Management (
Le président d’honneur du groupe publicitaire Publicis, Maurice Lévy (photo), est depuis dix mois maintenant PDG de Solocal (ex-PagesJaunes) et actionnaire majoritaire via sa holding luxembourgeoise Ycor Management ( Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord.
Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord. Le 8 mars 2022, soit une semaine après la décision (
Le 8 mars 2022, soit une semaine après la décision ( Permettre aux internautes et aux mobinautes de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter. Telle est la philosophie des « Cnil » européennes, conformément à la directive sur la protection des données électroniques (ePrivacy) et le règlement général sur la protection des données (RGPD). En France, après une soixantaine de mises en demeures sur les cookies par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), présidée par Marie-Laure Denis (photo), les sociétés et organisations contrevenantes à la nouvelle réglementation sur les cookies avaient jusqu’au 6 septembre pour s’y conformer.
Permettre aux internautes et aux mobinautes de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter. Telle est la philosophie des « Cnil » européennes, conformément à la directive sur la protection des données électroniques (ePrivacy) et le règlement général sur la protection des données (RGPD). En France, après une soixantaine de mises en demeures sur les cookies par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), présidée par Marie-Laure Denis (photo), les sociétés et organisations contrevenantes à la nouvelle réglementation sur les cookies avaient jusqu’au 6 septembre pour s’y conformer.