2025 est la quatrième année où les Français n’ont plus à payer la redevance audiovisuelle, 2021 ayant été la dernière au cours de laquelle chaque foyer français équipé d’un téléviseur avait dû payer 138 euros. Pour autant, ils n’ont jamais autant dépensé pour voir des programmes audiovisuels.
 Si les 29,4 millions de foyers français n’ont plus à payer depuis quatre années de « contribution à l’audiovisuel public » (nom officiel de l’ancienne redevance audiovisuelle), ce qui rapportait à France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (France 24, RFI, MCD), ArteFrance, TV5 Monde et l’INA, de 3,2 milliards d’euros en 2022 à plus de 4,1 milliards d’euros en 2013, ils se retrouvent à dépenser plus d’argent pour s’offrir des contenus audiovisuels. Ainsi, rien que sur l’année 2024, les Français ont payé très exactement 11,385 milliards d’euros (1) – montant en hausse pour la seconde année consécutive (+ 1,1 % l’an dernier).
Si les 29,4 millions de foyers français n’ont plus à payer depuis quatre années de « contribution à l’audiovisuel public » (nom officiel de l’ancienne redevance audiovisuelle), ce qui rapportait à France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (France 24, RFI, MCD), ArteFrance, TV5 Monde et l’INA, de 3,2 milliards d’euros en 2022 à plus de 4,1 milliards d’euros en 2013, ils se retrouvent à dépenser plus d’argent pour s’offrir des contenus audiovisuels. Ainsi, rien que sur l’année 2024, les Français ont payé très exactement 11,385 milliards d’euros (1) – montant en hausse pour la seconde année consécutive (+ 1,1 % l’an dernier).
Les Français paient plus leur audiovisuel
Cette année 2025 est la quatrième où les Français n’auront pas à payer cette taxe dont ils devaient s’acquitter jusqu’en 2021 dans le cadre du paiement de leurs impôts. Cette redevance audiovisuelle a été supprimée en 2022 pour être remplacée par une fraction de la TVA affectée au financement de l’audiovisuel public : 3,585 milliards d’euros en 2022, idem en 2023, 4,026 milliards d’euros en 2024 et 4,029 milliards d’euros en 2025. Une loi organique datée du 13 décembre 2024, réformant le financement de l’audiovisuel public, a même été promulguée (2) pour pérenniser cette fraction du produit de la TVA allouée à l’audiovisuel public, car ce mode financement arrivait à échéance 31 décembre 2024. Malgré la disparition de la redevance « tété », qui finançait non seulement les chaînes de télévision publiques mais aussi les radios publiques, les consommateurs français dépensent tant et plus pour leurs contenus audiovisuels – lesquels sont, dans l’ordre décroissant des montants alloués : des chaînes de télévision payantes, des jeux vidéo, la vidéo à la demande, pour finir par les salles de cinéma.
Et malgré encore la disparition de la redevance, alors même que l’on compte en France 25 chaînes gratuites sur TNT, c’est toujours (suite)

 Le divertisseur en ligne Webedia est de nouveau dans une passe difficile, malgré le soutien financier de deux milliardaires : Marc Ladreit de Lacharrière, actionnaire majoritaire, et Bernard Arnault, actionnaire minoritaire. Ayant été créée par Cédric Siré en 2007, l’entreprise Webedia a commencé à éditer les sites web Purepeople, Puretrend et Purefans, pour ensuite croître à coup d’acquisitions (Terrafemina, Allociné, Jeuxvideo.com, 750g, Talent Web, Easyvoyage, Dr. Good, The Boxoffice Company, …) pour un total d’investissements d’environ 350 millions d’euros.
Le divertisseur en ligne Webedia est de nouveau dans une passe difficile, malgré le soutien financier de deux milliardaires : Marc Ladreit de Lacharrière, actionnaire majoritaire, et Bernard Arnault, actionnaire minoritaire. Ayant été créée par Cédric Siré en 2007, l’entreprise Webedia a commencé à éditer les sites web Purepeople, Puretrend et Purefans, pour ensuite croître à coup d’acquisitions (Terrafemina, Allociné, Jeuxvideo.com, 750g, Talent Web, Easyvoyage, Dr. Good, The Boxoffice Company, …) pour un total d’investissements d’environ 350 millions d’euros. Introduite à 290 pence à l’ouverture de la Bourse de Londres le 16 décembre 2024, l’action « CAN » du groupe Canal+ ne vaut plus que 175,1 pence le 13 mars 2025, au moment où nous bouclons ce n°339 de Edition Multimédi@, ce qui représente une chute de – 39,6 % (voir graphique). Et sa valorisation n’est plus que de 1,7 milliard de livres sterling (2 milliards d’euros). C’est une grosse déception pour les actionnaires, à qui la direction de Vivendi – l’ex-maison mère de Canal+ – avait fait miroiter une capitalisation potentielle d’environ 6 milliards d’euros.
Introduite à 290 pence à l’ouverture de la Bourse de Londres le 16 décembre 2024, l’action « CAN » du groupe Canal+ ne vaut plus que 175,1 pence le 13 mars 2025, au moment où nous bouclons ce n°339 de Edition Multimédi@, ce qui représente une chute de – 39,6 % (voir graphique). Et sa valorisation n’est plus que de 1,7 milliard de livres sterling (2 milliards d’euros). C’est une grosse déception pour les actionnaires, à qui la direction de Vivendi – l’ex-maison mère de Canal+ – avait fait miroiter une capitalisation potentielle d’environ 6 milliards d’euros.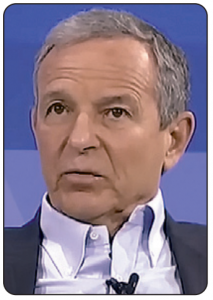 « Nos résultats de ce trimestre [octobre à décembre 2024, soit le premier trimestre de l’année fiscale 2025 qui sera clos fin septembre, ndlr] démontrent la force créative et financière de Disney […]. Nous avons encore amélioré la rentabilité de nos activités de diffusion en streaming », s’est félicité Robert Iger (photo), PDG de la Walt Disney Company. Alors que le chiffre d’affaires sur son marché domestique (les Etats-Unis et le Canada) stagne, celui réalisé à l’international accuse une baisse à deux chiffres (- 31 % sur le premier trimestre).
« Nos résultats de ce trimestre [octobre à décembre 2024, soit le premier trimestre de l’année fiscale 2025 qui sera clos fin septembre, ndlr] démontrent la force créative et financière de Disney […]. Nous avons encore amélioré la rentabilité de nos activités de diffusion en streaming », s’est félicité Robert Iger (photo), PDG de la Walt Disney Company. Alors que le chiffre d’affaires sur son marché domestique (les Etats-Unis et le Canada) stagne, celui réalisé à l’international accuse une baisse à deux chiffres (- 31 % sur le premier trimestre).