Deux principes fondamentaux régissent, dans le monde réel, le droit des marques : la spécialité et la territorialité. Mais qu’en est-il dans les mondes virtuels à l’ère des métavers ? Entre vide juridique et absence de jurisprudence, les titulaires de ces marques doivent s’y aventurer prudemment.
Par Véronique Dahan (photo), avocate associée, Joffe & Associés.

Le métavers – ou metaverse en anglais – est l’une des tendances les plus en vogues depuis la fin de l’année 2021. Cet intérêt soudain pour les espaces virtuels s’est fortement développé suite à l’annonce, faite par Mark Zuckerberg en octobre 2021, du changement de la dénomination du réseau social le plus populaire du monde (2,8 milliards d’utilisateurs mensuels). Facebook est ainsi devenu Meta (
1), et le géant américain a promis « de donner vie au métavers et d’aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises » (
2).
Principes de spécialité et de territorialité
Il est aujourd’hui possible de rattacher un métavers à une blockchain, une chaîne de blocs (voir encadré page suivante). Les métavers fonctionnant grâce elle permettent à leurs utilisateurs de devenir propriétaires de tous les biens virtuels qui y sont créés : parcelles de terrains, bâtiments, œuvres d’art, vêtements, etc. On peut citer comme exemple « The Sandbox Game » qui est un métavers décentralisé fonctionnant sur la blockchain Ethereum et qui offre aux utilisateurs la possibilité de créer, utiliser, acheter ou vendre toute sorte d’items numériques associés chacun à un jeton non-fongible dit NFT (Non-Fungible Token). Ces deux révolutions – métavers et blockchain – sont le signe d’une « hyperconvergence technologique » (
3) propice au métavers. Internet bascule d’un web 2.0 purement collaboratif, où les utilisateurs peuvent créer et diffuser du contenu, à un web 3.0 (ou Web3) immersif et appropriable. Ce basculement permet d’affirmer que le métavers n’a jamais été aussi proche du monde réel.
C’est la raison pour laquelle divers secteurs économiques – luxe, sport, mode, musique, art, … – s’intéressent aux possibilités offertes par le métavers et construisent leurs projets en conséquence. Les marques investissent d’ores et déjà dans le métavers, à l’image de Nike qui a lancé sont propres métavers sur la plateforme Roblox : Nikeland (
4). La plateforme Decentraland a, quant à elle, organisé fin mars 2022 la toute première « Metaverse Fashion Week » (
5). L’événement comprenait des défilés, des expositions de pièces de luxe, des concerts, des discussions et toutes sortes d’expériences virtuelles. Les marques prenant part à cet événement dans le métavers ont donc eu l’occasion de présenter leurs produits numériques sous forme de NFT, que les utilisateurs pouvaient acquérir dans le but de vêtir leur avatar de parures uniques et exclusives. Parmi ces marques, les visiteurs ont retrouvé Philipp Plein, Forever 21, Karl Lagarfeld ou encore Vogue & Hype. Beaucoup d’entreprises s’interrogent sur la stratégie à adopter pour protéger leurs marques dans le métavers. Les problématiques juridiques rencontrées dans le monde physique tendent à se transposer au métavers, que ce soit en matière de données personnelles, de droit de la consommation et évidemment de droit de la propriété intellectuelle. A ce jour, il n’existe aucune réglementation propre au métavers. A ce titre, la question de la stratégie à adopter afin d’obtenir une protection optimale de ses marques dans le métavers est cruciale. Le droit des marques est un droit monopolistique, en ce sens que la protection découlant de la marque permet à son titulaire d’évincer tous ses concurrents de l’utilisation à des fins commerciales d’un signe distinctif identique ou similaire.
Le droit des marques est régi par deux principes fondamentaux, dont l’extension au monde virtuel peut sembler épineuse : le principe de spécialité, d’une part, et le principe de territorialité, d’autre part.
• Est-ce nécessaire de protéger sa marque pour les produits et services liés spécifiquement au métavers ?
Le code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (
6). En vertu du principe de spécialité, une marque n’est protégée que pour les produits et services visés lors du dépôt (sauf pour les marques de renommées qui bénéficient d’une protection juridique élargie au-delà des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées). Toute la question est donc de savoir si un bien ou un service du monde réel pourrait être considéré comme identique ou similaire à son équivalent virtuel et générer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Réel et virtuel : risque de confusion
De prime abord, nous pourrions penser qu’un bien ou un service réel et son équivalent virtuel sont différents dans la mesure où ils ne rempliraient pas la même fonction. Si nous prenons l’exemple d’un sac : un sac virtuel n’est autre que des données informatiques représentées sur un écran. Il ne remplit pas sa fonction première qui est d’y ranger ses affaires. Toutefois, cette fonction première n’est pas la seule et unique fonction d’un sac. Comme dans le monde réel, le sac acheté dans le métavers, pour des avatars par exemple, le sera pour des considérations esthétiques et pas seulement pratiques, ainsi que pour des considérations d’image. Est-ce qu’en achetant un bien virtuel de telle ou telle marque dans le métavers, le consommateur fera-t-il le lien avec la marque/l’entreprise du monde réel ? La détermination du risque de confusion est évidemment subjective et dépend de chaque cas d’espèce. L’analyse ne se fait pas uniquement au regard des produits et services.
Déposer une marque : penser au virtuel
L’examen des signes en cause et des produits/services ne se fait pas de façon hermétique : il existe une interdépendance entre ces deux éléments. Ainsi, la faible similitude entre les produits peut être compensée par la haute ressemblance entre les signes, et vice versa. De même, si le signe revêt un caractère distinctif fort ou une certaine notoriété, le risque de confusion est augmenté. Il semble donc qu’une marque pourrait a priori être suffisamment protégée contre des usages dans le métavers, et ce même si elle n’est enregistrée que pour désigner des produits et services « classiques ».
Pour éviter tout débat et dans la mesure où il n’y pas encore de jurisprudence en la matière, il est toutefois recommandé aux titulaires de marques de déposer leurs marques en visant également des produits et services liés au métavers : biens virtuels téléchargeables, services de divertissement, à savoir la fourniture de vêtements (…) virtuels en ligne et non téléchargeables, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels.
• Est-il possible d’assurer la protection territoriale de la marque, produits et services, à l’ère du métavers ?
La marque est un droit territorial en ce sens que le monopole que détient le titulaire sur sa marque ne peut être opposé aux tiers que sur le territoire duquel l’enregistrement a été obtenu. Il peut dès lors sembler délicat de concilier le principe de territorialité de la marque avec le métavers. Par définition, le métavers est détaché de tout territoire puisqu’il prend la forme d’un univers à part entière.
On peut également estimer que le métavers a un caractère mondial, accessible à des utilisateurs établis aux quatre coins du globe. Se pose alors la question de savoir si une marque enregistrée uniquement en France peut bénéficier d’une protection efficace contre des actes de contrefaçon commis dans le métavers. Le simple accès au métavers par des utilisateurs français permettrait-il de considérer qu’il y a contrefaçon ?
La solution qui pourrait être adoptée serait celle communément admise s’agissant des atteintes aux marques sur Internet (
7). La jurisprudence a établi la théorie de la focalisation en matière de contrefaçon sur Internet, en vertu de laquelle l’acte de contrefaçon d’une marque française est constitué dès lors qu’un faisceau d’indices permet de démontrer que l’internaute français est la cible du site web étranger (accessibilité du site, utilisation de la langue française, livraison en France, etc.). Toutefois, contrairement aux sites Internet dont il est possible de démontrer qu’ils ont un public ciblé géographiquement, le métavers est quant à lui global, ne faisant pas a priori de différences en fonction de la géolocalisation des utilisateurs.
@
FOCUS
C’est quoi exactement le métavers et pourquoi un tel engouement ?
Contraction des mots « meta » (« au-delà de » en grec ancien) et « univers » (« universum » en latin), le métavers peut se définir comme un monde virtuel dans lequel des individus peuvent se retrouver pour interagir avec d’autres. Il n’existe pas qu’un seul et unique métavers. Les métavers sont innombrables et peuvent prendre des formes diverses et variées en fonction de leur objet.
Tandis que certains métavers prennent la forme de jeux vidéo, d’autres apparaissent comme des réseaux sociaux immersifs, ou des environnements virtuels de travail (
8). Les plus optimistes imaginent déjà une interopérabilité entre les métavers permettant d’aboutir à un univers virtuel unique.
Le début d’année 2022 est particulièrement marqué par l’enthousiasme de nombreux secteurs économiques pour le métavers. Pourtant, l’idée d’un monde parallèle et entièrement dématérialisé n’est pas nouvelle. Les prémices du métavers sont apparues en 1992, dans le roman « Snow Crash » écrit par Neal Stephenson, à une époque où Internet n’était encore qu’un sujet de niche. Visionnaire et précurseur, l’auteur décrit la vie de Hiro, un hacker vivant dans un conteneur qui, pour oublier son quotidien de misère, se plonge dans un univers virtuel haut de gamme : le metaverse. La première matérialisation du métavers surgit au début des années 2000 avec la création du jeu « Second Life » qui, comme son nom l’indique, propose à ses utilisateurs d’avoir une vie parallèle à celle du monde réel (
9). Aujourd’hui, il y a aussi « Roblox », « Minecraft » (
10) ou encore « GTA Online » que l’on qualifie communément de « sandbox » (bac-àsable), c’est-à-dire des jeux en monde ouvert au sein desquels les joueurs peuvent communiquer, créer et échanger tout type de biens virtuels.
L’effervescence actuelle autour du métavers semble être la conséquence de deux révolutions technologiques plus ou moins récentes : les casques de réalité virtuelle et la blockchain.
• D’une part, casques de réalité virtuelle, dont la commercialisation auprès du grand public des premiers modèles à partir de 2016, a eu pour effet de changer notre rapport avec le numérique. Le virtuel ne se trouve plus derrière notre écran d’ordinateur ou de portable ; il se vit, se contemple et devient quasi palpable. Le métavers vécu au travers de cette nouvelle technologie prend alors tout son sens. Les casques de réalité virtuelle permettent une immersion pleine et entière dans des environnements textuels riches et en trois dimensions. Le passage du monde physique à un monde immatériel est alors rendu possible.
• D’autre part, la technologie blockchain a occasionné le développement d’un phénomène nouveau : la propriété digitale. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’information. Autrement dit, c’est un registre public et décentralisé permettant d’enregistrer, d’horodater, de conserver et de rendre accessible aux utilisateurs toute information qui y est inscrite (
11). La blockchain apparaît donc comme une garantie de l’authenticité d’une information, d’un document ou d’une transaction.
@

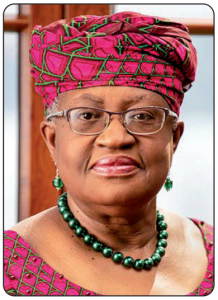 L’Organisation mondiale du commerce (OMC), que dirige Ngozi Okonjo-Iweala (photo) depuis mars 2021, fête cette année son trentième anniversaire dans une période sans précédent de fortes turbulences, alors qu’elle est censée assurer la solidité et la stabilité de l’économie mondiale en réglant les différends.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC), que dirige Ngozi Okonjo-Iweala (photo) depuis mars 2021, fête cette année son trentième anniversaire dans une période sans précédent de fortes turbulences, alors qu’elle est censée assurer la solidité et la stabilité de l’économie mondiale en réglant les différends. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines artistiques tend à révolutionner la manière dont nous analysons, créons et utilisons les œuvres cinématographiques, littéraires ou encore musicales. Si, dans un premier temps, on a pu y voir un moyen presque anecdotique de créer une œuvre à partir des souhaits d’un utilisateur ayant accès à une IA, elle inquiète désormais les artistes. Les algorithmes et les AI peuvent être des outils très efficaces, à condition qu’ils soient bien conçus et entraînés. Ils sont par conséquent très fortement dépendants des données qui leur sont fournies. On appelle ces données d’entraînement des « inputs », utilisées par les IA génératives pour créer des « outputs ».
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines artistiques tend à révolutionner la manière dont nous analysons, créons et utilisons les œuvres cinématographiques, littéraires ou encore musicales. Si, dans un premier temps, on a pu y voir un moyen presque anecdotique de créer une œuvre à partir des souhaits d’un utilisateur ayant accès à une IA, elle inquiète désormais les artistes. Les algorithmes et les AI peuvent être des outils très efficaces, à condition qu’ils soient bien conçus et entraînés. Ils sont par conséquent très fortement dépendants des données qui leur sont fournies. On appelle ces données d’entraînement des « inputs », utilisées par les IA génératives pour créer des « outputs ».  Le 21 août, YouTube a annoncé un accord avec Universal Music autour de l’IA musicale. Le Financial Times avait par ailleurs révélé le 9 août que sa maison mère Google et la première major mondiale de la musique enregistrée étaient en pourparlers pour autoriser que les mélodies et les voix des artistes soient exploitées par l’intelligence artificielle MusicLM (développée par Google) afin que celle-ci puisse créer de nouvelles chansons. Si ces négociations devaient aboutir, un accord de ce type serait une première pour l’industrie musicale qui, jusqu’à maintenant, voient plus ces IA génératives de musiques comme une menace pour elle.
Le 21 août, YouTube a annoncé un accord avec Universal Music autour de l’IA musicale. Le Financial Times avait par ailleurs révélé le 9 août que sa maison mère Google et la première major mondiale de la musique enregistrée étaient en pourparlers pour autoriser que les mélodies et les voix des artistes soient exploitées par l’intelligence artificielle MusicLM (développée par Google) afin que celle-ci puisse créer de nouvelles chansons. Si ces négociations devaient aboutir, un accord de ce type serait une première pour l’industrie musicale qui, jusqu’à maintenant, voient plus ces IA génératives de musiques comme une menace pour elle.