Ce n’est pas la Trump Media & Technology Group (TMTG), société cotée en Bourse, qui a lancé le 16 juin 2025 la marque Trump Mobile assortie de son smartphone T1, ni même The Trump Organization. En fait, c’est la filiale DTTM Operations, gestionnaire de la marque « Trump », qui a octroyé une licence à T1 Mobile.
 Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.
Bien que les deux fils du 47e président des Etats-Unis – Donald Trump Jr. (photo de gauche) et Eric Trump (photo de droite) – ont annoncé, de la Trump Tower à New York le 16 juin, le lancement de Trump Mobile et du smartphone T1, ce n’est ni The Trump Organization ni Trump Media & Technology Group (TMTG) qui opère cette nouvelle activité d’opérateur mobile. Il ne s’agit que d’un « accord de licence limité » de la marque « Trump » signé par la Donald Trump Trademark Management (DTTM Operations), filiale de la Trump Organization, avec la société T1 Mobile, créée début mai et enregistrée en Floride.
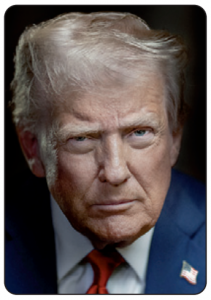 FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?
FCC, FTC, SEC, … au service du « Trump business » ?
« Trump Mobile, ses produits et services ne sont pas conçus, développés, fabriqués, distribués ou vendus par la Trump Organization ou l’une de leurs sociétés affiliées ou dirigeants respectifs. T1 Mobile LLC utilise le nom et la marque de commerce “Trump” conformément aux termes d’un contrat de licence limité qui peut être résilié ou révoqué selon ses termes », prévient le site web Trumpmobile.com, édité par la société T1 Mobile, tout en précisant : « Trump Mobile ne possède, n’exploite ou ne contrôle pas ces services et n’est pas responsable de leur disponibilité, de leurs performances ou de leurs conditions d’utilisation». Seule la société DTTM Operations, qui gère les marques déposées associées à Donald Trump – dont les marques « Trump Mobile » et « T1 » déposées le 12 juin dernier (1) auprès de l’Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) –, a un lien contractuel avec la société tierce T1 Mobile. Enregistrée en (suite)
