Le français Qwant et l’allemand Ecosia ont l’ambition de devenir une alternative européenne au quasimonopole de Google dans les moteurs de recherche, où l’IA rebat les cartes. Leur index web européen EUSP vise l’indépendance par rapport à Bing de Microsoft – accusé de pratique anti-concurrentielle.
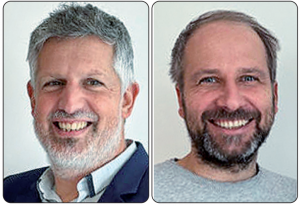 Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant.
Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant.
Cet index web européen, appelé European Search Perspective (EUSP), est développé par la joint-venture European Perspective, société créée à Paris en 2024, détenue à parts égales par Qwant et Ecosia, et présidée par Olivier Abecassis. « Pour l’Allemagne, c’est avant fin 2025, plutôt au quatrième trimestre », nous précise-t-il. Les premiers moteurs de recherche alternatifs à profiter de l’accès en temps réel aux données web les plus à-jour et pertinentes de cet index européen sont non seulement Qwant et Ecosia, mais aussi le français Lilo dont Qwant a finalisé l’acquisition mi-mai. « Ecosia et Lilo utiliseront également l’index EUSP pour servir dans les semaines à venir une partie de leurs requêtes en France », nous indique encore celui qui fut directeur du numérique du groupe TF1 (2016-2022).
Index web pour moteurs alternatifs et agents IA
La joint-venture European Perspective compte lever des capitaux auprès d’investisseurs extérieurs pour assurer son développement sur le long terme et être en capaciter de rivaliser avec Google. L’ambition du tandem franco-allemand : « Renforcer une alternative européenne, éthique et indépendante aux Gafam », mais aussi « plus respectueux de la vie privée » (1). Les résultats de recherche seront d’abord en langues française et allemande, une extension à l’anglais étant prévue, avec l’objectif à plus long terme d’être dans toutes les langues européennes. « Cet index pourra être rejoint par d’autres moteurs de recherche et servir de ressource clé pour l’industrie européenne, par exemple en fournissant un pool de données transparent et sécurisé pour (suite)

 Pendant que le Premier ministre prononçait le 14 janvier sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, dans laquelle il annonçait que « les conclusions des Etats généraux de l’information lancés par le président de la République devront être traduites [dans un texte législatif, ndlr] », Google et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) annonçaient le même jour le renouvellement de leur accord-cadre sur les droits voisins concernant plus de 160 publications sur près de 300 membres.
Pendant que le Premier ministre prononçait le 14 janvier sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, dans laquelle il annonçait que « les conclusions des Etats généraux de l’information lancés par le président de la République devront être traduites [dans un texte législatif, ndlr] », Google et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) annonçaient le même jour le renouvellement de leur accord-cadre sur les droits voisins concernant plus de 160 publications sur près de 300 membres. Après avoir été la première capitalisation boursière mondiale, le groupe Nvidia est redevenu la seconde à 3.314 milliards de dollars au 29 novembre 2024 (au moment où nous bouclons ce numéro de Edition Multimédi@), derrière Apple (3.551 milliards de dollars), Microsoft (3.144 milliards), Amazon (2.163 milliards) ou encore Alphabet/ Google (2.080 milliards), d’après CompaniesMarketCap (
Après avoir été la première capitalisation boursière mondiale, le groupe Nvidia est redevenu la seconde à 3.314 milliards de dollars au 29 novembre 2024 (au moment où nous bouclons ce numéro de Edition Multimédi@), derrière Apple (3.551 milliards de dollars), Microsoft (3.144 milliards), Amazon (2.163 milliards) ou encore Alphabet/ Google (2.080 milliards), d’après CompaniesMarketCap ( Quasi-monopole de puces GPU et IA
Quasi-monopole de puces GPU et IA  C’est le premier coup de gueule de Carine Fouteau (photo), cette journaliste qui a succédé en mars 2024 à Edwy Plenel à la présidence de la Société éditrice de Mediapart. La nouvelle directrice de la publication de Mediapart a dénoncé fin avril « l’opacité des Gafam » en général et « l’absence de transparence » de Google en particulier. Le média d’investigation reproche notamment « les clauses de confidentialité imposées par Google » dans le cadre de l’accord que ce dernier a signé en octobre 2023 avec la Société des droits voisins de la presse (DVP).
C’est le premier coup de gueule de Carine Fouteau (photo), cette journaliste qui a succédé en mars 2024 à Edwy Plenel à la présidence de la Société éditrice de Mediapart. La nouvelle directrice de la publication de Mediapart a dénoncé fin avril « l’opacité des Gafam » en général et « l’absence de transparence » de Google en particulier. Le média d’investigation reproche notamment « les clauses de confidentialité imposées par Google » dans le cadre de l’accord que ce dernier a signé en octobre 2023 avec la Société des droits voisins de la presse (DVP).