Avec la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), l’Union européenne n’a pas fait le tour des crypto-actifs. Le règlement MiCA – applicable depuis peu – devra évoluer pour prendre en compte ces innovations, à la lumière du rapport que prépare la Commission européenne.
Par Marta Lahuerta Escolano, avocate associée, et Diane Richebourg, avocate, Jones Day*
 Au lendemain de l’entrée en application du règlement européen sur les marchés de cryptoactifs (MiCA (1)), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié – en janvier 2025 – un rapport conjoint portant sur les « développements récents en matière de crypto-actifs » (2), contribution qui sera intégrée au rapport plus large que la Commission européenne doit soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne avant le 31 mars 2025.
Au lendemain de l’entrée en application du règlement européen sur les marchés de cryptoactifs (MiCA (1)), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié – en janvier 2025 – un rapport conjoint portant sur les « développements récents en matière de crypto-actifs » (2), contribution qui sera intégrée au rapport plus large que la Commission européenne doit soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne avant le 31 mars 2025.
Réglementer la DeFi, « phénomène de niche » ?
En effet, le législateur européen a pris soin, dans le MiCA (3), d’identifier pas moins de quatre sujets sur lesquels « la Commission [européenne], après avoir consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport […] sur les dernières évolutions intervenues en matière de crypto-actifs, en particulier dans des domaines qui ne sont pas abordés dans le présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative », à savoir notamment la finance décentralisée (DeFi), les prêts et emprunts de crypto-actifs ou encore les crypto-actifs uniques et non fongibles dits NFT (4). Dans le rapport « ABE-AEMF », seuls les deux premiers sujets sont analysés, laissant les NFT pour des discussions et réflexions ultérieures. Le règlement MiCA, qui marque une première étape importante en matière de (suite)

 La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.
La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés. Cofondée par deux Français (photos), Taha Bouarfa (basé à Hong Kong en Chine) et Kawther Ghazal (à Dubaï aux Emirats arabes unis), la société hongkongaise EarthMeta lance son métavers de « nouvelle génération », combinant intelligence artificielle et blockchain. Avec ce monde immersif qui a des airs de Google Earth (
Cofondée par deux Français (photos), Taha Bouarfa (basé à Hong Kong en Chine) et Kawther Ghazal (à Dubaï aux Emirats arabes unis), la société hongkongaise EarthMeta lance son métavers de « nouvelle génération », combinant intelligence artificielle et blockchain. Avec ce monde immersif qui a des airs de Google Earth (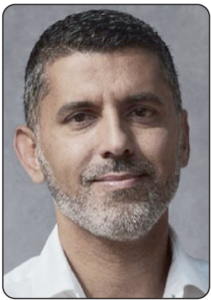
 Le métavers est un environnement fictif en 3D, interactif et immersif, qui combine le monde réel avec des mondes virtuels. A l’intérieur, les individus peuvent incarner des avatars et interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques. Imaginons un immense jeu vidéo multijoueur en ligne, regroupant divers univers de jeu où il est possible de naviguer librement. Une illustration saisissante de cette vision a été présentée dans le film « Ready Player One » de Steven Spielberg, sorti en 2018.
Le métavers est un environnement fictif en 3D, interactif et immersif, qui combine le monde réel avec des mondes virtuels. A l’intérieur, les individus peuvent incarner des avatars et interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques. Imaginons un immense jeu vidéo multijoueur en ligne, regroupant divers univers de jeu où il est possible de naviguer librement. Une illustration saisissante de cette vision a été présentée dans le film « Ready Player One » de Steven Spielberg, sorti en 2018.