En fait. Le 12 mai, La Lettre de l’Expansion – qui appartenait à Altice jusqu’en 2017 avant d’être cédée en 2021, avec sa maison mère WanSquare, au groupe Les Echos-Le Parisien – a affirmé que Xavier Niel (Free) et Martin Bouygues (Bouygues Telecom) sont deux à surenchérir pour tenter de racheter SFR à Altice.
En clair. Alors que la restructuration financière d’Altice France – dont Patrick Drahi ne détient plus que 55 % – ne sera finalisée qu’en septembre 2025, la mise en vente du troisième opérateur télécoms français SFR – filiale d’Altice France – ferait déjà l’objet d’enchères de la part de deux prétendants que sont Free et de Bouygues Telecom. Le Franco-Israélo-Portugo-Marocain (il est né à Casablanca en 1963), président du groupe international Altice espèrerait obtenir jusqu’à 5 milliards d’euros de la vente de SFR, d’après La Lettre de L’Expansion (qui fit un temps partie de la galaxie Altice). Ces nouvelles rumeurs se rajoutent à celles qui courent depuis en septembre 2023, lorsque Patrick Drahi a mis en vente SFR (1).
Xavier Niel (Free) et Martin Bouygues (Bouygues Telecom), qui auraient engagé un bras de fer en surenchérissant l’un contre l’autre, détiendraient à eux deux l’avenir de SFR entre leurs mains. La cession de SFR ne serait donc qu’une question d’argent, avec le fonds américain KKR et les opérateurs télécoms STC (saoudien) et Etisalat (émirati) en embuscade. Surtout que Patrick Drahi est obligé de désendetter son groupe international Altice (après avoir atteint 60 milliards d’euros de dettes), ayant déjà réduit la dette de sa seule filiale française, passée de 24,1 milliards d’euros à 15,5 milliards d’euros en février – contre la session de 45 % du capital d’Altice France à ses créanciers. Et (suite)

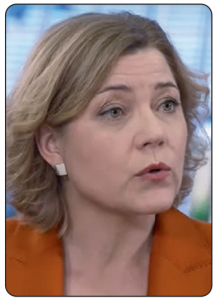 Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».
Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ». L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) va-t-elle en plus devenir le régulateur de la connectivité Internet ? La question posée par Edition Multimédi@ peut surprendre, mais cette perspective pourrait devenir réalité avec l’informatisation des réseaux, l’ouverture des interfaces de programmation applicative des réseaux, et la cloudification/virtualisation des entreprises. Une nouvelle ère se dessine pour la régulation des télécoms, lesquelles voient l’informatique s’immiscer partout et jusqu’à leurs extrémités.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) va-t-elle en plus devenir le régulateur de la connectivité Internet ? La question posée par Edition Multimédi@ peut surprendre, mais cette perspective pourrait devenir réalité avec l’informatisation des réseaux, l’ouverture des interfaces de programmation applicative des réseaux, et la cloudification/virtualisation des entreprises. Une nouvelle ère se dessine pour la régulation des télécoms, lesquelles voient l’informatique s’immiscer partout et jusqu’à leurs extrémités. Au plus tard le 21 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission européenne est tenue de réexamine le fonctionnement de la directive de 2018 établissant le code des communications électroniques européen (CCEE). De même, d’ici cette même échéance, et tous les cinq ans là aussi, elle doit aussi réexaminer la portée du service universel, en vue de proposer la modification ou la redéfinition du champ d’application.
Au plus tard le 21 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission européenne est tenue de réexamine le fonctionnement de la directive de 2018 établissant le code des communications électroniques européen (CCEE). De même, d’ici cette même échéance, et tous les cinq ans là aussi, elle doit aussi réexaminer la portée du service universel, en vue de proposer la modification ou la redéfinition du champ d’application.