Le 26 juin, lors de l’AG de la SCPP, organisme de gestion collective des droits des producteurs de musique, a été adopté le projet d’une filiale commune avec l’Adami (artistes et interprètes). Objectif : faire « données communes », notamment face à l’IA. La SPPF veut aussi les rejoindre.
 Voilà qui devrait aller dans le sens de la Cour des comptes : un mouvement de rapprochement en France entre les organismes de gestion collective (OGC) des droits d’auteur et des droits voisins. Cette mise en commun concerne d’abord leurs systèmes d’information pour mieux moderniser leur « Big Data » et se mettre en ordre de bataille face à la déferlante de l’intelligence artificielle. Les magistrats du palais de Cambon, présidés par Pierre Moscovici (photo), ne cesse de prôner un tel rapprochement dans le rapport annuel de la commission de contrôle des OGC.
Voilà qui devrait aller dans le sens de la Cour des comptes : un mouvement de rapprochement en France entre les organismes de gestion collective (OGC) des droits d’auteur et des droits voisins. Cette mise en commun concerne d’abord leurs systèmes d’information pour mieux moderniser leur « Big Data » et se mettre en ordre de bataille face à la déferlante de l’intelligence artificielle. Les magistrats du palais de Cambon, présidés par Pierre Moscovici (photo), ne cesse de prôner un tel rapprochement dans le rapport annuel de la commission de contrôle des OGC.
Rationaliser en faisant « Big Data » commun
Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), le 26 juin, une résolution validant la création d’une « filiale commune paritaire » avec l’Adami (Administration des droits des artistes et musiciens interprètes) a été adoptée. Le premier OGC collecte et répartit les droits d’auteur gérés collectivement pour le compte des producteurs de musiques enregistrées, dont les trois majors que sont Universal Music, Sony Music et Warner Music. Le second OGC collecte et répartit les droits d’auteurs pour le compte des artistes interprètes de la musique et de l’audiovisuel.
La SCPP est le bras armé financier du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) et compte plus de 4.500 producteurs de musique membres, tandis que l’Adami est au service de près de 100.000 artistes-interprètes. Improbable par le passé, ce rapprochement entre les deux organismes a été annoncé le 27 mai dernier (1) et va se concrétiser par « une mise en commun, à travers la création d’une filiale commune et paritaire, de leurs bases de données respectives et de leurs outils de répartition pour les droits à rémunération que sont la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable ». Une étude de faisabilité est en train d’être menée pour savoir comment sera mise en œuvre opérationnelle cette répartition, et pour adopter des règles communes d’affectation « par phonogramme » – comprenez par musique enregistrée où le streaming domine désormais. A à l’heure de la multiplication des IA génératives dévoreuses de catalogues musicaux, la mise en commun des moyens informatiques et des data s’impose. « Les organismes de gestion collective sont devenus des sociétés du Big Data nécessitant de constamment adapter leur système d’information. Ce défi prendra sa pleine mesure avec le développement de l’IA », justifient la SCPP dirigée par Marc Guez et l’Adami gérée par Michel Joubert. Un autre OGC, la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), qui revendique 2.330 producteurs associés et que dirige Jérôme Roger, a indiqué le 6 juin « vouloir rejoindre cette initiative dès que possible » (2). Tout en se réjouissant de l’accord de partenariat entre la SCPP et l’Adami, la SPPF – rivale historique de la SCPP et pendant de l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) – rappelle qu’elle avait conclu en 2022 un accord de partenariat avec la même Adami qui prévoyait « la possibilité d’une mise en commun de leurs systèmes d’information respectifs afin d’améliorer notamment la qualité des travaux d’identification ».
Dans le rapport de 2023 de sa commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, la Cour des comptes avait encore suggéré cette rationalisation informatique entre la SCPP et la SPPF pour faire des économies: « Le système d’information de la SCPP semble plus mature et en adéquation avec les enjeux du secteur. Un travail de convergence vers le système d’information de la SCPP pourrait être mis en place dans le cadre d’un rapprochement entre les deux organismes ». Les magistrats du palais de Cambon pointent «la complexité du dispositif français» faisant intervenir trois organismes, dont deux OGC de premier niveau (la SCPP et la SPPF) et un OGC intermédiaire (la SCPA), qui répartissent les droits collectés par d’autres OGC (SPRE, Copie France). Et en plus d’être rivales, la SCPP et la SPPF ferraillent en justice sur des contentieux entre elles depuis 2018.
Vers un rapprochement de tous les OGC ?
Selon la Cour des comptes, les deux OGC font soit « un divorce intégral, qui pourrait impliquer la dissolution de la SCPA », soit « une “sortie par le haut”, qui pourrait se traduire par un rapprochement plus étroit pouvant aller jusqu’à la fusion, au sein d’une nouvelle entité dont la SCPA pourrait être la préfiguration » (3). En tout cas, l’accord SCPPAdami pourrait être la première étape à un rapprochement entre l’ensemble des OGC en France, comme le souhaite la SPPF. Les auteurs, artistes et interprètes seraient gagnants. Et après, un rapprochement du Snep et de l’UPFI ? « Un rapprochement des syndicats n’est pas à l’ordre du jour », répond à Edition Multimédi@ Alexandre Lasch, directeur général du Snep. @
Charles de Laubier

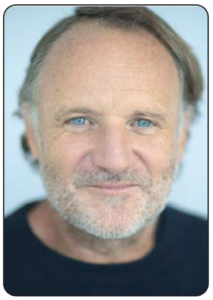 C’est le grand paradoxe de Believe : le streaming musical a explosé sur les plateformes numériques, mais pas le cours de Bourse de la petite major de la musique enregistrée. Au niveau mondial, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la musique en streaming a généré l’an dernier un total de 19,3 milliards de dollars de revenus – soit une hausse de 10,2 % sur un an. Tandis que le chiffre d’affaires de Believe a grimpé de 15,7 % pour atteindre 880,3 millions d’euros (avec une perte nette ramenée à 2,7 millions au lieu de 25 millions l’année précédente). Pourtant, les investisseurs boursiers ne semblent pas croire en la société Believe qui a été introduite mi-2021 à la Bourse de Paris (Euronext) au prix de 19,50 par action.
C’est le grand paradoxe de Believe : le streaming musical a explosé sur les plateformes numériques, mais pas le cours de Bourse de la petite major de la musique enregistrée. Au niveau mondial, d’après la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), la musique en streaming a généré l’an dernier un total de 19,3 milliards de dollars de revenus – soit une hausse de 10,2 % sur un an. Tandis que le chiffre d’affaires de Believe a grimpé de 15,7 % pour atteindre 880,3 millions d’euros (avec une perte nette ramenée à 2,7 millions au lieu de 25 millions l’année précédente). Pourtant, les investisseurs boursiers ne semblent pas croire en la société Believe qui a été introduite mi-2021 à la Bourse de Paris (Euronext) au prix de 19,50 par action. En clair.
En clair.