Les défis juridiques posés par les métavers ne sont pas inédits. Mais la clé pour instaurer un climat de confiance dans le monde virtuel réside dans une adaptation proactive du cadre réglementaire actuel pour faciliter l’intégration harmonieuse et sécurisée du métavers dans notre société.
Par Arnaud Touati, avocat associé, et Dany Sawaya, juriste, Hashtag Avocats.
 Le métavers est un environnement fictif en 3D, interactif et immersif, qui combine le monde réel avec des mondes virtuels. A l’intérieur, les individus peuvent incarner des avatars et interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques. Imaginons un immense jeu vidéo multijoueur en ligne, regroupant divers univers de jeu où il est possible de naviguer librement. Une illustration saisissante de cette vision a été présentée dans le film « Ready Player One » de Steven Spielberg, sorti en 2018.
Le métavers est un environnement fictif en 3D, interactif et immersif, qui combine le monde réel avec des mondes virtuels. A l’intérieur, les individus peuvent incarner des avatars et interagir avec d’autres personnes ou avec des objets numériques. Imaginons un immense jeu vidéo multijoueur en ligne, regroupant divers univers de jeu où il est possible de naviguer librement. Une illustration saisissante de cette vision a été présentée dans le film « Ready Player One » de Steven Spielberg, sorti en 2018.
L’avatar, sujet de droit indépendant ?
Le métavers suit une trajectoire similaire aux enjeux soulevés par le Web, et plus récemment par la blockchain (chaîne de blocs, en français). Il est indéniable que, même dans un monde virtuel, la règle de droit continue à s’appliquer. Le métavers, tout comme la blockchain et Internet de manière générale, revêt une dimension intrinsèquement internationale. Le métavers est également un terrain de jeu fertile pour l’innovation et le développement. La France, consciente de cette opportunité, cherche à faire du métavers une priorité et envisage d’utiliser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris (du 26 juillet au 11 août 2024) comme catalyseur pour rassembler les acteurs français des métavers. Toutefois, le développement du métavers soulève des questions juridiques complexes dans divers domaines tels que le droit de la consommation, la propriété intellectuelle, et le droit pénal. L’anticipation et l’encadrement juridique du métavers sont indispensables pour instaurer un climat de confiance et garantir une utilisation responsable et sécurisée de cette nouvelle frontière numérique.
• Défis et considérations juridiques du métavers en matière de consommation. Le métavers pose des défis inédits en matière de droit de la consommation. Par exemple, comment qualifier les contrats conclus entre avatars ? La capacité juridique de l’avatar repose-t-elle dans celle de l’utilisateur qui se trouve « derrière » ou l’avatar peut-il être reconnu comme un sujet de droit indépendant ? Dans ce monde virtuel, les règles de vente et de prestation de services ne sont pas encore clairement définies. Bien que le code de la consommation reconnaisse l’absence de présence physique simultanée des parties contractantes et l’utilisation de « techniques de communication à distance » pour qualifier un contrat à distance (1), la question se pose de savoir si

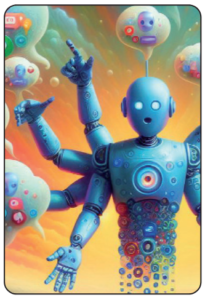 L’intelligence artificielle, c’est désormais le foisonnement permanent sur fond de bataille des LLM (Large Language Model), ces grands modèles de langage utilisés par les agents conversationnels et les IA génératives, capables d’exploiter en temps réel des milliards voire des dizaines de milliards de paramètres. Depuis le 30 novembre 2022, date du lancement fracassant de ChatGPT (
L’intelligence artificielle, c’est désormais le foisonnement permanent sur fond de bataille des LLM (Large Language Model), ces grands modèles de langage utilisés par les agents conversationnels et les IA génératives, capables d’exploiter en temps réel des milliards voire des dizaines de milliards de paramètres. Depuis le 30 novembre 2022, date du lancement fracassant de ChatGPT ( Il y a près de trois ans, le 21 avril 2021, la Commission européenne a proposé un règlement visant à établir des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen, appelé AI Act, a fait l’objet, le 9 décembre 2023 lors des trilogues (
Il y a près de trois ans, le 21 avril 2021, la Commission européenne a proposé un règlement visant à établir des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen, appelé AI Act, a fait l’objet, le 9 décembre 2023 lors des trilogues ( L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines artistiques tend à révolutionner la manière dont nous analysons, créons et utilisons les œuvres cinématographiques, littéraires ou encore musicales. Si, dans un premier temps, on a pu y voir un moyen presque anecdotique de créer une œuvre à partir des souhaits d’un utilisateur ayant accès à une IA, elle inquiète désormais les artistes. Les algorithmes et les AI peuvent être des outils très efficaces, à condition qu’ils soient bien conçus et entraînés. Ils sont par conséquent très fortement dépendants des données qui leur sont fournies. On appelle ces données d’entraînement des « inputs », utilisées par les IA génératives pour créer des « outputs ».
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines artistiques tend à révolutionner la manière dont nous analysons, créons et utilisons les œuvres cinématographiques, littéraires ou encore musicales. Si, dans un premier temps, on a pu y voir un moyen presque anecdotique de créer une œuvre à partir des souhaits d’un utilisateur ayant accès à une IA, elle inquiète désormais les artistes. Les algorithmes et les AI peuvent être des outils très efficaces, à condition qu’ils soient bien conçus et entraînés. Ils sont par conséquent très fortement dépendants des données qui leur sont fournies. On appelle ces données d’entraînement des « inputs », utilisées par les IA génératives pour créer des « outputs ».