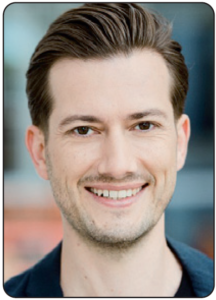En fait. Le 11 mars, le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) a présenté le bilan 2024 du marché français de la musique enregistrée, lequel refranchit au bout de 20 ans la barre du milliard d’euros. Pour autant, les Français ne se précipitent pas pour s’abonner aux plateformes de streaming.
En clair. Les 174 maisons de disques et labels membres du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), parmi lesquels les trois majors mondiales de la musique (Universal Music, Sony Music et Warner Music), se plaignent de ne pas arriver à convaincre suffisamment d’utilisateurs à s’abonner aux plateformes de streaming musical.
Pourtant, ce n’est pas les « streamers » qui manquent sur le marché français : Spotify, Deezer, Qobuz, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music ou encore Napster. Dans son bilan 2024 publié le 11 mars, le Snep fait état de « seulement » 12,3 millions d’abonnements (périodes d’essai comprises). Ces abonnements au streaming musical correspondent à 522,3 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, soit tout de même une hausse de 11,4 %, pour représenter plus des trois-quarts (77,5 %) du total des revenus numériques de la musique enregistrée. (suite)

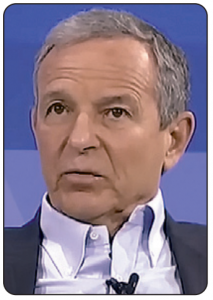 « Nos résultats de ce trimestre [octobre à décembre 2024, soit le premier trimestre de l’année fiscale 2025 qui sera clos fin septembre, ndlr] démontrent la force créative et financière de Disney […]. Nous avons encore amélioré la rentabilité de nos activités de diffusion en streaming », s’est félicité Robert Iger (photo), PDG de la Walt Disney Company. Alors que le chiffre d’affaires sur son marché domestique (les Etats-Unis et le Canada) stagne, celui réalisé à l’international accuse une baisse à deux chiffres (- 31 % sur le premier trimestre).
« Nos résultats de ce trimestre [octobre à décembre 2024, soit le premier trimestre de l’année fiscale 2025 qui sera clos fin septembre, ndlr] démontrent la force créative et financière de Disney […]. Nous avons encore amélioré la rentabilité de nos activités de diffusion en streaming », s’est félicité Robert Iger (photo), PDG de la Walt Disney Company. Alors que le chiffre d’affaires sur son marché domestique (les Etats-Unis et le Canada) stagne, celui réalisé à l’international accuse une baisse à deux chiffres (- 31 % sur le premier trimestre). « Dans un marché [mondial de la musique] qui pèse plus de 50 milliards de dollars et dominé par trois sociétés [Universal Music, Sony Music et Warner Music, ndlr], un nouvel équilibre verra le jour dans les prochaines années. Une redistribution des revenus moins concentrées a commencé. Aujourd’hui, et notamment grâce au succès des plateformes digitales, l’essentiel des transactions sont digitales. Des acteurs qui apportent de l’innovation et de la technologie vont être capables de participer à l’économie du secteur ».
« Dans un marché [mondial de la musique] qui pèse plus de 50 milliards de dollars et dominé par trois sociétés [Universal Music, Sony Music et Warner Music, ndlr], un nouvel équilibre verra le jour dans les prochaines années. Une redistribution des revenus moins concentrées a commencé. Aujourd’hui, et notamment grâce au succès des plateformes digitales, l’essentiel des transactions sont digitales. Des acteurs qui apportent de l’innovation et de la technologie vont être capables de participer à l’économie du secteur ».