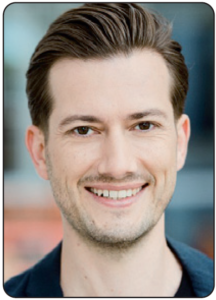Le rapport du CSPLA sur la mise en œuvre du règlement européen établissant des règles harmonisées sur l’IA fournit les ingrédients mais… pas la recette ! Le Bureau européen de l’IA, créé par l’AI Act, doit publier prochainement un « modèle européen » à suivre par les Vingt-sept.
Par Anne-Marie Pecoraro*, avocate associée, UGGC Avocats
 Le rapport « IA et Transparence des données d’entraînement » (1), publié le 11 décembre 2024 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), s’inscrit dans la préparation de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) et a pour objectif de clarifier l’interprétation et la portée des dispositions imposant un modèle de « résumé suffisamment détaillé » (2). Ce modèle sera présenté au nom de la France dans le cadre du processus d’adoption d’un modèle européen par le Bureau européen de l’IA (AI Office), autorité créée par l’AI Act et chargée d’accompagner les fournisseurs d’IA dans leur mise en conformité. La publication du modèle européen est attendue pour janvier 2025.
Le rapport « IA et Transparence des données d’entraînement » (1), publié le 11 décembre 2024 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), s’inscrit dans la préparation de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) et a pour objectif de clarifier l’interprétation et la portée des dispositions imposant un modèle de « résumé suffisamment détaillé » (2). Ce modèle sera présenté au nom de la France dans le cadre du processus d’adoption d’un modèle européen par le Bureau européen de l’IA (AI Office), autorité créée par l’AI Act et chargée d’accompagner les fournisseurs d’IA dans leur mise en conformité. La publication du modèle européen est attendue pour janvier 2025.
Transparence des données d’entraînement
La collecte de données de qualité, notamment de données culturelles, est d’une importance stratégique pour les fournisseurs d’IA, puisque les systèmes d’IA ont besoin d’ingurgiter de grandes quantités de données, leur servant de modèles dans leurs productions. Or, des données contenant des créations protégées par un droit de propriété intellectuelle peuvent avoir été obtenues sans autorisation ou sans tenir compte d’un « opt-out », et avoir été effectivement exploitées. Il en va de même concernant des données personnelles (posts Facebook, Instagram, …) potentiellement utilisées pour l’entraînement de modèles d’IA. L’enjeu est alors d’avoir accès à l’information sur les données d’entraînement utilisées par une IA, pour bien des raisons et notamment ouvrir une visibilité aux ayants droits dont des données et/ou créations auraient été mobilisées, quelles qu’en soient les modalités.
Pour ce faire, les fournisseurs d’IA sont désormais soumis à une obligation de transparence qui se concrétise par la mise en place d’une politique de conformité, ainsi que par la mise à disposition au public d’un « résumé suffisamment détaillé » (sufficiently detailed summary) des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle d’IA. Ce résumé permet le développement d’une IA de confiance souhaitée au niveau européen (3), en remédiant aux difficultés rencontrées par les titulaires de droits, confrontés à une charge de la preuve disproportionnée concernant l’utilisation de leurs contenus. Pour autant, le résumé doit répondre aux enjeux de la création d’un marché dynamique et équitable de l’IA. Ce qui impose un compromis pour restreindre la quantité d’informations mise à disposition afin de protéger le secret des affaires, moteur d’innovation pour les fournisseurs d’intelligence artificielle. (suite)

 La loi du 25 octobre 2021 de « régulation et de protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique », loi dite « Antipiratage » (
La loi du 25 octobre 2021 de « régulation et de protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique », loi dite « Antipiratage » ( La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés.
La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a eu le dernier mot dans l’affaire qui opposait depuis près de dix ans en France l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir) et la société américaine Valve Corporation. Cofondée en 1996 par son président Gabe Newell (photo de gauche), Valve opère la plateforme numérique Steam créée en 2002 pour distribuer et diffuser en ligne des jeux vidéo, des logiciels, des films ou encore des séries. L’arrêt du 23 octobre 2024 a tranché en faveur de Valve qui n’autorise pas la revente de jeux vidéo dématérialisés. Le règlement sur les services numériques – Digital Services Act (DSA) – du 19 octobre 2022 (
Le règlement sur les services numériques – Digital Services Act (DSA) – du 19 octobre 2022 (