Avec ses 100 millions de visites par mois, seuil atteint en 2025, 20 Minutes – média « 100 % numérique » depuis l’abandon du papier en juillet 2024 – bascule sous « conditions » dans les mains du groupe belge Rossel (Le Soir, La Meuse, …), bien implanté aussi dans le Nord de la France (La Voix du Nord, Courrier Picard, …).
 C’est une question de « semaines » pour finaliser l’opération, a priori en mars. Le groupe familial belge Rossel, détenu par la famille Hurbain depuis sa création en 1887, passe un cap historique en France en prenant le contrôle du quotidien national français 20 Minutes. Il ne détenait jusqu’alors dans l’Hexagone que des quotidiens régionaux comme La Voix du Nord, Courrier Picard ou Paris Normandie, ainsi que des hebdomadaires locaux, des magazines, des radios (Radio Contact et Champagne FM) et la télévision locale Wéo (1).
C’est une question de « semaines » pour finaliser l’opération, a priori en mars. Le groupe familial belge Rossel, détenu par la famille Hurbain depuis sa création en 1887, passe un cap historique en France en prenant le contrôle du quotidien national français 20 Minutes. Il ne détenait jusqu’alors dans l’Hexagone que des quotidiens régionaux comme La Voix du Nord, Courrier Picard ou Paris Normandie, ainsi que des hebdomadaires locaux, des magazines, des radios (Radio Contact et Champagne FM) et la télévision locale Wéo (1).
En rachetant les 49,3 % que le groupe français Sipa Ouest-France codétenait à part égale à la sienne (hormis 1,4 % d’actions autodétenues) dans la société 20 Minutes France basée à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, le groupe de médias bruxellois a désormais les coudées franches pour continuer à concurrencer les quotidiens nationaux français Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, ou encore Libération. Quotidien gratuit lancé en France par le groupe norvégien Schibsted il y aura 24 ans le 15 mars 2026, 20 Minutes – présenté alors comme « un nouveau média complémentaire de la presse classique » s’adressant à « une nouvelle génération de lecteurs qui ne lit pas la presse payante » – s’est imposé rapidement dans le paysage de la presse française. Edité au format papier jusqu’en juillet 2024 (distribué gratuitement dans les grandes villes françaises), 20 Minutes est devenu le premier média numérique le plus consulté.
20 Minutes, en tête des médias en ligne
D’après un sondage mené par YouGov pour le Reuters Institute for the Study of Journalism, publié dans le Digital News Report 2025 en juin dernier (2), 20 Minutes – que dirige Sabina Gros (photo de gauche) – arrive en tête des médias numériques les plus fréquentés chaque semaine par les Français (14 %), devant Le Monde à égalité avec TF1 Info (12%) ou encore Franceinfo (11%), laissant même loin derrière Le Parisien à égalité avec Le Figaro (9 %) et même Ouest-France (7 %). Cependant, si l’on se fie cette fois aux audiences en ligne (sites web et applications mobiles) déclarées par les éditeurs eux-mêmes auprès de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) qui les certifie, 20 Minutes se maintient en 9e position en nombre de visites par mois, et même 7e si l’on met à part Leboncoin et Tele-Loisirs (3), devançant tout de même Le Parisien et Libération. L’audience a même bondi en 2025 de 22,9 %, au point de Continuer la lecture

 Meta Platforms (ex-groupe Facebook), maison mère de Instagram, WhatsApp, Oculus et aussi éditrice des services Messenger et Threads, a franchi pour son exercice 2025 – dont les résultats ont été présentés le 28 janvier – la barre des 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Lors de ses précisions pour l’année 2025, établie fin octobre (lors de la présentation des résultats du troisième trimestre), la directrice financière du groupe, Susan Li (photo de gauche) n’avait pas exclu de parvenir à dépasser cette barre symbolique.
Meta Platforms (ex-groupe Facebook), maison mère de Instagram, WhatsApp, Oculus et aussi éditrice des services Messenger et Threads, a franchi pour son exercice 2025 – dont les résultats ont été présentés le 28 janvier – la barre des 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Lors de ses précisions pour l’année 2025, établie fin octobre (lors de la présentation des résultats du troisième trimestre), la directrice financière du groupe, Susan Li (photo de gauche) n’avait pas exclu de parvenir à dépasser cette barre symbolique.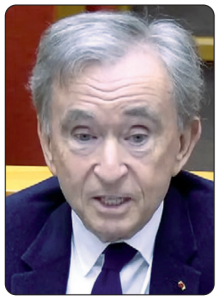 Dommage qu’il n’y ait pas eu, parmi les six « sections » de l’Académie des sciences morales et politiques, une intitulée « Information et Médias » pour accueillir – au « Fauteuil n°1 » – Bernard Arnault (photo), à l’occasion de son installation solennelle, le 12 janvier 2026, comme nouvel académicien de cette institution élitiste. Car le multimilliardaire du luxe – PDG de LVMH, habitué à être la première fortune de France (
Dommage qu’il n’y ait pas eu, parmi les six « sections » de l’Académie des sciences morales et politiques, une intitulée « Information et Médias » pour accueillir – au « Fauteuil n°1 » – Bernard Arnault (photo), à l’occasion de son installation solennelle, le 12 janvier 2026, comme nouvel académicien de cette institution élitiste. Car le multimilliardaire du luxe – PDG de LVMH, habitué à être la première fortune de France ( Patrick Drahi (photo), président du groupe Altice, est « sous contrainte », comme on dit dans le monde impitoyable de la finance. Que cela soit pour Altice France (maison mère de SFR et de XpFibre), pour Altice International (Altice Portugal, Hot Telecommunication en Israël, Altice Dominicana en République Dominicaine) ou pour Altice USA (Cablevision/Optimum et Suddenlink/Optimum), l’empire télécoms du Franco-Israélien milliardaire n’est pas encore sorti d’affaire. Certes, le surendettement de ses trois sociétés a diminué grâce à des restructurations de dettes, des ventes d’actifs et des refinancements effectués en 2024 et 2025.
Patrick Drahi (photo), président du groupe Altice, est « sous contrainte », comme on dit dans le monde impitoyable de la finance. Que cela soit pour Altice France (maison mère de SFR et de XpFibre), pour Altice International (Altice Portugal, Hot Telecommunication en Israël, Altice Dominicana en République Dominicaine) ou pour Altice USA (Cablevision/Optimum et Suddenlink/Optimum), l’empire télécoms du Franco-Israélien milliardaire n’est pas encore sorti d’affaire. Certes, le surendettement de ses trois sociétés a diminué grâce à des restructurations de dettes, des ventes d’actifs et des refinancements effectués en 2024 et 2025.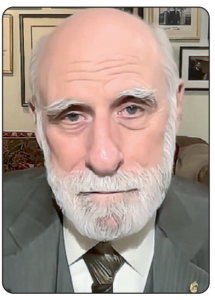 L’Américain Vinton Cerf (photo), qui a co-inventé avec son compatriote Robert Kahn le protocole Internet TCP/IP (
L’Américain Vinton Cerf (photo), qui a co-inventé avec son compatriote Robert Kahn le protocole Internet TCP/IP (