Chinois et Américain, président exécutif du géant mondial de la vente en ligne de vêtements Shein depuis trois ans, Donald Tang a eu plusieurs vies, à commencer par banquier d’affaires. Il a investi dans le cinéma et l’audiovisuel via sa holding Tang Media Partners créée il y a dix ans – mais sans succès.
 Cela fait quatre ans presque jour pour jour que Donald Tang (photo) a été recruté par le groupe chinois Shein. Après avoir été conseiller du PDG fondateur Chris Xu, l’ex-banquier d’affaire sino-américain est monté en grade pour devenir en août 2023 président exécutif du géant mondial du e-commerce de vêtement et d’accessoires de mode. Si son patron sino-singapourien, dénommé aussi Sky Xu, se fait très discret, Donald Tang, lui, fait office de porte-parole de l’enseigne Shein en tant que représentant mondial, avec des casquettes aussi différentes que président exécutif, responsable des affaires publiques, directeur de la stratégie ou encore chargé du développement international. Fondé en 2008 à Nankin (Chine), le groupe vestimentaire chinois – dont le siège social avait déménagé en 2022 à Singapour pour tenter, en vain, d’être plus présentable en vue de son introduction en Bourse, à New-York ou à Londres – a renoncé à se faire coter en Occident faute notamment d’un feu vert de la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Shein se prépare donc à déménager sa maison mère en Chine, afin d’envisager une cotation à probablement Hong Kong (1). L’Occident est hostile à l’entreprise, médias et concurrents l’accusant d’« ultra-fast fashion », de « concurrence déloyale », et, de « travail indigne » ou de « faire travailler des enfants » en Chine où sont produits ses vêtements – ce que Donald Tang réfute.
Cela fait quatre ans presque jour pour jour que Donald Tang (photo) a été recruté par le groupe chinois Shein. Après avoir été conseiller du PDG fondateur Chris Xu, l’ex-banquier d’affaire sino-américain est monté en grade pour devenir en août 2023 président exécutif du géant mondial du e-commerce de vêtement et d’accessoires de mode. Si son patron sino-singapourien, dénommé aussi Sky Xu, se fait très discret, Donald Tang, lui, fait office de porte-parole de l’enseigne Shein en tant que représentant mondial, avec des casquettes aussi différentes que président exécutif, responsable des affaires publiques, directeur de la stratégie ou encore chargé du développement international. Fondé en 2008 à Nankin (Chine), le groupe vestimentaire chinois – dont le siège social avait déménagé en 2022 à Singapour pour tenter, en vain, d’être plus présentable en vue de son introduction en Bourse, à New-York ou à Londres – a renoncé à se faire coter en Occident faute notamment d’un feu vert de la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Shein se prépare donc à déménager sa maison mère en Chine, afin d’envisager une cotation à probablement Hong Kong (1). L’Occident est hostile à l’entreprise, médias et concurrents l’accusant d’« ultra-fast fashion », de « concurrence déloyale », et, de « travail indigne » ou de « faire travailler des enfants » en Chine où sont produits ses vêtements – ce que Donald Tang réfute.
Donald Tang, en première ligne en France
« Nous ne sommes pas de la fast fashion », avait lancé le président exécutif de Shein, lors de son intervention sur scène à Paris le 13 juin dernier au salon-conférence Viva Technology. « Nous sommes une entreprise de fashion-on-demand », assurait-il, alors que trois jours auparavant la France venait d’adopter au Sénat une proposition de loi pour « réduire l’impact environnemental de l’industrie textile » – texte notifié par le gouvernement à la Commission européenne avant son passage à l’Assemblée nationale (2). Donald Tang avait tourné en dérision les attaques dont Shein est la cible : « Il y a vingt ans, le diable avait l’habitude de porter du Prada, mais maintenant, il commence à porter du Shein », plaisanta-t-il alors (3). Mais l’ouverture controversée le 5 novembre du premier magasin permanent de Shein – à Paris au sein du BHV avec son portrait en devanture (4), et sur fond d’accusation de vente en ligne de poupées pédopornographiques et d’armes (5) – l’a remis en France sous le feu des projecteurs.
Son rêve hollywoodien sino-américain
A 62 ans, Donald Tang – né Tang Xiangqian à Shanghai de parents chinois universitaires – a fait du chemin depuis Continuer la lecture

 Le projet de législation spatiale pour l’Union européenne (UE), le « Space Act » présenté le 25 juin 2025 par la Commission européenne, affiche clairement son ambition de doter l’Europe – avant 2030 – d’un cadre normatif unifié régissant les activités spatiales civiles et commerciales. Attendu depuis plusieurs années, ce texte s’inscrit dans un contexte de profonde mutation du secteur spatial, marqué par l’essor d’acteurs privés, la multiplication des lancements, la congestion des orbites et la montée en puissance de nouvelles nations spatiales hors Europe.
Le projet de législation spatiale pour l’Union européenne (UE), le « Space Act » présenté le 25 juin 2025 par la Commission européenne, affiche clairement son ambition de doter l’Europe – avant 2030 – d’un cadre normatif unifié régissant les activités spatiales civiles et commerciales. Attendu depuis plusieurs années, ce texte s’inscrit dans un contexte de profonde mutation du secteur spatial, marqué par l’essor d’acteurs privés, la multiplication des lancements, la congestion des orbites et la montée en puissance de nouvelles nations spatiales hors Europe.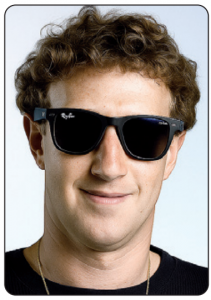 Meta, Snap, Xiaomi, Alibaba, TCL-RayNeo, Kopin Solos, Thunderobot, Google, Samsung, Apple, … La concurrence s’intensifie sur le marché mondial des lunettes connectées. Dix ans après l’échec des Google Glass, les fabricants américains et asiatiques s’y bousculent. Le groupe Meta Platforms, qui s’est associé sur plusieurs années avec le franco-italien EssilorLuxottica pour créer les Ray-Ban Stories en 2021 et les Ray-Ban Meta en 2023, mène la danse et s’apprête à lancer le 17 septembre une nouvelle paire boostée à l’intelligence artificielle.
Meta, Snap, Xiaomi, Alibaba, TCL-RayNeo, Kopin Solos, Thunderobot, Google, Samsung, Apple, … La concurrence s’intensifie sur le marché mondial des lunettes connectées. Dix ans après l’échec des Google Glass, les fabricants américains et asiatiques s’y bousculent. Le groupe Meta Platforms, qui s’est associé sur plusieurs années avec le franco-italien EssilorLuxottica pour créer les Ray-Ban Stories en 2021 et les Ray-Ban Meta en 2023, mène la danse et s’apprête à lancer le 17 septembre une nouvelle paire boostée à l’intelligence artificielle. Si les 29,4 millions de foyers français n’ont plus à payer depuis quatre années de « contribution à l’audiovisuel public » (nom officiel de l’ancienne redevance audiovisuelle), ce qui rapportait à France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (France 24, RFI, MCD), ArteFrance, TV5 Monde et l’INA, de 3,2 milliards d’euros en 2022 à plus de 4,1 milliards d’euros en 2013, ils se retrouvent à dépenser plus d’argent pour s’offrir des contenus audiovisuels. Ainsi, rien que sur l’année 2024, les Français ont payé très exactement 11,385 milliards d’euros (
Si les 29,4 millions de foyers français n’ont plus à payer depuis quatre années de « contribution à l’audiovisuel public » (nom officiel de l’ancienne redevance audiovisuelle), ce qui rapportait à France Télévisions, Radio France, France Médias Monde (France 24, RFI, MCD), ArteFrance, TV5 Monde et l’INA, de 3,2 milliards d’euros en 2022 à plus de 4,1 milliards d’euros en 2013, ils se retrouvent à dépenser plus d’argent pour s’offrir des contenus audiovisuels. Ainsi, rien que sur l’année 2024, les Français ont payé très exactement 11,385 milliards d’euros (