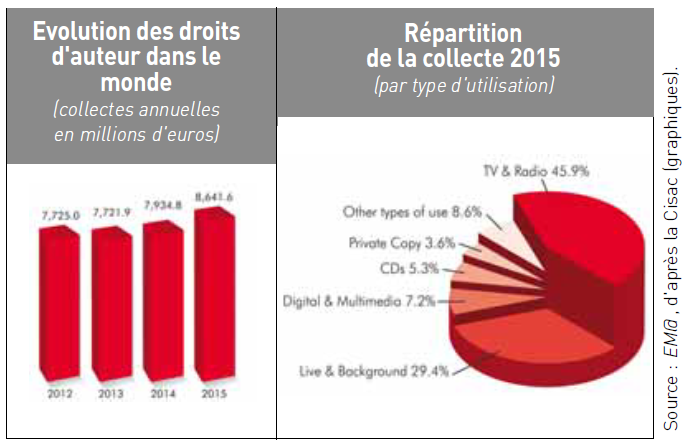Si le législateur a su donner au juge des outils pour lutter contre les pirates, ces outils ne sont cependant pas toujours adaptés, notamment lors de diffusions en direct – comme dans le sport – ou pour les nouveautés. A quoi bon condamner un pirate si la sanction ne peut être exécutée.
Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.
 Un des aspects de la révolution numérique, qui a bouleversé notre société, est la dématérialisation. Du fait de la facilité de la transmission du support, la piraterie audiovisuelle « professionnelle » s’est largement répandue. Il s’agit d’un poison mortel pour la création culturelle et pour le monde du divertissement. Le pirate professionnel est celui qui met à la disposition du public, sans autorisation, une oeuvre ou un événement protégé et qui tire un revenu ou un avantage direct de son activité par exemple, par abonnement ou par la publicité.
Un des aspects de la révolution numérique, qui a bouleversé notre société, est la dématérialisation. Du fait de la facilité de la transmission du support, la piraterie audiovisuelle « professionnelle » s’est largement répandue. Il s’agit d’un poison mortel pour la création culturelle et pour le monde du divertissement. Le pirate professionnel est celui qui met à la disposition du public, sans autorisation, une oeuvre ou un événement protégé et qui tire un revenu ou un avantage direct de son activité par exemple, par abonnement ou par la publicité.
Réponse judiciaire ou prévention ?
Cette piraterie lucrative a pu prospérer à la faveur de certaines particularités du numérique : disparition des frontières, concurrence de droits applicables et anonymat qui rendent difficiles la poursuite et l’exécution de la décision. La réponse judiciaire est cependant réelle comme l’illustre une série de décisions récentes qui condamnent, parfois lourdement, ces flibustiers (1) du Net.
• En Juillet 2015, l’administrateur français du site Wawa Mania, qui mettait à disposition du public 3.600 œuvres cinématographiques, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme et à indemniser les parties civiles à hauteur de 15 millions d’euros.
• En octobre 2015, l’administrateur français du site GKS, qui a permis entre 2012 et 2014 de télécharger sans autorisation des œuvres appartenant au répertoire de la Sacem/SDRM (2.240 albums de musiques, 240 concerts) et 242.279 Téraoctets d’œuvres cinématographiques, a été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle à six mois de prison avec sursis et à indemniser les onze parties civiles à hauteur d’un montant de presque 2,9 millions d’euros.
• En septembre 2016, l’administrateur français du site OMG-Torrent, qui mettait à disposition du public des liens permettant de télécharger sans autorisation des œuvres (musiques, films, séries et des jeux vidéo), a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en- Champagne (Marne) à un an de prison dont huit mois ferme et à indemniser les parties civiles à hauteur de 5 millions d’euros.
• En Janvier 2017, cinq personnes qui proposaient aux particuliers, via des sites de vente en ligne entre 2008 et 2010, des systèmes d’exploitation Windows XP hors licence ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à des peines d’emprisonnement allant de douze à dix-huit mois de prison avec sursis et à payer à Microsoft 4,6 millions d’euros.
Il apparaît donc clairement, qu’en cas de piraterie, le juge sanctionne la faute commise vis-à-vis du titulaire des droits piratés et ordonne la réparation du préjudice subi. Cependant, il s’agit souvent d’une victoire « sur le papier » – voire à la Pyrrhus tant
les pertes du vainqueur peuvent être élevées – dès lors qu’il est rare que ces condamnations pécuniaires soient effectivement recouvrées, et ce pour de nombreuses raisons : soit parce que l’on est en présence d’un pirate qui a externalisé son patrimoine, soit parce qu’il était prodigue (comprenez qu’il a tout dépensé), ou soit encore qu’il a vendu les œuvres d’autrui à vil prix. Dans ces conditions, l’essentiel des efforts ne devrait-il pas porter sur la prévention des actes de piraterie ? Ce serait donc au législateur d’intervenir en amont pour donner les outils nécessaires aux titulaires des droits pour prévenir le piratage plutôt que de confier au juge le soin de le réprimer.
Dans le domaine des droits piratés, les droits sportifs sont fortement convoités. Cela crée un préjudice important au titulaire des droits sportifs et entraîne un cercle vicieux dans l’économie du sport : la piraterie provoque une baisse des revenus, qui entraîne une baisse des ressources, laquelle se traduit par une baisse de la qualité de la compétition, etc.
Procédures inadaptées aux diffusions live
Conscients de ces difficultés, des sénateurs ont tenté d’endiguer la piraterie en amont dans une proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (2). A cette occasion, un amendement avait été adopté, en octobre 2016 en première lecture, afin que les acteurs du numérique et les titulaires de droits sportifs « établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur Internet, ainsi que les bonnes pratiques y
afférant » (3). Cette démarche était inspirée par un souci pratique. Les procédures de lutte contre la piraterie – mises en demeure, référés, requêtes ; etc. – ne sont pas adaptées à la diffusion d’événements sportifs en direct. Malheureusement, au cours de la navette avec l’Assemblée nationale, cette obligation de conclure a été transformée en possibilité de conclure.
Contre le piratage, mais pas de filtrage
La version actuelle du texte, modifiée par les députés et transmise au Sénat le 12 janvier dernier pour une deuxième lecture à partir du 15 février prochain (4), prévoit que les parties concernées « peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives ». Dans son rapport fait au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’Education de l’Assemblée nationale, déposé le 6 décembre 2016 (5), la députée Jeanine Dubié, précise que
« l’accord ne saurait prévoir des mesures de filtrage, de retrait ou de déréférencement sans méconnaître les dispositions des articles 12.3, 13.2 et 14.3 de la directive 2000/31 [dite « Commerce électronique », ndlr (6)] qui réserve à une juridiction ou à une autorité administrative lorsqu’il s’agit “d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation”. L’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a transposé la directive en confiant cette compétence à l’autorité judiciaire » (7).
Selon cet article 6.I.8 de la loi LCEN (8), l’autorité judiciaire peut prescrire – en référé ou sur requête, à tous prestataires techniques – toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Si la remarque de la députée est fondée en droit, elle ne l’est pas en fait. En pratique, pour un match de football de 90 minutes, qui est piraté en direct sur Internet, l’outil juridique du référé ou de la requête n’est pas adapté pour faire cesser l’infraction, surtout lorsque le site pirate se trouve à l’étranger ou qu’il n’indique pas où se trouve son siège social, et ce en infraction avec la législation française (9). La députée avance une autre raison : l’accord « ne peut pas non plus prévoir de ‘’dispositifs techniques de reconnaissance’’ dans la mesure où l’article 12 de la directive [« Commerce électronique »], transposé par l’article L. 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques, protège la neutralité du fournisseur d’accès quant aux contenus diffusés. De même, un tel dispositif serait contraire à l’article 15 de cette directive dont la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déduit l’interdiction de toute obligation générale de surveillance pour les fournisseurs d’accès ou d’hébergement » (10). Alors que cet accord avait été proposé par des sénateurs pour lutter contre la diffusion illicite de contenus sportifs, « en conformité avec le droit communautaire et notamment la directive [« Commerce électronique »]», les députés l’ont rendu optionnel … pour se conformer avec ladite directive. A ce stade, la victime du pirate se sent un peu démunie. La solution judicaire n’est pas assez souple pour prévenir un acte de piraterie et le législateur prétend que seul le juge est compétent… S’il y a effectivement un obstacle, il n’est pas insurmontable. L’essor du numérique et les espoirs économiques mis dans ce nouveau marché nécessitent un nouvel arbitrage.
Oui, l’intervention du juge est nécessaire, mais, outre le fait qu’une procédure est longue et coûteuse, nous arrivons dans une situation paradoxale où la nécessaire intervention du juge judiciaire permet, de fait, la réalisation du dommage et l’impunité momentanée du pirate. Sans remettre en cause les grands équilibres des textes européens, ne conviendrait-il pas de créer un régime dérogatoire pour la diffusion en direct des événements (comme les compétitions sportives) ou pour les œuvres (comme un film) qui viennent d’être communiqués au public (et ce, par exemple, pendant un délai d’un mois à compter de la première diffusion sur le territoire) ?
Créer un système de requête en ligne
Pour cette catégorie de droits uniquement, il pourrait être demandé à un juge, par un système à créer de requête en ligne (indiquant que X certifie être titulaire des droits, que Y exploite les droits sans autorisation) de rendre, par retour, une ordonnance provisoire enjoignant aux prestataires Internet basés en France de rendre tel URL inaccessible pendant un certain délai. Toujours pour cette catégorie de droits, il pourrait aussi être prévu par la loi que les titulaires de droits puissent imposer, à leurs risques et périls, aux prestataires techniques de prendre des mesures d’exclusion des pirates, sauf à répondre devant le juge judiciaire de l’abus de telles demandes.
Plutôt que de poursuivre – en vain – des pirates, surtout lors de diffusions en direct ou pour les nouvelles diffusions, il faut donc inventer un arsenal juridique préventif. @