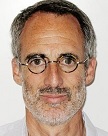En fait. Le 15 février, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a tenu la première réunion de l’année sur l’évolution de la chronologie des médias. La VOD achetée à l’acte pourrait être ramenée à 3 mois, tandis que la SVOD passerait à 30 mois, voire 27 mois s’il y a cofinancement du film.
En clair. De la énième mouture du « projet d’avenant n° 1 à l’accord du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias », que prépare actuellement le CNC à la suite de la réunion interprofessionnelle du 15 février, dépend l’avenir de la vidéo à la demande (VOD) et de son pendant par abonnement (SVOD). Si la première bénéficiait des nouveaux films 3 mois après leur sortie en salles en cas d’achat définitif (au lieu des 4 mois actuellement, auxquels resterait la location) et si la seconde passait à 30 mois (au lieu des 36 mois en vigueur) voire à 27 mois en cas de contribution au financement du film (plateforme « vertueuse »), c’est tout le marché du cinéma à la demande qui y gagnerait enfin.
Car, pour l’heure, force est de constater que le chiffre d’affaires global en France de la VOD – comprenant la VOD locative à l’acte, la VOD à l’acte d’achat définitif (appelée EST pour Electronic Sell-Through) et la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) – progresse encore lentement. D’après l’institut d’étude GfK, sa croissance n’a été que de 9 % l’an dernier à 344 millions d’euros (voir graphique p. 10). La VOD locative à l’acte subit, elle, un recul de 3% à 167 millions d’euros.