Dans la torpeur de l’été, la Commission européenne a annoncé le 27 juillet avoir ouvert une enquête à l’encontre de Microsoft soupçonné de « vente liée ou groupée » avec son logiciel Teams. La firme de Redmond est coutumière du fait, malgré ses amendes « Mediaplayer » et « Internet Explorer ».
 « Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé (1) (*) (**).
« Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé (1) (*) (**).
21 milliards de dollars d’amende ?
En cas d’infraction aux règles antitrust, telle qu’un abus de position dominante, Microsoft risque de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires total. Clos le 30 juin dernier, son précédent exercice annuel affiche un total de 211,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Le risque de sanction pécuniaire dans cette affaire « Teams » est potentiellement de plus de… 21 milliards de dollars. « Microsoft inclut Teams dans ses suites de productivité cloud bien ancrées pour les clients professionnels Office 365 et Microsoft 365 », a constaté la Commission européenne auprès de laquelle la société américaine Slack Technologies – éditrice de la plateforme de messagerie instantanée du même nom et propriété depuis plus de deux ans du groupe Salesforce – avait porté plainte le 14 juillet 2020.

 La liberté d’expression risque gros en Europe depuis le 25 août 2023, date à laquelle les 19 très grandes plateformes numériques – Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, et Google Search – doivent appliquer à la lettre le Digital Services Act (DSA), sous peine d’être sanctionnées financièrement jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial.
La liberté d’expression risque gros en Europe depuis le 25 août 2023, date à laquelle les 19 très grandes plateformes numériques – Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing, et Google Search – doivent appliquer à la lettre le Digital Services Act (DSA), sous peine d’être sanctionnées financièrement jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial.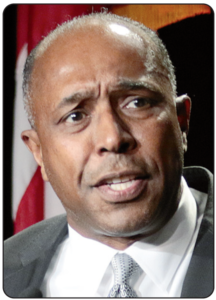 Le 21 août, YouTube a annoncé un accord avec Universal Music autour de l’IA musicale. Le Financial Times avait par ailleurs révélé le 9 août que sa maison mère Google et la première major mondiale de la musique enregistrée étaient en pourparlers pour autoriser que les mélodies et les voix des artistes soient exploitées par l’intelligence artificielle MusicLM (développée par Google) afin que celle-ci puisse créer de nouvelles chansons. Si ces négociations devaient aboutir, un accord de ce type serait une première pour l’industrie musicale qui, jusqu’à maintenant, voient plus ces IA génératives de musiques comme une menace pour elle.
Le 21 août, YouTube a annoncé un accord avec Universal Music autour de l’IA musicale. Le Financial Times avait par ailleurs révélé le 9 août que sa maison mère Google et la première major mondiale de la musique enregistrée étaient en pourparlers pour autoriser que les mélodies et les voix des artistes soient exploitées par l’intelligence artificielle MusicLM (développée par Google) afin que celle-ci puisse créer de nouvelles chansons. Si ces négociations devaient aboutir, un accord de ce type serait une première pour l’industrie musicale qui, jusqu’à maintenant, voient plus ces IA génératives de musiques comme une menace pour elle. Souvenez-vous. Elon Musk avait annoncé la couleur en mai dernier avec la nomination de Linda Yaccarino (photo) à la tête de X Corp (ex- Twitter) : « Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! @LindaYacc [son ancien compte devenu depuis @lindayaX, ndlr] se concentrera principalement sur les opérations commerciales, et moi sur la conception de produits et les nouvelles technologies. Au plaisir de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme en X, l’application universelle » (
Souvenez-vous. Elon Musk avait annoncé la couleur en mai dernier avec la nomination de Linda Yaccarino (photo) à la tête de X Corp (ex- Twitter) : « Je suis ravi d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! @LindaYacc [son ancien compte devenu depuis @lindayaX, ndlr] se concentrera principalement sur les opérations commerciales, et moi sur la conception de produits et les nouvelles technologies. Au plaisir de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme en X, l’application universelle » (