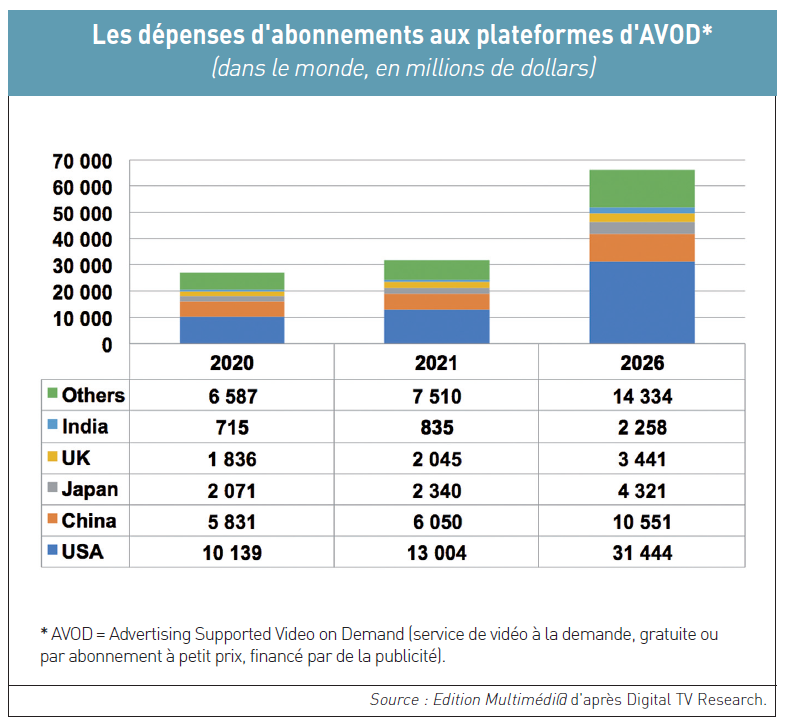La fin prochaine des cookies, et autres traceurs publicitaire intrusifs sur les terminaux des internautes pris pour cibles, a ouvert la voie à la publicité contextuelle. C’est aussi une alternative à l’exploitation des données personnelles des utilisateurs. Des adtech comme Seedtag relèvent le défi.
 « La publicité contextuelle est une technique publicitaire qui vise à diffuser sur un support (web, télévision) des publicités choisies en fonction du contexte dans lequel le contenu publicitaire est inséré », définit la Cnil sur son site web (1). Avantage : le ciblage contextuel ne nécessite pas d’avoir des informations sur la personne regardant la publicité, ni de collecter des données personnelles la concernant. Bref, c’est l’arme anti-cookie et anti-data par excellence. Des adtech comme l’espagnole Seedtag s’en sont fait une spécialité, devançant notamment le champion français des cookies, Criteo (2), qui tente de pivoter dans le contextuel.
« La publicité contextuelle est une technique publicitaire qui vise à diffuser sur un support (web, télévision) des publicités choisies en fonction du contexte dans lequel le contenu publicitaire est inséré », définit la Cnil sur son site web (1). Avantage : le ciblage contextuel ne nécessite pas d’avoir des informations sur la personne regardant la publicité, ni de collecter des données personnelles la concernant. Bref, c’est l’arme anti-cookie et anti-data par excellence. Des adtech comme l’espagnole Seedtag s’en sont fait une spécialité, devançant notamment le champion français des cookies, Criteo (2), qui tente de pivoter dans le contextuel.
Seedtag, « n°1 mondial » du contextuel
La start-up Seedtag, fondée en 2014 par deux anciens de chez Google, Jorge Poyatos (photo de gauche) et Albert Nieto (photo de droite), a créé une intelligence artificielle contextuelle – baptisée Liz – qui permet aux annonceurs de « toucher les consommateurs en fonction de leurs intérêts sans utiliser aucune donnée personnelle ». Ayant son siège social à Madrid, cette licorne en puissance se déploie à l’international, tant en Europe qu’aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Fin juillet, elle a annoncé avoir levé 250 millions d’euros auprès du fonds américain Advent International. Celui-ci rejoint d’autres investisseurs institutionnels déjà présents dans Seedtag, à savoir Oakley Capital, Adara Ventures et All Iron Ventures. Objectif : « Faire évoluer le secteur de la publicité digitale à plus grande échelle », notamment outre-Atlantique.
Seedtag se revendique déjà comme étant « le numéro un en Europe et en Amérique Latine dans la publicité contextuelle ». S’étant d’abord développé dans la publicité intégrée au sein des images illustrant des articles (in-image advertising), Seedtag a ensuite élargi son offre à la vidéo (outstream) et aux bannières (display). Pour se hisser à la première place de ce marché dynamique, la start-up madrilène rachète certains de ses concurrents : la société italienne AtomikAd est tombée dans son escarcelle en novembre 2020, suivie de l’allemand Recognified en février 2021, puis du français KMTX en juillet 2022. En plus de son IA contextuelle, Liz, Seedtag ajoute ainsi des cordes à son arc pour mieux cibler les internautes sans recourir aux cookies ni exploiter leurs données, ni les suivre à la trace dans leurs navigations sur le Web. Ses outils alternatifs vont du placement in-content jusqu’à l’automatisation des performances marketing (apprentissage automatique). « En diffusant des publicités dans le contenu, nous tirons pleinement parti de l’attention des utilisateurs : selon l’eye-tracking [oculométrie en français, à savoir le suivi des mouvements des yeux sur un écran, ndlr] les publicités intégrées au contenu captent l’attention plus rapidement et la retiennent plus longtemps ».
Cette optimisation du ciblage publicitaire cookie-free est obtenue par la « lecture » approfondie des contenus des pages pour obtenir le meilleur résultat pour l’annonceur. De grandes marques telles que Microsoft, LG, Heineken, Nestlé, Renault, Unilever, Levi’s, Forbes, Marie-Claire, Vanity Fair ou encore Sky Sport font partie du portefeuille de clients de Seedtag. Par exemple, la filiale française dirigée par Clarisse Madern a renouvelé en début d’année des partenariats avec des éditeurs tels que CMI (Elle, Marianne, Télé 7 jours, …), Prisma Media (Capital, Gala, Geo, …), Lagardère Publicité News et Reworld Media.
En mai dernier, avec l’appui d’une étude de l’institut marketing Nielsen réalité auprès de 1.800 consommateurs au Royaume-Uni, Seedtag a démontré que le ciblage contextuel était bien plus accepté que le ciblage utilisant leurs données personnelles : « Les consommateurs étaient 2,5 fois plus intéressés par la publicité contextuelle que lorsqu’il la publicité n’est pas ciblée. De plus, les résultats ont montré que les personnes qui ont vu des publicités contextuelles étaient 32 % plus susceptibles de passer l’action après avoir vu la publicité. Les consommateurs ciblés en fonction du contexte se sont sentis 40 % plus enthousiastes à l’égard de la catégorie [du message publicitaire] que ceux ciblés sur le plan démographique et 28 % plus enthousiastes que ceux ciblés uniquement en raison de leur intérêt dans la catégorie » (3).
Les navigateurs deviennent cookieless
En début d’année, dans le cadre de ses tests pour sa solution alternative « Privacy Sandbox », Google avait annoncé la fin des cookies tiers sur son navigateur Chrome d’ici à fin 2023 (4), au lieu de 2022 initialement prévu. Alors qu’Apple avec Safari et Mozilla avec Firefox sont déjà cookieless (5), la filiale d’Alphabet a dû prolonger les tests : « Nous avons maintenant l’intention de commencer à éliminer progressivement les cookies tiers dans Chrome dans la seconde moitié de l’année 2024 », a-t-elle indiqué le 27 juillet dernier (6). @
Charles de Laubier