Retour sur les prévisions de croissance pour 2026 avancées par le Forum économique mondial (WEF), qui s’est tenu à Davos du 19 au 23 janvier. L’IA a contraint les économistes en chef à revoir leurs chiffres, sans vraiment savoir sur quel pied danser : entre optimisme et inquiétude.
 « Avec 53 % des chefs de l’économie s’attendant à un affaiblissement de la conjoncture économique mondiale, 28 % ne prévoyant aucun changement et 19 % tablant sur une économie plus vigoureuse, les perspectives pour l’économie mondiale sont négatives pour l’année [2026], même si le sentiment s’est amélioré par rapport aux prévisions de l’an dernier. […] A moyen terme, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) reste une source clé d’opportunités et de risques pour l’économie mondiale. », a résumé le Forum économique mondial (WEF), dans son rapport sur les perspectives des économistes en chef. Ils sont 75 cette année à avoir livré leur analyse.
« Avec 53 % des chefs de l’économie s’attendant à un affaiblissement de la conjoncture économique mondiale, 28 % ne prévoyant aucun changement et 19 % tablant sur une économie plus vigoureuse, les perspectives pour l’économie mondiale sont négatives pour l’année [2026], même si le sentiment s’est amélioré par rapport aux prévisions de l’an dernier. […] A moyen terme, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) reste une source clé d’opportunités et de risques pour l’économie mondiale. », a résumé le Forum économique mondial (WEF), dans son rapport sur les perspectives des économistes en chef. Ils sont 75 cette année à avoir livré leur analyse.
Les conséquences incertaines de l’IA
Bien que 53 % des économistes en chef s’attendent encore, en janvier 2026, à ce que les perspectives mondiales s’affaiblissent au cours de cette nouvelle année, il s’agit d’une amélioration par rapport aux 72 % d’entre eux qui s’attendaient, en septembre 2025, à ce résultat. Ce regain d’optimisme, même s’il n’est pas consensuel, trouve sa source dans la déferlante de l’intelligence artificielle. « L’adoption rapide de l’IA se distingue à la fois comme une source d’optimisme et un catalyseur de perturbation. Bien que le potentiel d’améliorations importantes de la productivité soit largement reconnu, le rythme et la répartition de ces avantages devraient varier considérablement selon les régions, les industries et la taille des entreprises », nuancent ces économistes en chef dans leur Chief Economists’ Outlook (1), dont le Français Pierre Olivier Gourinchas (photo), chef économiste du Fonds monétaire international (FMI). Quant à l’impact de l’IA sur l’emploi, il reste incertain à leurs yeux, exprimant des opinions divergentes à long terme mais s’accordant sur « une perturbation modeste prévue à court terme ».
Alors que les Etats-Unis connaissent une augmentation des investissements dans l’infrastructure de l’IA et des centres de données, cela alimente « les espoirs d’une relance de la productivité », même si « des questions persistent sur la portée et la durabilité de ces gains ». La quasi-totalité (97 %) des chefs économistes interrogés s’attendent à ce que (suite)

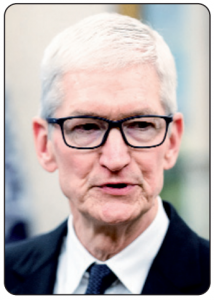 La coalition française formée par l’Alliance Digitale, le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam) est mobilisée depuis 2020 contre l’« ATT » d’Apple, comprenez l’App Tracking Transparency – le mécanisme de la Pomme imposant aux éditeurs le consentement de leurs utilisateurs si ces premiers – éditeurs, régies, annonceurs et partenaires technologiques – veulent accéder à l’identifiant publicitaire (IDFA) du fabricant des iPhone et des iPad, pour suivre les seconds.
La coalition française formée par l’Alliance Digitale, le Groupement des éditeurs de services en ligne (Geste), le Syndicat des régies Internet (SRI) et l’Union des entreprises de conseil et d’achat médias (Udecam) est mobilisée depuis 2020 contre l’« ATT » d’Apple, comprenez l’App Tracking Transparency – le mécanisme de la Pomme imposant aux éditeurs le consentement de leurs utilisateurs si ces premiers – éditeurs, régies, annonceurs et partenaires technologiques – veulent accéder à l’identifiant publicitaire (IDFA) du fabricant des iPhone et des iPad, pour suivre les seconds. « Le prochain voyage, la prochaine ère pour les systèmes robotiques, ce sera les robots, et ces robots viendront dans toutes sortes de tailles différentes », a lancé Jensen Huang (photo), le PDG fondateur de Nvidia, lors de son intervention ultramédiatisée au CES 2026 de Las Vegas, le 5 janvier, où ont évolué sur scène à ses côtés de petits robots humanoïdes dignes de la saga Star Wars (R2-D2, C-3PO, …), ainsi que le robot infirmier Nurabot développé par le taïwanais Foxconn avec Nvidia et Kawasaki. Agibot du chinois Zhiyuan Robotics et Chenille du sud-coréen LG Electronics étaient aussi de la partie (
« Le prochain voyage, la prochaine ère pour les systèmes robotiques, ce sera les robots, et ces robots viendront dans toutes sortes de tailles différentes », a lancé Jensen Huang (photo), le PDG fondateur de Nvidia, lors de son intervention ultramédiatisée au CES 2026 de Las Vegas, le 5 janvier, où ont évolué sur scène à ses côtés de petits robots humanoïdes dignes de la saga Star Wars (R2-D2, C-3PO, …), ainsi que le robot infirmier Nurabot développé par le taïwanais Foxconn avec Nvidia et Kawasaki. Agibot du chinois Zhiyuan Robotics et Chenille du sud-coréen LG Electronics étaient aussi de la partie (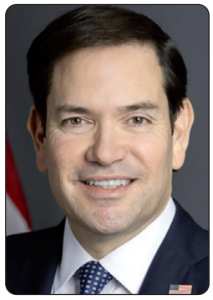 « Le département d’Etat [américain] prend des mesures décisives contre cinq individus qui ont mené des efforts organisés pour contraindre les plateformes américaines à censurer, démonétiser et réprimer les points de vue américains auxquels elles s’opposent. Ces militants radicaux et ces ONG militarisées ont favorisé la répression de la censure par des Etats étrangers — dans chaque cas ciblant les orateurs américains et les entreprises américaines », avait lancé sans retenue Marco Rubio (photo), le secrétaire d’Etat américain à Washington (
« Le département d’Etat [américain] prend des mesures décisives contre cinq individus qui ont mené des efforts organisés pour contraindre les plateformes américaines à censurer, démonétiser et réprimer les points de vue américains auxquels elles s’opposent. Ces militants radicaux et ces ONG militarisées ont favorisé la répression de la censure par des Etats étrangers — dans chaque cas ciblant les orateurs américains et les entreprises américaines », avait lancé sans retenue Marco Rubio (photo), le secrétaire d’Etat américain à Washington (