Dix mois après la fin des Etats généraux de l’information (EGI), le texte de loi promis par la ministre de la Culture Rachida Dati – censé en reprendre les recommandations – verra-t-il le jour avant l’entrée en application, le 8 août 2025, du règlement européen sur la liberté des médias (EMFA) ?
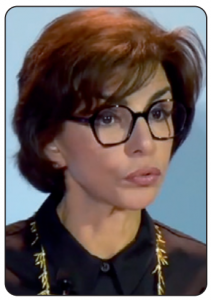 « Bonjour Madame Rachida Dati, j’imagine que vous êtes au courant, mais votre projet de holding pour l’audiovisuel public vient d’être rejeté [le 30 juin 2025] à l’Assemblée nationale [où cette proposition de loi reviendra en deuxième lecture en septembre, après un vote bloqué au Sénat le 11 juillet dernier, ndlr]. […] Mais vous pouvez en tirer du positif : votre défaite n’est-elle pas l’occasion de vous mettre au travail à la suite des Etats généraux de l’information et de réfléchir enfin aux conditions d’indépendance des rédactions dans les médias privés ? ». C’est ainsi que l’économiste Julia Cagé et professeure à Sciences Po a interpellé la ministre de la Culture (photo), dans un post publié sur LinkedIn le 1er juillet (1).
« Bonjour Madame Rachida Dati, j’imagine que vous êtes au courant, mais votre projet de holding pour l’audiovisuel public vient d’être rejeté [le 30 juin 2025] à l’Assemblée nationale [où cette proposition de loi reviendra en deuxième lecture en septembre, après un vote bloqué au Sénat le 11 juillet dernier, ndlr]. […] Mais vous pouvez en tirer du positif : votre défaite n’est-elle pas l’occasion de vous mettre au travail à la suite des Etats généraux de l’information et de réfléchir enfin aux conditions d’indépendance des rédactions dans les médias privés ? ». C’est ainsi que l’économiste Julia Cagé et professeure à Sciences Po a interpellé la ministre de la Culture (photo), dans un post publié sur LinkedIn le 1er juillet (1).
Projet de loi « EGI » avant le 8 août ?
Il s’est écoulé dix mois depuis la fin des Etats généraux de l’information (EGI), avec la restitution publique le 12 septembre 2024 au Conseil économique, social et environnemental (Cese) de la quinzaine de recommandations faites pour renforcer le pluralisme, la transparence et l’indépendance des médias en France : transparence sur les actionnaires des médias et leur gouvernance, comités d’éthique, chartes déontologiques, administrateurs indépendants, journalistes associés à la prise de décisions, secret des sources, droits voisins, éducation aux médias, … Le gouvernement tarde à donner suite aux EGI (voulus par Emmanuel Macron), dont le rapport de 352 pages (2) reste pour l’instant lettre morte.
Fin novembre 2024, lors d’un colloque sur l’audiovisuel organisé par le cabinet NPA, Rachida Dati avait assuré qu’il y aura « évidemment » un projet de loi dans la suite des EGI : « Mon intention est de reprendre l’exhaustivité des recommandations des Etats généraux de l’information », avait promis la ministre de la Culture, après avoir évoqué les grandes lignes du (suite)

 C’est une première historique. Après l’avoir annoncée le 1er juillet par un communiqué puis présentée avec ses trois tarifs le 10 juillet lors d’une conférence de presse, la plateforme TV digitale de la Ligue de football professionnel (LFP) diffusera ses premiers matchs à partir du 15 août 2025. Baptisée « Ligue 1+ », cette « chaîne » numérique est gérée et opérée par la filiale LFP Media (alias LFP 1), dont le directeur général depuis avril (
C’est une première historique. Après l’avoir annoncée le 1er juillet par un communiqué puis présentée avec ses trois tarifs le 10 juillet lors d’une conférence de presse, la plateforme TV digitale de la Ligue de football professionnel (LFP) diffusera ses premiers matchs à partir du 15 août 2025. Baptisée « Ligue 1+ », cette « chaîne » numérique est gérée et opérée par la filiale LFP Media (alias LFP 1), dont le directeur général depuis avril ( « Nous serons toujours mobilisés pour défendre les piliers de notre exception culturelle », a assuré Rodolphe Belmer (photo de gauche), président de l’association La Filière audiovisuelle (LaFA), et par ailleurs PDG du groupe TF1, s’exprimant ainsi en préambule du livre blanc intitulé « L’exception culturelle française au défi du XXIe siècle » et publié par cette association le 27 juin 2025. Pour LaFA, cofondée huit mois plus tôt par le groupe public France Télévisions et les groupes privés de télévision TF1 et M6, avec des syndicats professionnels et des organismes de gestion collective, « l’exception culturelle française [est] un modèle unique et créateur de valeur » qu’il faut préserver.
« Nous serons toujours mobilisés pour défendre les piliers de notre exception culturelle », a assuré Rodolphe Belmer (photo de gauche), président de l’association La Filière audiovisuelle (LaFA), et par ailleurs PDG du groupe TF1, s’exprimant ainsi en préambule du livre blanc intitulé « L’exception culturelle française au défi du XXIe siècle » et publié par cette association le 27 juin 2025. Pour LaFA, cofondée huit mois plus tôt par le groupe public France Télévisions et les groupes privés de télévision TF1 et M6, avec des syndicats professionnels et des organismes de gestion collective, « l’exception culturelle française [est] un modèle unique et créateur de valeur » qu’il faut préserver. Le groupe Meta Platforms utilise depuis le 27 mai 2025 les données partagées publiquement par les utilisateurs majeurs et les comptes institutionnels sur ses services Facebook et Instagram (
Le groupe Meta Platforms utilise depuis le 27 mai 2025 les données partagées publiquement par les utilisateurs majeurs et les comptes institutionnels sur ses services Facebook et Instagram (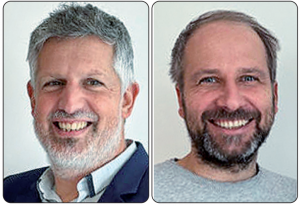 Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant.
Selon nos informations, Qwant livre discrètement depuis le mois d’avril en France des résultats – sur son moteur de recherche – issus de l’index web européen codéveloppé avec son partenaire allemand Ecosia, un autre moteur de recherche alternatif. « Nous avons démarré en avril 2025, en France seulement pour le moment, et nous progressons chaque mois : près d’une requête sur deux est servie depuis notre index européen », indique à Edition Multimédi@ Olivier Abecassis (photo de gauche), directeur général de Qwant.