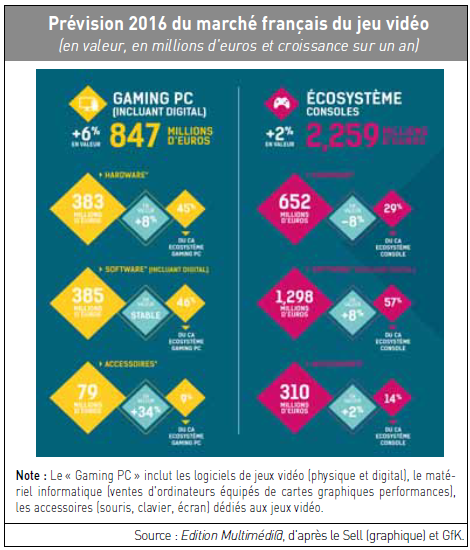Le modèle disruptif des plateformes collaboratives recherche son modèle de régulation. Plusieurs Etats européens, dont la France, ont pris des mesures encadrant le développement de ces plateformes collaboratives. Les préoccupations sont fortes sur les droits et les obligations de ces acteurs.
Par Christophe Clarenc (photo) et Martin Drago, cabinet Dunaud Clarenc Combles & Associés
 La Commission européenne a publié en juin dernier une communication présentant « un agenda européen pour l’économie collaborative » (1). Sous ce vocable d’économie collaborative (ou d’économie de partage), elle appréhende
La Commission européenne a publié en juin dernier une communication présentant « un agenda européen pour l’économie collaborative » (1). Sous ce vocable d’économie collaborative (ou d’économie de partage), elle appréhende
« des modèles économiques où des plateformes collaboratives qui créent un marché ouvert pour l’utilisation temporaire de biens et de services souvent produits ou fournis par des personnes privées ».
Un « brouillage des limites »
La Commission européenne distingue les trois catégories d’acteurs concernés : les prestataires de services partageant leurs actifs ou ressources, qui peuvent être des personnes privées proposant leurs services sur une base occasionnelle (« pairs »)
ou des prestataires intervenant à titre professionnel (« prestataires de services professionnels ») ; les utilisateurs de ces services ; et les plateformes en ligne
(« intermédiaires ») mettant en relation ces prestataires et ces utilisateurs et facilitant leurs transactions (« plateformes collaboratives »).
La Commission européenne introduit sa communication en soulignant : d’un côté, l’essor important de l’économie collaborative en termes de transactions, de parts de marchés et de revenus (2), ainsi que l’intérêt d’en favoriser le développement au regard de sa capacité contributive à la croissance et à l’emploi ; de l’autre côté, les multiples problèmes auxquels se retrouvent confrontés les opérateurs de marché en place et surtout les fortes incertitudes soulevées concernant les droits et obligations des acteurs de cette nouvelle économie. Elle reconnaît que l’économie collaborative génère un
« brouillage des limites » entre consommateurs et fournisseurs, entre salariés et travailleurs indépendants, entre fournisseurs professionnels et fournisseurs non professionnels, entre services de base de la société de l’information et services sous-jacents ou connexes, ce qui suscite une certaine incertitude sur les règles applicables. Sa communication vise à réduire cette incertitude et à assurer un « développement équilibré et durable » de l’économie collaborative au sein de l’Union européenne (UE) en apportant une série d’« orientations non contraignantes sur les modalités selon lesquelles il conviendrait d’appliquer le droit de l’UE en vigueur », et ce, afin de traiter les « problèmes- clés » (3) auxquels les pouvoirs publics et les acteurs du marché
sont confrontés.
La Commission européenne vise aussi et surtout à prévenir « une fragmentation réglementaire découlant d’approches divergentes au niveau national ou local » et à éviter « les zones grises réglementaires ». Ce qu’elle souligne dans son communiqué de presse du 2 juin : « Si nous laissons notre marché unique se fragmenter au niveau national voire au niveau local, l’Europe tout entière risque d’être perdante. […] Nous invitons les Etats membres à réexaminer leur réglementation sur la base de ces orientations, et nous sommes disposés à les aider dans ce processus ». Plusieurs
Etats membres, dont la France (voir encadré page suivante), ont en effet pris des mesures d’encadrement des plateformes en ligne. Les orientations de la Commission européenne sur les « exigences à satisfaire pour accéder au marché » distinguent les prestations de services par des professionnels, les prestations de services de pair à pair et les plateformes collaboratives.
Accès au marché
S’agissant des prestations de services par des professionnels, elle rappelle les limites et conditions posées par les libertés fondamentales du traité et de la directive
« Services » de 2006 (4).
Concernant les prestations de services de pair à pair, elle souligne que la législation de l’UE ne définit pas expressément à quel stade un pair devient un prestataire de services professionnels et que les Etats membres utilisent des critères différents pour distinguer services professionnels et services de pair à pair. Elle admet l’utilité de seuils (éventuellement sectoriels) fixés de manière raisonnable.
S’agissant des plateformes collaboratives, elle distingue entre la fourniture des services de base de la société de l’information proposés à titre d’intermédiaire entre les prestataires de services sous-jacents et leurs utilisateurs, tels que définis et régis par la directive « Commerce électronique » de 2000 (5), la fourniture de services d’assistance aux prestataires des services sous-jacents (facilités de paiement, couverture d’assurance, services après-vente) et la fourniture en propre de services sous-jacents (par exemple services de transport ou services de location de courtes durée).
Responsabilité des plateformes
A propos des services fournis par ces plateformes, la Commission européenne rappelle tout d’abord que les services de base de la société de l’information ne peuvent être soumis à aucun régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence équivalente. Elle indique ensuite que la fourniture de services sous-jacents peut être soumise aux exigences d’autorisation de la réglementation sectorielle correspondante et qu’une plateforme collaborative exerçant un contrôle ou une influence importants sur le prestataire de service sous-jacent doit pouvoir être considérée comme fournissant
le service sous-jacent. Elle précise enfin que la fourniture de services d’assistance
ne constitue pas en soi la preuve de l’existence d’un contrôle ou d’une influence importants, mais que « plus les plateformes collaboratives gèrent et organisent la sélection des prestataires sous-jacents ainsi que la manière dont ces services sous-jacents sont fournis, plus il devient évident que la plateforme collaborative peut être considérée comme fournissant elle-même également les services sous-jacents ».
Les orientations de la Commission européenne sur les « régimes de responsabilité » des plateformes collaboratives distinguent également entre les services intermédiaires de la société de l’information et les services connexes, accessoires ou sous-jacents. Les services intermédiaires de la société de l’information bénéficient de l’exemption
de responsabilité sur les informations stockées telle que prévue dans la directive commerce électronique, dès lors que le service conserve un caractère purement technique, automatique et passif sans contrôle ni connaissance des informations.
Cette exemption s’applique ainsi aux plateformes collaboratives pour leurs prestations de services d’hébergement. Elle est cependant limitée à ces prestations et ne s’applique pas à leurs services connexes, accessoires et sous-jacents. @
ZOOM
Le France encadre l’économie du partage depuis 2014
• Par la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur interdisant « tout service de mise en relation de personnes avec des particuliers qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux sans être
des entreprises de transport routier ou des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur » (6) – interdiction attaquée devant la Commission européenne par la société Uber ( le 17 février 2015. Uber devait faire de même contre
l’Allemagne et l’Espagne.
• Par la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, introduisant dans le Code de la consommation une obligation d’information, de loyauté et de transparence à l’égard de « toute personne dont l’activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service » (8) ;
• Par la loi de finances pour 2016, du 29 décembre 2015, prévoyant que ces intermédiaires « sont tenues [depuis le 1er juillet 2016, ndlr] de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire » (9) ;
• Par le projet de loi pour une République numérique (qui doit encore être adopté définitivement en septembre au Sénat) envisageant de soumettre les plateformes à une obligation d’information « loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation », à l’obligation de faire « apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle avec la personne référencée, d’un lien capitalistique avec elle ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent
le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés » et à une obligation de déclaration à l’administration fiscale un ensemble d’informations concernant leurs utilisateurs « présumés redevables de l’impôt en France au titre des revenus qu’ils perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme » (10) ;
• Par le rapport Terrasse sur l’économie collaborative remis en février 2016 au Premier ministre (11) , soulignant notamment que le régime juridique prévu par la directive sur le commerce électronique semble « de plus en plus inadapté au rôle actif que jouent les plateformes » et que « le régime de responsabilité des plateformes doit être redéfini au niveau européen ». @