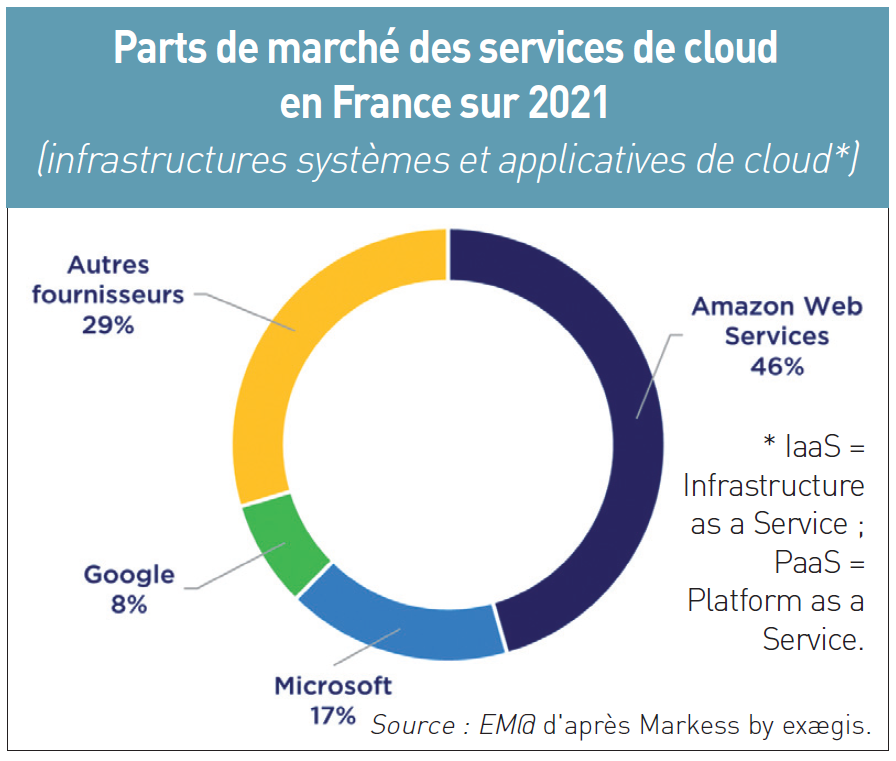Près de six ans après avoir lancé ses premiers smartphones Pixel, Google va-t-il enfin s’imposer en 2022 comme un grand fabricant de ces téléphones intelligents ? La filiale d’Alphabet semble avancer à pas comptés, sans doute pour ne pas gêner ses clients « Android », Samsung et Xiaomi en tête.

« Pixel 6 est un énorme pas en avant pour la gamme Pixel, et il a été formidable de voir la réponse des utilisateurs. C’est le Pixel qui se vend le plus vite et nous sensibilisons les consommateurs à la marque. Nous faisons de bons progrès. Je suis emballé par les produits que nous avons à venir », s’était félicité Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de sa filiale Google. C’était le 26 avril dernier, lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2022. Quinze jours après, lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O, il intervenait à nouveau pour vanter les atouts de la gamme Pixel qui s’étoffe.
Avec les prochains Pixel 7, le décollage ?
Plus de cinq ans et demi après avoir lancé ses premiers smartphones, en l’occurrence les modèles Pixel et Pixel X, Google est toujours loin d’apparaître dans le « Top 5 » des fabricants mondiaux de ces téléphones intelligents. La filiale d’Alphabet ne divulguant aucun chiffre de ventes de ces appareils, elle reste noyée dans la ligne « Autres », comme dans les classements des ventes de smartphones 2021 de Gartner (
1) et de IDC (
2). Mais avec les modèles Pixel 6 et Pixel 6 Pro lancés en octobre dernier, ses smartphones « les plus vendus à ce jour », Google semble vouloir accélérer sur ce marché hyperconcurrentiel, quitte à grignoter des parts de marché – si minimes soient-elles pour l’instant – à ses propres clients de son système d’exploitation pour mobile Android. A savoir : le sud-coréen Samsung, éternel numéro un mondial des smartphones (
3), les chinois Xiaomi, Oppo et Vivo, et d’autres.
La conférence Google I/O des 11 et 12 mai derniers a été l’occasion de dévoiler le smartphone Pixel 6a qui sera lancé en pré-commande le 21 juillet prochain (le 28 juillet dans les rayons) à un tarif 30 % moins cher que son aîné, le Pixel 6, grâce à un compromis qualité-prix. Mais il est doté de la même puce maison – la Google Tensor dopée à l’intelligence artificielle – que l’on retrouve depuis l’an dernier sur les modèles haut de gamme Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Jusqu’aux Pixel 5, la firme de Mountain View utilisait des puces de Qualcomm jugée moins performantes. Avec Tensor, les Pixel se font plus rapides et réactifs – notamment dans la reconnaissance vocale ou le traitement des images, photos et vidéos. Et ce, sans compromettre l’autonomie de la batterie. Autre point commun : le recours à une autre puce propre à Google, la puce de sécurité Titan M2, chargée de la gestion des tâches comme la protection par mot de passe, le cryptage et les transactions sécurisées dans les applications. « Et comme avec les autres appareils de la gamme, Pixel 6a sera parmi les premiers à recevoir la prochaine mise à jour Android 13 », a précisé le 11 mai Soniya Jobanputra (photo de gauche), directrice de la gestion de produit chez Google (
4). De son côté, le même jour, le vice-président des appareils et services de Google, Rick Osterloh (photo de droite), a donné un avant-goût de ce que seront les Pixel 7 qu’il a annoncés pour « cet automne » : « Notre prochaine version de Google Tensor alimentera ces appareils destinés à ceux qui veulent la dernière technologie et les performances les plus rapides », a-t-il assuré.
Rick Osterloh inscrit les smartphones de Google dans l’écosystème Pixel qui, outre des écouteurs (Pixel Buds) et d’ordinateurs portables (Pixelbook, ex-Chromebook Pixel), va s’étoffer avec des montres intelligentes (Pixel Watch) à partir de l’automne prochain et des tablettes avec puce Tensor prévues en 2023 pour succéder aux tablettes Pixel Slate (anciennement Pixel C). « Nous construisons la gamme Pixel pour vous donner plus d’options selon les différents budgets et besoins. J’ai hâte que tout le monde voie par lui-même à quel point ces appareils et ces technologies peuvent être utiles, qu’il s’agisse des appareils portables, des téléphones et des tablettes, ou encore de la technologie audio et de la maison intelligente », a expliqué Rick Osterloh (
5).
Google mise aussi sur la réparabilité
Google entend aussi jouer la carte de la réparabilité de ses smartphones, après s’être allié en avril dernier avec la société californienne iFixit. Des pièces de rechange d’origine Pixel commencent à être disponibles à l’achat sur Ifixit.com pour les modèles de Pixel 2 à Pixel 6 Pro (piles, écrans de rechange, caméras, kits de réparation avec tournevis et broches). Il en sera de même des futurs modèles Pixel 7. « Si vous ne voulez pas faire des réparations vous-même, nous travaillons déjà en partenariat avec des fournisseurs de réparation indépendants comme uBreakiFix », a signalé Ana Corrales, directrice du hardware grand public chez Google (
6). La réparabilité sera étendue à d’autres appareils comme les Chromebook, sans parler du recyclage des matériaux composant tous les produits de Google, et des objectifs de neutralité carbone.
@
Charles de Laubier
 L’autorité antitrust britannique – la Competition and Markets Authority (CMA) – n’est pas superstitieuse : elle a choisi le « vendredi 13 », en l’occurrence de ce mois d’octobre 2023, pour finalement donner son feu vert à Microsoft pour acquérir Activision Blizzard, mais sans les droits de diffusion en streaming dans le cloud des jeux de ce dernier. Ainsi, les jeux vidéo d’Activision Blizzard – dont les plus populaires comme « Call of Duty », « Diablo », « World of Warcraft », ou encore « Candy Crush » – seront exclus du périmètre de la méga-acquisition pour ce qui concerne les droits de diffusion en Cloud Gaming, lesquels sont cédés au français Ubisoft.
L’autorité antitrust britannique – la Competition and Markets Authority (CMA) – n’est pas superstitieuse : elle a choisi le « vendredi 13 », en l’occurrence de ce mois d’octobre 2023, pour finalement donner son feu vert à Microsoft pour acquérir Activision Blizzard, mais sans les droits de diffusion en streaming dans le cloud des jeux de ce dernier. Ainsi, les jeux vidéo d’Activision Blizzard – dont les plus populaires comme « Call of Duty », « Diablo », « World of Warcraft », ou encore « Candy Crush » – seront exclus du périmètre de la méga-acquisition pour ce qui concerne les droits de diffusion en Cloud Gaming, lesquels sont cédés au français Ubisoft.
 Question : Claude est-il le meilleur rival de ChatGPT ? Réponse : « Claude, développé par Anthropic, est en effet considéré comme un concurrent puissant du ChatGPT d’OpenAI ». Notre interlocuteur n’est autre que ChatGPT lui-même ! « Cependant, poursuit l’IA générative, il est important de noter que le “meilleur” modèle peut varier selon les cas d’utilisation et les exigences. Par exemple, si le support multilingue est une priorité, ChatGPT pourrait être un meilleur choix. En revanche, si le traitement de grandes quantités de données est crucial, Claude pourrait être plus approprié ».
Question : Claude est-il le meilleur rival de ChatGPT ? Réponse : « Claude, développé par Anthropic, est en effet considéré comme un concurrent puissant du ChatGPT d’OpenAI ». Notre interlocuteur n’est autre que ChatGPT lui-même ! « Cependant, poursuit l’IA générative, il est important de noter que le “meilleur” modèle peut varier selon les cas d’utilisation et les exigences. Par exemple, si le support multilingue est une priorité, ChatGPT pourrait être un meilleur choix. En revanche, si le traitement de grandes quantités de données est crucial, Claude pourrait être plus approprié ». « Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé (
« Les outils de communication et de collaboration à distance comme Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce qu’[elles] soient libres de choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. C’est la raison pour laquelle nous examinons si le fait que Microsoft lie ses suites de productivité [Office 365 et Microsoft 365, ndlr] à Teams est susceptible d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE », a déclaré Margrethe Vestager (photo de gauche), vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence. Et ce, avant de prendre congé (