Le 16 septembre, la Maison-Blanche a livré les premières réflexions de l’administration Biden sur la future monnaie numérique américaine – un « dollar digital ». Le même jour, la Banque centrale européenne a fait le point sur le projet d’« euro numérique ». La Chine devance avec son « e-yuan ».

« Le développement responsable des actifs numériques est vital pour les intérêts américains, du bien-être des consommateurs et des investisseurs pour la sécurité et la stabilité de notre système financier, et pour notre leadership financier et technologique dans le monde », a déclaré Brian Deese (photo de gauche), conseiller économique de la Maison-Blanche, lors d’une conférence téléphonique le 15 septembre. En ajoutant : « Plus que jamais, une réglementation prudente des cryptomonnaies est nécessaire si les actifs numériques sont amenés à jouer un rôle que nous croyons dans la promotion de l’innovation et le soutien de notre compétitivité économique et technologique ».
Esquisse d’une loi « CBDC » pour le 10 octobre
Depuis le 14mars 2022, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a fait des actifs numériques « une priorité ». Dans un décret – Executive Order (EO) – signé ce jour-là de sa main et intitulé « Assurer le développement responsable des actifs numériques », le locataire de la Maison-Blanche avait demandé à différentes autorités administratives – « le secrétaire du Trésor, en consultation avec le secrétaire d’État, le procureur général, le secrétaire au Commerce, le secrétaire à la Sécurité intérieure, le directeur du Bureau de la gestion et du budget, le Directeur du Renseignement national et les responsables des autres agences concernées » – de lui remettre dans les 180 jours, soit le 10 septembre 2022, « une évaluation de la nécessité de modifications législatives pour instaurer une CBDC des Etats-Unis, si elle est jugée appropriée et dans l’intérêt national ». CBDC (Central Bank Digital Currencies) désigne les monnaies numériques de Banque centrale, c’està- dire émanant des Etats. Ce premier rapport a été présenté par la Maison-Blanche le 16 septembre, précédé la veille du briefing téléphonique de Brian Deese. « Une monnaie numérique de banque centrale des Etats-Unis (CBDC) serait une forme numérique du dollar américain. Bien que les Etats- Unis n’aient pas encore décidé s’ils allaient ou non adopter une CBDC, ils ont examiné de près les répercussions et les options de l’émission d’une telle monnaie numérique de banque centrale », a-t-il indiqué en présentant le rapport de Alondra Nelson, la directrice de l’OSTP (Office of Science and Technology Policy), bureau rattaché au cabinet de Joe Biden. Ce premier rapport de 58 pages (
1) procède à une évaluation technologique d’une monnaie en faisant des recommandations mais sans dire si les Etats-Unis vont ou pas se lancer dans cette aventure (
2). Prochaine étape : dans les 210 jours suivant le décret, soit le 10 octobre prochain, le président américain recevra cette fois « une proposition législative correspondante fondée sur l’examen du rapport présenté par le secrétaire du Trésor (…) et de tout document élaboré par le président de la Réserve fédérale [la Fed, ndlr]». Sans attendre, l’OSTP et la National Science Foundation (NSF), une agence indépendante du gouvernement américain et supervisée par la Chambre des représentants des Etats-Unis, ont commencé à élaborer « un programme national de recherche et développement (R&D) sur les actifs numériques », portant notamment sur la cryptographie, sur la protection des consommateurs (y compris l’inclusion financière et l’équité dans l’écosystème des actifs numériques). L’objectif est d’être en phase avec la priorité budgétaire de l’exercice 2024 fixée par Joe Biden, qui demande aux ministères et organismes fédéraux de collaborer sur les technologies essentielles et émergentes, y compris les technologies financières.
Selon l’EO n°14067, les différents rapports demandés doivent se pencher sur l’avenir des systèmes de paiement et de monnaie, « y compris les conditions qui conduisent à une large adoption des actifs numériques ». Le but est de mesurer l’influence de l’innovation technologique et les répercussions sur le système financier des Etats-Unis, ainsi que les répercussions sur la modernisation et les changements des systèmes de paiement, la croissance économique, l’inclusion financière et la sécurité nationale. Mais surtout, les rapports demandés doivent explorer la mise en place aux Etats-Unis de monnaies numériques de la Banque centrale (CBDC), en l’occurrence la Fed (Federal Reserve). Et ce, en garantissant le principe de la « monnaie souveraine » du pays, comprenez le e-dollar, tout en évaluant les avantages et les risques possibles pour les consommateurs, les investisseurs et les entreprises, ainsi que la stabilité financière et le risque systémique pour les systèmes de paiement et la sécurité nationale.
Maintenir le dollar au centre du monde
Il s’agit aussi pour Joe Biden de « mettre en valeur le leadership et la participation des Etats-Unis » dans les instances internationales concernées par les CBDC et dans les projets pilotes multinationaux de monnaies numériques auxquels participent les autres banques centrales. Dans son décret présidentiel, le président des Etats-Unis esquisse ce futur e-dollar : « Une CBDC des Etats-Unis pourrait soutenir des transactions efficaces et peu coûteuses, en particulier pour les transferts de fonds et les paiements transfrontaliers, et favoriser un meilleur accès au système financier, avec moins de risques posés par les actifs numériques administrés par le secteur privé ». Cette future CBDC américaine devrait être, selon Joe Biden, « interopérable avec les CBDC émises par d’autres autorités » et pourraient « potentiellement stimuler la croissance économique, soutenir le maintien de la centralité des Etats-Unis au sein du système financier international et aider à protéger le rôle unique que joue le dollar dans la finance mondiale ». E-euro : conclusions de la BCE début 2023 L’une des priorités de l’administration Biden est donc de maintenir le dollar américains au centre du système monétaire international. En creux, Washington veut éviter à tout prix que le dollar ne soit court-circuité par des cryptomonnaies nonétatiques telles que le Bitcoin, l’Ether ou encore le Ripple (
3). En outre, Joe Biden encourage Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, à savoir la Fed, à lui remettre un rapport pour savoir comment les CBDC pourraient « améliorer l’efficacité et réduire les coûts des systèmes de paiement actuels et futurs » et pour continuer à « évaluer la forme optimale d’une CBDC des Etats-Unis et élaborer un plan stratégique pour la Réserve fédérale et l’action plus large du gouvernement des Etats-Unis (dans la perspective de) la mise en œuvre et du lancement possible d’une CBDC des Etats-Unis » (
4). La remise de ces deux rapports – le premier sur l’évaluation de la nécessité de légiférer (remis miseptembre) et le second sur une proposition législative correspondante (à remettre le 10 octobre) –, se fait par l’entremise de l’adjoint du président américain pour les affaires de sécurité nationale (APNSA) et de son autre adjoint pour la politique économique (APEP). La commission fédérale du commerce, la FTC, ou encore l’autorité des marchés financiers – la SEC – sont, elles aussi, mises à contribution pour préparer le terrain à la création de monnaies numériques de la Banque centrale des Etats-Unis – dollar digital en tête.
Hasard du calendrier (quoique), de l’autre côté de l’Atlantique, la Banque centrale européenne (BCE) – dirigée depuis près de trois ans par Christine Lagarde (photo de droite) – a communiqué ce même 17 septembre sur le futur euro digital. Au nom de l’Union européenne, qui s’apprête à adopter un règlement dit « MiCA » sur les marchés de crypto-actifs (
5), l’institution monétaire basée à Francfort a fait part de la sélection de cinq entreprises « pour développer des interfaces utilisateur potentielles pour l’euro numérique ». Le but est de tester dans quelle mesure la technologie de l’euro numérique s’intègre aux prototypes déjà développés par ces entreprises, à savoir : le géant mondial du e-commerce Amazon pour les paiements en ligne, la société italienne spécialisée dans le e-paiements Nexi pour les paiements au point de vente effectués par le bénéficiaire, l’initiative européen EPI pour les paiements au point de vente effectués par le payeur, la société française leader dans la « paytech » Worldline pour les paiements hors ligne entre pairs (peerto- peer offline payments), et l’établissement financier espagnol CaixaBank pour les paiements en ligne entre pairs (peer-topeer online payments).
La présence d’Amazon parmi ces cinq entreprises, choisies par la BCE au sein d’un pool de 54 fournisseurs de services, n’a pas manqué de soulever des interrogations sur la « souveraineté européenne » de la démarche. « Leur sélection fait suite à l’appel à manifestations d’intérêt lancé en avril 2022 pour participer à l’exercice de prototypage, a expliqué la BCE. Les 54 entreprises remplissent un certain nombre de “capacités essentielles” décrites dans l’appel, tandis que les cinq fournisseurs choisis correspondaient le mieux aux “capacités particulières” » (
6). Ces cinq sociétés développeront leur prototype respectifs, dont les transactions seront simulées et traitées par l’interface et l’infrastructure dorsale d’Eurosystème, l’organe de l’Union européenne qui regroupe la BCE et les banques centrales nationales des Etats membres. Sous la houlette de Christine Lagarde, l’institution francfortoise publiera au premier semestre 2023 ses conclusions sur ses deux ans d’étude sur le projet d’euro numérique. Selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau qui s’est exprimé le 27 septembre, l’Eurosystème prendra une décision d’ici fin 2023, en vue d’un lancement éventuel en 2026 ou 2027. Quant à la Chine, elle a un coup d’avance sur l’Occident. Le président chinois Xi Jinping veut faire un « Grand bond en avant » numérique en voulant généraliser l’e-yuan, qui est testé depuis 2020 après des développements commencés dès 2014. Le renminbi digital – appelé officiellement Digital Currency Electronic Payment (DCEP) – a commencé à être utilisé à grande échelle dans l’Empire du Milieu à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver qui se sont déroulés à Pékin en février 2022. Mais aucun bilan n’a été donné depuis.
Chine : l’e-yuan, futur « Bigcoin » ?
Selon Sharnie Wong, une analyste de Bloomberg Intelligence (BI), l’e-yuan ou e-CNY pourrait d’ici 2025 représenter 9% des paiements numériques en Chine (
7). D’autant que Pékin a interdit le bitcoin, car trop « spéculatif ». Plus de 4,5 millions de commerçants en Chine acceptent les paiements en e-CNY grâce à l’application mobile éponyme téléchargées par millions. WeChat (Tencent) et AliPay (Alibaba) sont tenus eux aussi de faire la promotion de la crypto nationale. Pour autant, ni les Etats-Unis, ni l’Europe, ni la Chine ne veulent perdre leur pouvoir régalien étatique historique de « frapper monnaie », chahuté par le paiement mobile et les cryptomonnaies. Et chacun rêve en plus d’imposer au monde son propre « Bigcoin » somme.
@
Charles de Laubier
 Le numéro un mondial des moteurs de recherche, Google, sera-t-il le premier Gafam à être démantelé aux Etats-Unis ? La filiale du groupe Alphabet, présidé depuis près de cinq ans par Sundar Pichai (photo), est la cible de deux procès antitrust historiques aux EtatsUnis. Le premier procès, qui s’est ouvert en septembre 2023, s’est soldé le 5 août 2024 par un jugement qui condamne Google pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche où il est en situation de quasi-monopole. La firme de Mountain View a fait appel de cette décision. Le second procès, qui s’est ouvert le 9 septembre 2024, concerne cette fois ses outils de monétisation publicitaires.
Le numéro un mondial des moteurs de recherche, Google, sera-t-il le premier Gafam à être démantelé aux Etats-Unis ? La filiale du groupe Alphabet, présidé depuis près de cinq ans par Sundar Pichai (photo), est la cible de deux procès antitrust historiques aux EtatsUnis. Le premier procès, qui s’est ouvert en septembre 2023, s’est soldé le 5 août 2024 par un jugement qui condamne Google pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche où il est en situation de quasi-monopole. La firme de Mountain View a fait appel de cette décision. Le second procès, qui s’est ouvert le 9 septembre 2024, concerne cette fois ses outils de monétisation publicitaires.
 L’autorité antitrust britannique – la Competition and Markets Authority (CMA) – n’est pas superstitieuse : elle a choisi le « vendredi 13 », en l’occurrence de ce mois d’octobre 2023, pour finalement donner son feu vert à Microsoft pour acquérir Activision Blizzard, mais sans les droits de diffusion en streaming dans le cloud des jeux de ce dernier. Ainsi, les jeux vidéo d’Activision Blizzard – dont les plus populaires comme « Call of Duty », « Diablo », « World of Warcraft », ou encore « Candy Crush » – seront exclus du périmètre de la méga-acquisition pour ce qui concerne les droits de diffusion en Cloud Gaming, lesquels sont cédés au français Ubisoft.
L’autorité antitrust britannique – la Competition and Markets Authority (CMA) – n’est pas superstitieuse : elle a choisi le « vendredi 13 », en l’occurrence de ce mois d’octobre 2023, pour finalement donner son feu vert à Microsoft pour acquérir Activision Blizzard, mais sans les droits de diffusion en streaming dans le cloud des jeux de ce dernier. Ainsi, les jeux vidéo d’Activision Blizzard – dont les plus populaires comme « Call of Duty », « Diablo », « World of Warcraft », ou encore « Candy Crush » – seront exclus du périmètre de la méga-acquisition pour ce qui concerne les droits de diffusion en Cloud Gaming, lesquels sont cédés au français Ubisoft.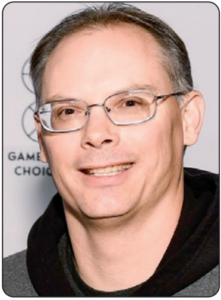 Du 22 au 24 mars à San Francisco, lors de la Game Developers Conference (GDC), Epic Games – l’éditeur de jeu-phénomène « Fortnite » et du moteur de création de jeux et de mondes virtuels Unreal Engine – a encore une fois mobilisé sa communauté de développeurs et de gamers avec des nouveautés et de nouvelles versions (la « 5.2 » d’Unreal Engine et la « Mega » de Fortnite notamment). Il y en a pour tous les goûts : construire des mondes photoréalistes avec Unreal Engine 5.2 ; créer son premier jeu dans Fortnite avec Unreal Editor for Fortnite (UEFN) ; utiliser MetaHuman pour créer des personnages humains très réalistes de toutes les façons imaginables ; concevoir de nouveaux personnages physiques dans UE5 et pouvoir « caresser le chien », … L’écosystème d’Epic en a vu de toutes les couleurs à la GDC (
Du 22 au 24 mars à San Francisco, lors de la Game Developers Conference (GDC), Epic Games – l’éditeur de jeu-phénomène « Fortnite » et du moteur de création de jeux et de mondes virtuels Unreal Engine – a encore une fois mobilisé sa communauté de développeurs et de gamers avec des nouveautés et de nouvelles versions (la « 5.2 » d’Unreal Engine et la « Mega » de Fortnite notamment). Il y en a pour tous les goûts : construire des mondes photoréalistes avec Unreal Engine 5.2 ; créer son premier jeu dans Fortnite avec Unreal Editor for Fortnite (UEFN) ; utiliser MetaHuman pour créer des personnages humains très réalistes de toutes les façons imaginables ; concevoir de nouveaux personnages physiques dans UE5 et pouvoir « caresser le chien », … L’écosystème d’Epic en a vu de toutes les couleurs à la GDC ( « Le développement responsable des actifs numériques est vital pour les intérêts américains, du bien-être des consommateurs et des investisseurs pour la sécurité et la stabilité de notre système financier, et pour notre leadership financier et technologique dans le monde », a déclaré Brian Deese (photo de gauche), conseiller économique de la Maison-Blanche, lors d’une conférence téléphonique le 15 septembre. En ajoutant : « Plus que jamais, une réglementation prudente des cryptomonnaies est nécessaire si les actifs numériques sont amenés à jouer un rôle que nous croyons dans la promotion de l’innovation et le soutien de notre compétitivité économique et technologique ».
Esquisse d’une loi « CBDC » pour le 10 octobre
Depuis le 14mars 2022, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a fait des actifs numériques « une priorité ». Dans un décret – Executive Order (EO) – signé ce jour-là de sa main et intitulé « Assurer le développement responsable des actifs numériques », le locataire de la Maison-Blanche avait demandé à différentes autorités administratives – « le secrétaire du Trésor, en consultation avec le secrétaire d’État, le procureur général, le secrétaire au Commerce, le secrétaire à la Sécurité intérieure, le directeur du Bureau de la gestion et du budget, le Directeur du Renseignement national et les responsables des autres agences concernées » – de lui remettre dans les 180 jours, soit le 10 septembre 2022, « une évaluation de la nécessité de modifications législatives pour instaurer une CBDC des Etats-Unis, si elle est jugée appropriée et dans l’intérêt national ». CBDC (Central Bank Digital Currencies) désigne les monnaies numériques de Banque centrale, c’està- dire émanant des Etats. Ce premier rapport a été présenté par la Maison-Blanche le 16 septembre, précédé la veille du briefing téléphonique de Brian Deese. « Une monnaie numérique de banque centrale des Etats-Unis (CBDC) serait une forme numérique du dollar américain. Bien que les Etats- Unis n’aient pas encore décidé s’ils allaient ou non adopter une CBDC, ils ont examiné de près les répercussions et les options de l’émission d’une telle monnaie numérique de banque centrale », a-t-il indiqué en présentant le rapport de Alondra Nelson, la directrice de l’OSTP (Office of Science and Technology Policy), bureau rattaché au cabinet de Joe Biden. Ce premier rapport de 58 pages (
« Le développement responsable des actifs numériques est vital pour les intérêts américains, du bien-être des consommateurs et des investisseurs pour la sécurité et la stabilité de notre système financier, et pour notre leadership financier et technologique dans le monde », a déclaré Brian Deese (photo de gauche), conseiller économique de la Maison-Blanche, lors d’une conférence téléphonique le 15 septembre. En ajoutant : « Plus que jamais, une réglementation prudente des cryptomonnaies est nécessaire si les actifs numériques sont amenés à jouer un rôle que nous croyons dans la promotion de l’innovation et le soutien de notre compétitivité économique et technologique ».
Esquisse d’une loi « CBDC » pour le 10 octobre
Depuis le 14mars 2022, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a fait des actifs numériques « une priorité ». Dans un décret – Executive Order (EO) – signé ce jour-là de sa main et intitulé « Assurer le développement responsable des actifs numériques », le locataire de la Maison-Blanche avait demandé à différentes autorités administratives – « le secrétaire du Trésor, en consultation avec le secrétaire d’État, le procureur général, le secrétaire au Commerce, le secrétaire à la Sécurité intérieure, le directeur du Bureau de la gestion et du budget, le Directeur du Renseignement national et les responsables des autres agences concernées » – de lui remettre dans les 180 jours, soit le 10 septembre 2022, « une évaluation de la nécessité de modifications législatives pour instaurer une CBDC des Etats-Unis, si elle est jugée appropriée et dans l’intérêt national ». CBDC (Central Bank Digital Currencies) désigne les monnaies numériques de Banque centrale, c’està- dire émanant des Etats. Ce premier rapport a été présenté par la Maison-Blanche le 16 septembre, précédé la veille du briefing téléphonique de Brian Deese. « Une monnaie numérique de banque centrale des Etats-Unis (CBDC) serait une forme numérique du dollar américain. Bien que les Etats- Unis n’aient pas encore décidé s’ils allaient ou non adopter une CBDC, ils ont examiné de près les répercussions et les options de l’émission d’une telle monnaie numérique de banque centrale », a-t-il indiqué en présentant le rapport de Alondra Nelson, la directrice de l’OSTP (Office of Science and Technology Policy), bureau rattaché au cabinet de Joe Biden. Ce premier rapport de 58 pages ( Ce n’est pas gagné. La méga-acquisition d’Activision Blizzard annoncée le 18 janvier dernier par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars pourrait ne pas aboutir en 2023. Car les obstacles s’accumulent, tant devant la justice que devant les autorités boursière et antitrust. Issu il y a quinze ans de la fusion entre Activision et Vivendi Games, l’éditeur de « Call of Duty » espère que la fusion devrait aboutir « au cours de l’exercice financier de Microsoft se terminant le 30 juin 2023 ».
Conflits d’intérêts et risques antitrust
Depuis la précédente cession d’Activision en 2013 par Vivendi et son introduction en Bourse, il y aura dix ans l’an prochain si la vente à Microsoft arrive à son terme, Robert Kotick alias Bobby (photo de gauche) et Brian Kelly (photo de droite) ont conservé ensemble une participation de près de 25 % du groupe. Le premier est encore directeur général d’Activision Blizzard, tandis que le second en est encore le président du conseil d’administration. C’est justement au sujet des administrateurs que des actionnaires – une demi-douzaine, selon le site Polygon.com (
Ce n’est pas gagné. La méga-acquisition d’Activision Blizzard annoncée le 18 janvier dernier par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars pourrait ne pas aboutir en 2023. Car les obstacles s’accumulent, tant devant la justice que devant les autorités boursière et antitrust. Issu il y a quinze ans de la fusion entre Activision et Vivendi Games, l’éditeur de « Call of Duty » espère que la fusion devrait aboutir « au cours de l’exercice financier de Microsoft se terminant le 30 juin 2023 ».
Conflits d’intérêts et risques antitrust
Depuis la précédente cession d’Activision en 2013 par Vivendi et son introduction en Bourse, il y aura dix ans l’an prochain si la vente à Microsoft arrive à son terme, Robert Kotick alias Bobby (photo de gauche) et Brian Kelly (photo de droite) ont conservé ensemble une participation de près de 25 % du groupe. Le premier est encore directeur général d’Activision Blizzard, tandis que le second en est encore le président du conseil d’administration. C’est justement au sujet des administrateurs que des actionnaires – une demi-douzaine, selon le site Polygon.com (