Quatre ans après avoir débarqué sur les téléviseurs connectés de Samsung, Qobuz est depuis début novembre 2025 disponible sous Android TV sur les téléviseurs équipés de Google TV. La plateforme française de streaming et de téléchargement musicaux de haute qualité augmente sa présence dans le salon.
 Vous avez aimé écouter Qobuz au casque ; vous adorerez l’entendre dans le salon. En plus de sa présence depuis maintenant quatre ans sur les téléviseurs connectés de Samsung (1), la plateforme française de streaming et de téléchargement musicaux de haute qualité augmente la possibilité d’écouter ses « plus de 100 millions de titres disponibles en lossless » et « le meilleur catalogue Hi-Res au monde » dans un canapé face à une Smart TV. Qobuz a lancé le 5 novembre son application sous le système d’exploitation Android TV, fonctionnant sur tous les téléviseurs connectés, ainsi que d’autres appareils (passerelles ou boîtiers multimédias), équipés de Google TV.
Vous avez aimé écouter Qobuz au casque ; vous adorerez l’entendre dans le salon. En plus de sa présence depuis maintenant quatre ans sur les téléviseurs connectés de Samsung (1), la plateforme française de streaming et de téléchargement musicaux de haute qualité augmente la possibilité d’écouter ses « plus de 100 millions de titres disponibles en lossless » et « le meilleur catalogue Hi-Res au monde » dans un canapé face à une Smart TV. Qobuz a lancé le 5 novembre son application sous le système d’exploitation Android TV, fonctionnant sur tous les téléviseurs connectés, ainsi que d’autres appareils (passerelles ou boîtiers multimédias), équipés de Google TV.
Des smartphones à la télévision
Rien qu’en France, Qobuz accroît sa disponibilité sur les téléviseurs connectés puisque 84 % des foyers français ont une Smart TV effectivement raccordée à Internet – d’après les « tendances audio-vidéo 2025 » de l’Arcom. En plus des téléviseurs connectés Samsung, où Qobuz est disponible depuis novembre 2021, l’application sous Android vient élargir sa présence sur les Smart TV. D’après cette même étude du régulateur, publiée au printemps 2025 (2) sur les équipements audiovisuels et la consommation des contenus audio et vidéo, ils sont 28 % des foyers français à disposer d’un téléviseur connectés fonctionnant sous le système d’exploitation Android TV. Ce qui le positionne en seconde position en France, derrière Tizen de Samsung présent à hauteur de 41 %, et loin devant le webOS de son compatriote sud-coréen LG à 17 %.
« Nos utilisateurs nous réclamaient Android TV depuis longtemps », a précisé Axel Destagnol, le directeur produit chez Qobuz (3). Contacté par Edition Multimédi@, il nous précise : (suite)

 Le projet de législation spatiale pour l’Union européenne (UE), le « Space Act » présenté le 25 juin 2025 par la Commission européenne, affiche clairement son ambition de doter l’Europe – avant 2030 – d’un cadre normatif unifié régissant les activités spatiales civiles et commerciales. Attendu depuis plusieurs années, ce texte s’inscrit dans un contexte de profonde mutation du secteur spatial, marqué par l’essor d’acteurs privés, la multiplication des lancements, la congestion des orbites et la montée en puissance de nouvelles nations spatiales hors Europe.
Le projet de législation spatiale pour l’Union européenne (UE), le « Space Act » présenté le 25 juin 2025 par la Commission européenne, affiche clairement son ambition de doter l’Europe – avant 2030 – d’un cadre normatif unifié régissant les activités spatiales civiles et commerciales. Attendu depuis plusieurs années, ce texte s’inscrit dans un contexte de profonde mutation du secteur spatial, marqué par l’essor d’acteurs privés, la multiplication des lancements, la congestion des orbites et la montée en puissance de nouvelles nations spatiales hors Europe.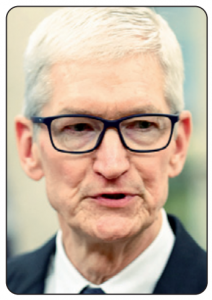 Tim Cook (photo) a très peu mentionné Apple Intelligence lors de l’événement largement suivi du 9 septembre 2025, qui s’intitulait cette année « Awe Dropping » – jeu de mots entre « jaw-dropping » (époustouflant) et « awe » (admiration). Mais au lieu d’annonces susceptibles de provoquer l’effet « Waouh » promis, le PDG de la firme de Cupertino nous a offert ce qu’il sait faire au mieux : la présentation d’un catalogue de produits de la marque à la pomme (
Tim Cook (photo) a très peu mentionné Apple Intelligence lors de l’événement largement suivi du 9 septembre 2025, qui s’intitulait cette année « Awe Dropping » – jeu de mots entre « jaw-dropping » (époustouflant) et « awe » (admiration). Mais au lieu d’annonces susceptibles de provoquer l’effet « Waouh » promis, le PDG de la firme de Cupertino nous a offert ce qu’il sait faire au mieux : la présentation d’un catalogue de produits de la marque à la pomme ( Cofondée par deux Français (photos), Taha Bouarfa (basé à Hong Kong en Chine) et Kawther Ghazal (à Dubaï aux Emirats arabes unis), la société hongkongaise EarthMeta lance son métavers de « nouvelle génération », combinant intelligence artificielle et blockchain. Avec ce monde immersif qui a des airs de Google Earth (
Cofondée par deux Français (photos), Taha Bouarfa (basé à Hong Kong en Chine) et Kawther Ghazal (à Dubaï aux Emirats arabes unis), la société hongkongaise EarthMeta lance son métavers de « nouvelle génération », combinant intelligence artificielle et blockchain. Avec ce monde immersif qui a des airs de Google Earth (