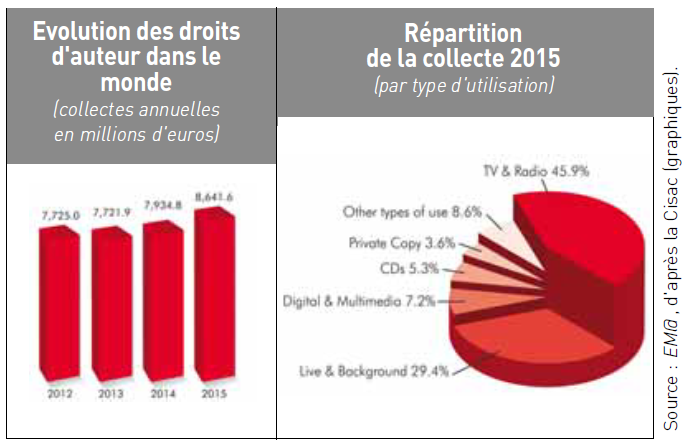La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a indiqué à Edition Multimédi@ que le lancement de la future plateforme vidéo (ex-Pluzz) sera lancée en mai 2017 – non pas en mars – avec du replay et de la VOD. Quant à la SVOD, dédiées aux films et séries en français, elle devrait être intégrée à l’automne.
 « Comment arrive-t-on à réconcilier notre métier traditionnel avec des nouveaux usages, ces nouvelles façons d’aborder les films, le divertissement, les documentaires ou encore les fictions ? En étant présent sur ces nouveaux supports. C’est pour cela que nous avons lancé une forte refonte de notre plateforme traditionnelle gratuite Francetv Pluzz, qui va peut-être s’appeler autrement… C’est un scoop ! Parce que “Pluzz”… Bon… Voilà… », a annoncé la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte (photo), lors d’un dîner-débat du Club audiovisuel de Paris (CAVP), dont elle était l’invitée le 7 décembre dernier.
« Comment arrive-t-on à réconcilier notre métier traditionnel avec des nouveaux usages, ces nouvelles façons d’aborder les films, le divertissement, les documentaires ou encore les fictions ? En étant présent sur ces nouveaux supports. C’est pour cela que nous avons lancé une forte refonte de notre plateforme traditionnelle gratuite Francetv Pluzz, qui va peut-être s’appeler autrement… C’est un scoop ! Parce que “Pluzz”… Bon… Voilà… », a annoncé la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte (photo), lors d’un dîner-débat du Club audiovisuel de Paris (CAVP), dont elle était l’invitée le 7 décembre dernier.
Sans dévoiler à ce stade la nouvelle appellation du service de vidéo à la demande (VOD) et de télévision de rattrapage (replay), elle a néanmoins constaté aussitôt que l’idée d’abandonner le nom de Pluzz était accueillie par des applaudissements nourris de la part des convives. En marge de ce dîner-débat, Delphine Ernotte a indiqué à Edition Multimédi@ que la future plateforme vidéo ne sera pas lancée en mars prochain comme elle l’avait envisagé, mais en mai. Le futur ex-Pluzz continuera à proposer dans un premier du replay gratuit et de la VOD payante, avant d’être élargi à la SVOD – la vidéo à la demande par abonnement – à partir de l’automne 2017.
« Francetv Pluzz », lancé tardivement en 2010
C’est en juin 2010 qu’avait été annoncé pour la première fois le lancement, le mois suivant (1), du service gratuit de télévision de rattrapage baptisé Pluzz – contraction des mots « play », « plus » et « buzz »… Ce nom quelque peu abscons avait été imaginé par les équipes dirigeantes du président de France Télévisions de l’époque, Patrick de Carolis, juste avant que ce dernier ne soit remplacé en août 2010 par Rémy Pflimlin, le prédécesseur de Delphine Ernotte. France Télévisions était alors parti en retard (2) sur ce marché naissant de la télévision de rattrapage, qui comptait déjà M6 Replay, Canal+ à la demande, Arte+7 ou encore MyTF1. Aujourd’hui, « Francetv
Pluzz » (3) permet non seulement de regarder gratuitement en direct les programmes des… 39 chaînes du groupe France Télévisions (France 2, 3, 4, 5, Ô, Franceinfo, les
24 déclinaisons régionales de France 3 et les 9 chaînes d’Outre-Mer), mais aussi de retrouver la majorité de ces programmes en replay – généralement pendant les 7 jours suivants leur diffusion, conformément aux accords avec les ayants droit. Au-delà de
ces 7 jours, la plupart de ces programmes sont disponibles en VOD sur « Francetv Pluzz VàD ».
Aide de Yves Bigot, DG de TV5 Monde
Selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), d’après un sondage d’Harris Interactive et Vertigo sur septembre dernier, « Francetv Pluzz VàD », arrive
en cinquième position des plateformes de VOD en France avec 16,9 % des consommateurs de ce type de plateforme – derrière MyTF1 VOD, Orange, Netflix et CanalPlay VOD. Mais Delphine Ernotte, à la tête des chaînes de télévision publiques depuis quinze mois maintenant, est décidée à faire du futur ex-Pluzz une plateforme vidéo globale d’envergue francophone. « Il s’agit de la rendre plus ergonomique et plus facile d’accès. Nous souhaitons aussi, car c’est notre rôle au sein du service public, trouver un modèle économique qui nous permette avec l’offre par abonnement [SVOD, ndlr] d’exposer les œuvres en français. On a Netflix, avec des œuvres américaines ;
on va avoir Amazon [Amazon Prime Vidéo a été lancé le 14 décembre dernier dans le reste du monde, dont la France, en plus des cinq pays d’origine, lire p 3, ndlr]… des œuvres américaines. Il faut absolument avoir face à ces offres-là, qui sont formidables (je ne critique pas), l’équivalent avec des œuvres françaises : des documentaires français, des films français, des fictions françaises, des films d’animation français, des spectacles vivants français, … », a-t-elle exposé devant les professionnels de l’audiovisuel.
Pour l’aider à faire rayonner la future plateforme vidéo sur la francophonie, Delphine Ernotte a révélé ce soir-là avoir accepté « la proposition de service » de Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, lequel plaide aussi en faveur d’une plateforme de SVOD francophone (4). « Il faut déjà que l’on avance déjà sur la version de base française. Je pense que l’on va aboutir. Ce n’est pas un sujet économique car, entre nous, pour France Télévisions qui ne possède pas de catalogue, ce n’est pas cela qui va nous permettre de (nous) financer. En revanche, c’est un enjeu démocratique que l’on doit porter parce que l’on pèse 50 % du financement de la création », a-t-elle justifié. Selon nos informations, les négociations avec les organisations de producteurs cinématographiques (Bloc, Blic et ARP) n’ont pas encore eu lieu. Intervenant lors du dîner du CAVP, Frédéric Goldsmith, délégué général de l’Union des producteurs de cinéma (UPC) s’est d’ores et déjà félicité de cette initiative : « Vous avez évoqué un projet d’une audace considérable qui est un service de SVOD à dimension francophone, concurrent de Netflix et d’Amazon. Je pense que l’on a pas assez
relevé le défi que cela représente. Il faut vous soutenir totalement dans cette démarche. J’ai envie de vous dire : “Chiche, allons-y !”. Mais allons-y franchement, parlonsen concrètement, faisons cesser la frilosité sur ce sujet, et donnons une dimension ambitieuse à la marque “France Télévision” comme référence culturelle et franco-
phone », a-t-il déclaré enthousiaste.
Lors des Rencontres cinématographiques de Dijon, le 22 octobre dernier, Delphine Ernotte avait avoué être de ceux qui ne regardent plus la télévision : « Je regarde tout en rattrapage. Je suis passée de l’autre côté du miroir », tout en déplorant de ne pas trouver sur la plateforme Pluzz une rubrique cinéma dont les films ne sont pas en replay. « Cela dévalue le cinéma. Il n’existe plus et c’est un vrai problème. Je vais donc regarder les téléfilms, les séries et les documentaires où il y a aussi beaucoup de création. Il faut mettre du rattrapage sur le cinéma ». La catch up de films est donc,
à ses yeux, vitale pour le cinéma. Or les organisations du 7e Art français posent leurs conditions, comme la société civile des Auteurs-Réalisateurs- Producteurs (ARP) qui, selon son vice-président Dante Desarthe, souhaite en contrepartie une coproduction des films concernés. Quant au syndicat UPC, co-présidé par Xavier Rigault qui s’est aussi exprimé à Dijon, il se dit « assez prudent » sur le replay car il craint « la dévalorisation des films dans le non-linéaire » assimilé au gratuit.
Pas question pour l’UPC de voir des films en replay sur les chaînes gratuites de France Télévisions (sauf sur un délai très court ou 2 jours), alors que cela ne lui pose pas de problème avec les chaînes payantes Canal+ et OCS. Autant dire que pour la future plateforme de SVOD, dont Delphine Ernotte a fait son cheval de bataille depuis la présentation de ce projet devant le CSA lors de sa candidature à la présidence de France Télévisions (5), a plus de chance avec le cinéma d’aboutir que le replay .
Un « Google de la création française » ?
Si la présidente de France Télévisions évoquait pour la première fois – ce 7 décembre – l’abandon du nom Pluzz, elle avait en revanche déjà fait état de son ambition de lancer une plateforme SVOD à la française.
A défaut d’avoir réussi à convaincre les autres chaînes françaises (TF1 et M6), Delphine Ernotte se tourne vers les producteurs et les chaînes francophones d’autres pays. Il y a un peu plus d’un an, le 28 octobre 2015, elle parlait de créer un « Google
de la création française » là où Vincent Bolloré (patron de Vivendi) rêve de lancer un
« Netflix européen » et Alain Rocca (producteur de films) souhaite faire de son service de VOD/SVOD UniversCiné une plateforme paneuropéenne. @
Charles de Laubier