Edward Bouygues (40 ans), fils aîné de Martin Bouygues (72 ans) et président de Bouygues Telecom depuis avril 2022, supervise son premier « plan stratégique » – baptisé « Cap 2030 » – pour que l’opérateur télécoms déjà rentable le soit plus encore d’ici à 2030. Selon nos informations, il sera détaillé en novembre (initialement le 7).
(Actualisation : des réunions avec les syndicats ont été fixées les 5,14 et 20 novembre, mais elles concernent les emplois et la mobilité, pas encore le plan « Cap 2030 »)
 Selon les informations de Edition Multimédi@, la direction générale de Bouygues Telecom fera le 7 novembre prochain une présentation en interne, et en visio, de son nouveau « plan stratégique » baptisé « Cap 2030 ». Depuis que le directeur général de Bouygues Telecom, Benoît Torloting, et son adjointe en charge de la stratégie (1), Chrystel Abadie Truchet, ont présenté le 1er octobre – lors d’un comité social et économique central (CSEC) extraordinaire – les grandes lignes de Cap 2030, les syndicats, les représentants du personnel et les quelques 10.500 salariés de l’opérateur télécoms sont inquiets voire dans l’incompréhension.
Selon les informations de Edition Multimédi@, la direction générale de Bouygues Telecom fera le 7 novembre prochain une présentation en interne, et en visio, de son nouveau « plan stratégique » baptisé « Cap 2030 ». Depuis que le directeur général de Bouygues Telecom, Benoît Torloting, et son adjointe en charge de la stratégie (1), Chrystel Abadie Truchet, ont présenté le 1er octobre – lors d’un comité social et économique central (CSEC) extraordinaire – les grandes lignes de Cap 2030, les syndicats, les représentants du personnel et les quelques 10.500 salariés de l’opérateur télécoms sont inquiets voire dans l’incompréhension.
Ce CSEC, réuni à Meudon-la-Forêt (où se trouve le centre névralgique de Bouygues Telecom dans les Hauts-de-Seine) a fait l’effet d’une douche froide : gel des embauches, départs non remplacés, délocalisation dans les centres techniques de Porto au Portugal et de Rabat au Maroc, moindre recours aux prestataires externes, automatisation à tous les étages, et incitation à la mobilité. Pourtant, l’entreprise est en pleine forme. Créé il y a trente ans (2) par Martin Bouygues au sein du groupe familial de BTP, d’immobilier et de télévision (TF1), le troisième opérateur télécoms de France en termes de chiffre d’affaires – 7,73 milliards d’euros en 2023, en hausse de 3% – est une affaire de plus en plus profitable, avec l’an dernier une rentabilité opérationnelle de 1,97 milliard d’euros (3), en hausse de 11 %.
Encore meilleure rentabilité confirmée pour 2024
Ce bilan devrait pleinement satisfaire Edward Bouygues (photo), fils aîné du milliardaire Martin Bouygues (4) et président depuis deux ans et demi de la filiale Bouygues Telecom, où il est entré il y a dix ans. C’est même une poule aux oeufs d’or qui, au cours du dernier exercice, a fait remonter pas moins de 414 millions d’euros dans le bénéfice net du conglomérat familial coté en Bourse, soit presque la moitié du milliard de résultat net de la maison mère en 2023. Dans cette contribution à ce « résultat net part du groupe », Bouygues Telecom devance même largement toutes les autres filiales-soeurs que sont TF1 (87 millions seulement), Bouygues Construction (195 millions), Equans (305 millions) ou encore Colas (310 millions). Et l’année 2024 s’annonce encore meilleure, comme l’a annoncé l’été dernier le groupe Bouygues pour sa filiale télécoms, avec « un chiffre d’affaires facturé aux clients en hausse » et une rentabilité opérationnelle « supérieur à 2 milliards d’euros » (5). Bouygues Telecom maintient en outre son objectif – fixé en 2021 via son précédent plan stratégique « Ambition 2026 » (6) et réaffirmé début octobre 2024 – de générer un cash-flow libre de 600 millions d’euros en 2026.

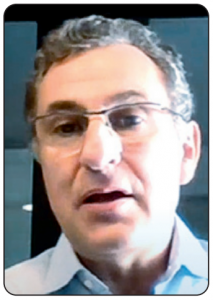 Comment un grand patron de la presse française peut-il démissionner sur de simples « likes » envers des posts de personnalités d’extrême droite sur le réseau social professionnel LinkedIn ? C’est pourtant ce qu’a décidé le 28 janvier Philippe Carli (photo), jusqu’alors PDG du groupe de presse Ebra, lequel revendique être le « 1er groupe de presse quotidienne régionale » avec ses neuf titres dont L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), Vosges Matin, Le Dauphiné Libéré ou encore Le Progrès.
Comment un grand patron de la presse française peut-il démissionner sur de simples « likes » envers des posts de personnalités d’extrême droite sur le réseau social professionnel LinkedIn ? C’est pourtant ce qu’a décidé le 28 janvier Philippe Carli (photo), jusqu’alors PDG du groupe de presse Ebra, lequel revendique être le « 1er groupe de presse quotidienne régionale » avec ses neuf titres dont L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), Vosges Matin, Le Dauphiné Libéré ou encore Le Progrès.

 Orange reste très rentable, avec un bénéfice net de près de 3 milliards d’euros en 2023 – 2.892 millions d’euros précisément, en croissance de 10,5 % sur un an. Depuis l’annonce le 15 février de ses résultats financiers annuels, « en ligne avec le plan “Lead the Future” » que sa directrice générale Christel Heydemann (photo) a présenté il y a un an (
Orange reste très rentable, avec un bénéfice net de près de 3 milliards d’euros en 2023 – 2.892 millions d’euros précisément, en croissance de 10,5 % sur un an. Depuis l’annonce le 15 février de ses résultats financiers annuels, « en ligne avec le plan “Lead the Future” » que sa directrice générale Christel Heydemann (photo) a présenté il y a un an (