En fait. Les 28 octobre, la plateforme de musique Tidal fête ses 10 ans. Misant sur la qualité hi-fi, elle a été lancée en 2014 par la société norvégienne et suédoise Aspiro à partir de son premier service de streaming musical pour mobiles, WiMP. Depuis 2021, Jack Dorsey la détient via Block (ex-Square).
En clair. La plateforme de streaming musical hi-fi Tidal a été lancée le 28 octobre 2014 par la société scandinave Aspiro en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada, en plus de la Norvège, Suède, du Danemark, de l’Allemagne et de la Pologne où préexistait depuis quatre ans le service de musique pour mobile WiMP (intégré ensuite dans Tidal). Misant sur la qualité « haute-fidélité sans perte » (1) pour se différencier du suédois Spotify, du français Deezer et de l’américain iTunes (Apple Music), Tidal s’étend en janvier 2015 à l’Irlande, aux Pays-Bas, à la Belgique et au Luxembourg.
C’est durant ce même mois que le rappeur et homme d’affaires américain Jay-Z (alias Shawn Carter) a acquis Aspiro. Jay-Z y voir un double avantage. D’abord, il croit au son hi-fi avec les formats Flac (2), la qualité CD (44,1 Khz), ainsi qu’en la norme japonaise Hi-Res (24 bits/192 Khz) que le français Qobuz (3) a été le premier à adopter.

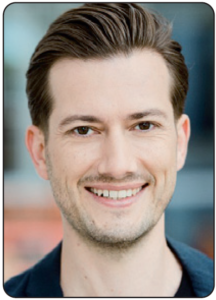
 « La croissance du streaming par abonnement en France reste trop lente, comparée à l’adoption massive du modèle payant dans les autres grands marchés historiques de la musique enregistrée », regrette le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), dont sont notamment membres les majors Universal Music, Sony Music et Warner Music. « Avec 11 millions d’abonnements payants, soit 1 million de plus que l’an passé, l’usage réunit désormais 16 millions d’utilisateurs premium, grâce aux offres famille et duo », indique à Edition Multimédi@ son directeur général, Alexandre Lasch (photo).
« La croissance du streaming par abonnement en France reste trop lente, comparée à l’adoption massive du modèle payant dans les autres grands marchés historiques de la musique enregistrée », regrette le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), dont sont notamment membres les majors Universal Music, Sony Music et Warner Music. « Avec 11 millions d’abonnements payants, soit 1 million de plus que l’an passé, l’usage réunit désormais 16 millions d’utilisateurs premium, grâce aux offres famille et duo », indique à Edition Multimédi@ son directeur général, Alexandre Lasch (photo).

