Mars 2000 et mars 2024. Près d’un quart de siècle sépare ses deux dates. La première marque l’éclatement de la « bulle Internet » ; la seconde est celle de l’état de la « bulle IA » aujourd’hui. Les perspectives de chiffre d’affaires de l’intelligence artificielle suscitent frénésie. Mais à risque.
 Euphorie, exubérance, spéculation, effervescence, irrationalité ou encore inconscience : toutes les conditions financières et comportementales sont aujourd’hui réunies pour que l’agitation planétaire autour des intelligences artificielles génératives fasse gonfler encore plus la « bulle IA » actuelle. Les géants du numérique et les start-up/licornes technologiques qui la composent au niveau mondial cumulent à elles seules dans ce domaine une valorisation totale – capitalistique et/ou boursière – qui se chiffre en trilliards d’euros, soit des milliers de milliards d’euros.
Euphorie, exubérance, spéculation, effervescence, irrationalité ou encore inconscience : toutes les conditions financières et comportementales sont aujourd’hui réunies pour que l’agitation planétaire autour des intelligences artificielles génératives fasse gonfler encore plus la « bulle IA » actuelle. Les géants du numérique et les start-up/licornes technologiques qui la composent au niveau mondial cumulent à elles seules dans ce domaine une valorisation totale – capitalistique et/ou boursière – qui se chiffre en trilliards d’euros, soit des milliers de milliards d’euros.
Pas « si » la bulle IA va éclater, mais « quand »
Et la licorne OpenAI – valorisée 80 milliards de dollars selon le New York Times daté du 16 février 2024 (1) – n’est que la partie émergée de l’iceberg du marché planétaire de l’intelligence artificielle. Présidée par son cofondateur Sam Altman (photo), elle s’est propulsée à la première place mondiale des IA génératives en lançant le 30 novembre 2022 – il y a seulement quatorze mois ! – ChatGPT. Et le chiffre d’affaires de la société californienne a bondi, grâce aussi à son autre IA générative à succès Dall·E, pour atteindre sur l’année 2023 la barre des 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, d’après cette fois le Financial Times du 9 février dernier (2). Du jamais vu, aussi bien en termes de valorisation que de revenu, pour une jeune pousse créée en 2015 sous forme de laboratoire de recherche en IA, à but non lucratif, et assortie depuis 2020 d’une entité commerciale.

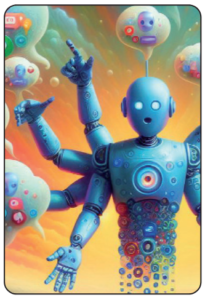 L’intelligence artificielle, c’est désormais le foisonnement permanent sur fond de bataille des LLM (Large Language Model), ces grands modèles de langage utilisés par les agents conversationnels et les IA génératives, capables d’exploiter en temps réel des milliards voire des dizaines de milliards de paramètres. Depuis le 30 novembre 2022, date du lancement fracassant de ChatGPT (
L’intelligence artificielle, c’est désormais le foisonnement permanent sur fond de bataille des LLM (Large Language Model), ces grands modèles de langage utilisés par les agents conversationnels et les IA génératives, capables d’exploiter en temps réel des milliards voire des dizaines de milliards de paramètres. Depuis le 30 novembre 2022, date du lancement fracassant de ChatGPT ( Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord.
Pour le commissaire européen Didier Reynders (photo), en charge de la Justice (protection des consommateurs comprise), c’est l’aboutissement de longs mois de réflexion, avec les professionnels concernés, sur la manière de mieux informer les consommateurs avant de choisir s’ils acceptent – ou pas – d’être suivis à la trace lors de leur navigation sur Internet. Même si l’année 2024 annonce la fin généralisée des cookies publicitaires, les internautes ont la possibilité de consentir à livrer des données anonymes les concernant à des fins publicitaires. L’Union européenne (UE) veut harmoniser les conditions d’informations des consommateurs du Net avant de donner ou pas leur accord. Cela fait près de 30 ans que la société américaine Verisign tire les ficelles de l’Internet mondial, à l’ombre du gouvernement des Etats-Unis et en coulisse, aux côtés de sa compatriote Icann (
Cela fait près de 30 ans que la société américaine Verisign tire les ficelles de l’Internet mondial, à l’ombre du gouvernement des Etats-Unis et en coulisse, aux côtés de sa compatriote Icann (