Après l’« ubérisation » de l’économie, voici la « tokenisation » des marchés, où les jetons nonfongibles – dits NFT – vont devenir monnaie courante : art, jeux vidéo, musique, livre, cinéma, … Mais cette « monétisation 3.0 » via des plateformes d’intermédiation soulève bien des questions.
Par Sandra Tubert et Laura Ziegler, avocates associées, Algo Avocats

Depuis plusieurs mois maintenant, les applications pratiques des « NFT » (Non- Fungible Tokens) se multiplient et différentes typologies d’acteurs s’y intéressent : des éditeurs de jeux vidéo aux plateformes d’échange de crypto-art, en passant par les marques de luxe, les start-up proposant de monétiser des données (
1) ou de créer de la valeur autour de leurs services. Cela se propage aussi aux autres industries culturelles souhaitant utiliser ces jetons non-fongibles, donc non-interchangeables et authentifiés sur une chaîne de blocs (blockchain), pour monétiser leurs œuvres (musiques, films, livres, etc.).
Tokenisation : vers l’économie Web 3.0
Employés pour une multitude d’usages et à même de « disrupter » de nombreux marchés, notamment en raison de leur nature spéculative (inhérente aux opérations de revente successives qu’ils facilitent), ces NFT suscitent à ce jour un engouement tout particulier dans le domaine de l’art, et plus largement des objets de collection, des jeux vidéo ou du sport. Ce recours grandissant à la blockchain pour gérer des actifs numériques en leur associant une unité de donnée non modifiable – tendance innovante appelée aussi « tokenisation » – participe de l’avis de certains à l’essor d’une nouvelle « économie numérique » apportant son lot de nouvelles opportunités et, inévitablement, de questionnements.
En France, selon le code monétaire et financier (CMF), un « token » (jeton) est un bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés sur une blockchain permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire du bien (
2).
Au cœur des dispositifs décentralisés co-existent plusieurs typologies de jetons cryptographiques, qui peuvent donner lieu à de nombreuses applications. Parmi celles-ci, les NFT – concept inventé en septembre 2017 par Dieter Shirley (
3) – occupent le devant de la scène depuis plusieurs mois. Ils ont pour particularité, à la différence de la cryptomonnaie (
4) comme le bitcoin ou d’autres actifs numériques émis dans le cadre de levées de fonds de type ICO (
5), d’être par nature non-fongibles, donc uniques et non interchangeables par un actif du même type. Identifié par le « contrat intelligent » ou smart-contract qui le génère, chaque NFT dispose d’un numéro unique d’identification et ne peut être reproduit. Cette particularité en fait son plus grand atout puisqu’elle permet ainsi d’apporter, en particulier aux biens numériques, la rareté et l’unicité qui leur faisaient défaut. D’un point de vue juridique, la qualification des NFT est débattue. En effet, les définitions d’« actifs numériques » proposées en France par le CMF (
6) – renvoyant, pour l’une, à la définition de « jetons » précitée (mise en place dans le cadre de la réglementation des ICO), et, pour l’autre, à la définition des cryptomonnaies (
7) – ne sont pas totalement satisfaisantes en ce qu’elles ne sont pas adaptées au caractère non fongible du NFT. Il sera donc plus prudent de rechercher la qualification juridique des NFT en fonction des actifs qu’ils représentent et des droits qu’ils confèrent (
8).
Le domaine de l’art reste l’un des principaux terrains de jeux des NFT (
9), en témoignent notamment la vente record de l’œuvre numérique « Everydays: the First 5 000 Days » du crypto-artiste Beeple pour 69,3 millions de dollars en mars 2021 (
10) et la levée de fond de 300 millions de dollars d’Opensea, l’une des principales plateformes de marché du domaine. Mais l’utilisation de ces NFT soulève des questions, à la fois sur la qualification du NFT lui-même et des droits qu’il confère, ainsi que sur le cadre contractuel offert par les plateformes d’échanges. Lorsqu’il est utilisé dans le domaine de l’art, le NFT ne doit pas être confondu avec l’œuvre numérique à laquelle il est attaché. Il est un actif distinct de l’œuvre elle-même.
NFT acheté et droits sur l’œuvre
D’ailleurs, le NFT en tant que tel ne remplit pas les conditions pour être lui-même une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle (CPI). C’est en réalité un token standard, sous licence open source, qui ne constitue pas une œuvre de l’esprit (
11). Ce jeton non fongible permet plutôt d’identifier l’œuvre concernée, d’attester de son intégrité et de son auteur, ainsi que de rattacher l’œuvre unique – identifiée par ce moyen – à ses propriétaires successifs. De sorte que le NFT s’apparente à un titre de propriété et à un certificat d’authenticité. Le NFT ne doit pas non plus être assimilé au support de l’œuvre qu’il désigne. En effet, le droit d’auteur distingue depuis toujours l’œuvre en tant que telle, sur laquelle s’appliquent les droits de propriété intellectuelle (droits patrimoniaux et moraux), et son support matériel, lequel peut être cédé indépendamment des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre. Le NFT ne fait ainsi qu’identifier l’œuvre par des pratiques qui peuvent varier (adresse URL vers sa représentation, simple référence, etc.). En réalité, l’œuvre numérique liée au NFT est la plupart du temps stockée et hébergée sur un serveur distinct en dehors de la blockchain sur laquelle le NFT est créé – à savoir sur un cloud, sur l’espace de stockage d’une galerie virtuelle, etc.
Encadrement possible et nécessaire
Sur les plateformes d’intermédiation, l’acquéreur de NFT achète en réalité un titre de propriété sur une œuvre numérique telle qu’identifiée dans le smart contract attaché au NFT. Il n’acquiert en aucun cas, automatiquement, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à cette œuvre numérique, à l’exception du droit d’en jouir et de l’exposer dans son cercle privé (notion relativement peu adaptée dans le monde numérique dans lequel le NFT a vocation à circuler). En effet, en droit français (
12), toute cession de droits de propriété intellectuelle sur une œuvre doit être écrite et respecter les formes exigées par le CPI pour être valable. Or, les plateformes d’échange de NFT, telles qu’Opensea et Rarible par exemple, ne permettent pas techniquement et facilement à ce jour aux créateurs et aux acheteurs de formaliser les conditions d’une telle cession via ces plateformes. L’enjeu en pratique pour les créateurs et les acheteurs de NFT est donc de pouvoir, via ces plateformes d’intermédiation, encadrer contractuellement, et dans les formes exigées par la loi, les autorisations accordées pour l’exploitation des œuvres : supports sur lesquelles elles peuvent être diffusées, reproduction, merchandising, etc. Cela est d’autant plus important que les NFT évoluent par nature dans un environnement numérique complexe (diversité des supports de diffusion, métavers, …) et qu’il sera essentiel dans ce contexte pour les acheteurs de connaître les droits d’exploitation dont ils disposent sur l’œuvre numérique. A défaut, les acheteurs s’exposent à des risques en matière de contrefaçon en faisant une utilisation non autorisée par l’auteur de l’œuvre identifiée par le NFT. Il est donc dans l’intérêt de chacun des acteurs d’encadrer un tel sujet. Cette cession de droits d’auteur qui précisera de manière détaillée les droits consentis à l’acheteur pourrait être matérialisée de différentes manières. On pourrait imaginer que le smart contract à l’origine de la création du NFT programme une transmission de la titularité des droits d’auteur sur l’œuvre accompagnant la création et la transmission du jeton, ce qui sera possible uniquement si le langage de programmation du smart contract le permet. A l’heure actuelle, ce n’est pas le cas de la majorité des plateformes. La mise en place d’un document autonome (rédigé par un avocat), vers lequel le smart contract pourrait renvoyer, serait également une solution. Par ailleurs, il serait envisageable, en pratique, de résumer les droits cédés dans les attributes du NFT, qui sont une sorte d’encart permettant d’intégrer une description succincte du bien et de ses caractéristiques. Dans ce dernier cas, les formes exigées par le CPI ne serait toutefois pas tout à fait respectées, de sorte que cette solution ne sera pas pleinement satisfaisante. Il n’est pas impossible par ailleurs que les plateformes d’intermédiation, à l’image de ce qu’ont pu faire les places de marché (marketplaces), mettent à disposition des créateurs de NFT une section ou un outil sur la plateforme leur permettant de préciser les conditions de cession attachées à leurs NFT.
Les utilisateurs de ces plateformes doivent par ailleurs avoir conscience des risques inhérents à l’utilisation de celles-ci, notamment l’acquisition d’œuvres contrefaisantes. Depuis quelques jours, la plateforme Opensea a mis elle-même en lumière ces problématiques en dévoilant sur Twitter que « plus de 80 % des articles créés avec cet outil [gratuit] étaient des œuvres plagiées, de fausses collections et du spam » (
13). Rien d’étonnant puisque, en qualité d’intermédiaires, ces plateformes n’effectuent aucune vérification quant à l’identité à la fois des créateurs de NFT, au fait qu’ils aient ou pas la qualité d’auteur à l’origine de la création de l’œuvre ou de titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, ou encore quant à l’authenticité ou la licéité ou non des contenus que les utilisateurs se proposent d’y échanger. D’une manière générale, les plateformes d’échange de NFT, telles que Opensea et Rarible, ne fournissent aucune garantie sur les transactions facilitées par le biais de leurs plateformes. Elles mettent toutefois en place un mécanisme de notification des contenus contrefaisants et illicites conformément aux exigences des lois locales qui leurs sont applicables, à savoir majoritairement à ce jour la loi américaine.
Eviter la « contrefaçon 3.0 »
Conscientes de l’importance d’instaurer une confiance nécessaire pour pérenniser leurs développements et d’éviter une explosion de la « contrefaçon 3.0 », les plateformes d’intermédiation semblent se saisir du sujet mais elles peinent toutefois à trouver des solutions concrètes pour endiguer l’échange d’œuvres contrefaisantes. Par exemple, récemment, Opensea avait annoncé limiter la création de nouveaux jetons à cinq collections NFT et 50 tokens pour chaque utilisateur, afin d’endiguer les dérives, mais la plateforme d’intermédiation a finalement fait machine arrière quelques jours plus tard (
14) face au mécontentement de sa communauté.
@
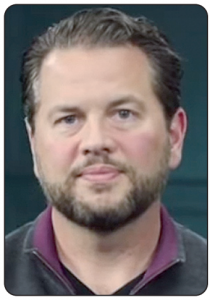 Pinterest affiche une santé insolente et une audience presque digne d’un Gafam : au mois de mai, la plateforme d’images et de photos à découvrir a atteint un record de fréquentation, avec 570 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Cela correspond à une hausse de 10 % sur un an – et même 23 % sur deux. La monétisation de cette audience, mesurée selon l’indicateur ARPU (1) très surveillé par le PDG Bill Ready (photo) et consolidé par trimestre, a été de 1,52 dollars au premier trimestre 2025, en hausse de 5 % sur un an). Il peut dépasser les 2 dollars comme au dernier trimestre 2024 (à 2,12 dollars précisément).
Pinterest affiche une santé insolente et une audience presque digne d’un Gafam : au mois de mai, la plateforme d’images et de photos à découvrir a atteint un record de fréquentation, avec 570 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Cela correspond à une hausse de 10 % sur un an – et même 23 % sur deux. La monétisation de cette audience, mesurée selon l’indicateur ARPU (1) très surveillé par le PDG Bill Ready (photo) et consolidé par trimestre, a été de 1,52 dollars au premier trimestre 2025, en hausse de 5 % sur un an). Il peut dépasser les 2 dollars comme au dernier trimestre 2024 (à 2,12 dollars précisément).
 La loi du 25 octobre 2021 de « régulation et de protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique », loi dite « Antipiratage » (
La loi du 25 octobre 2021 de « régulation et de protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique », loi dite « Antipiratage » ( Le législateur français a récemment accompli un progrès notable dans la sécurisation et la régulation de son espace numérique, avec l’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023, du projet de loi dite « SREN » (
Le législateur français a récemment accompli un progrès notable dans la sécurisation et la régulation de son espace numérique, avec l’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023, du projet de loi dite « SREN » ( Stéphane Kasriel (photo) est entré dans le groupe Facebook en Californie en août 2020, à l’époque où la division des technologies financières (fintech) de la firme de Menlo Park s’appelait encore Facebook Financial (F2) que dirigeait alors le Suisse franco-américain David Marcus (ancien président de PayPal). Le Français Stéphane Kasriel est recruté pour diriger une équipe d’ingénieurs au sein de cette entité F2 qui gère tous les services financiers du géant des réseaux sociaux, notamment le portefeuille numérique Novi, les systèmes de e-paiement WhatsApp Pay ou Facebook Pay, ainsi que les transferts d’argent transfrontaliers via NoviTransferts.
Après l’échec de Diem, des tokens pour payer
Jusqu’au jour où David Marcus annonce sur Twitter, le 28octobre 2021 et juste après le changement de nom du groupe Facebook en Meta Platforms, que la branche F2 prend le nouveau nom de Novi (
Stéphane Kasriel (photo) est entré dans le groupe Facebook en Californie en août 2020, à l’époque où la division des technologies financières (fintech) de la firme de Menlo Park s’appelait encore Facebook Financial (F2) que dirigeait alors le Suisse franco-américain David Marcus (ancien président de PayPal). Le Français Stéphane Kasriel est recruté pour diriger une équipe d’ingénieurs au sein de cette entité F2 qui gère tous les services financiers du géant des réseaux sociaux, notamment le portefeuille numérique Novi, les systèmes de e-paiement WhatsApp Pay ou Facebook Pay, ainsi que les transferts d’argent transfrontaliers via NoviTransferts.
Après l’échec de Diem, des tokens pour payer
Jusqu’au jour où David Marcus annonce sur Twitter, le 28octobre 2021 et juste après le changement de nom du groupe Facebook en Meta Platforms, que la branche F2 prend le nouveau nom de Novi ( Depuis plusieurs mois maintenant, les applications pratiques des « NFT » (Non- Fungible Tokens) se multiplient et différentes typologies d’acteurs s’y intéressent : des éditeurs de jeux vidéo aux plateformes d’échange de crypto-art, en passant par les marques de luxe, les start-up proposant de monétiser des données (
Depuis plusieurs mois maintenant, les applications pratiques des « NFT » (Non- Fungible Tokens) se multiplient et différentes typologies d’acteurs s’y intéressent : des éditeurs de jeux vidéo aux plateformes d’échange de crypto-art, en passant par les marques de luxe, les start-up proposant de monétiser des données (