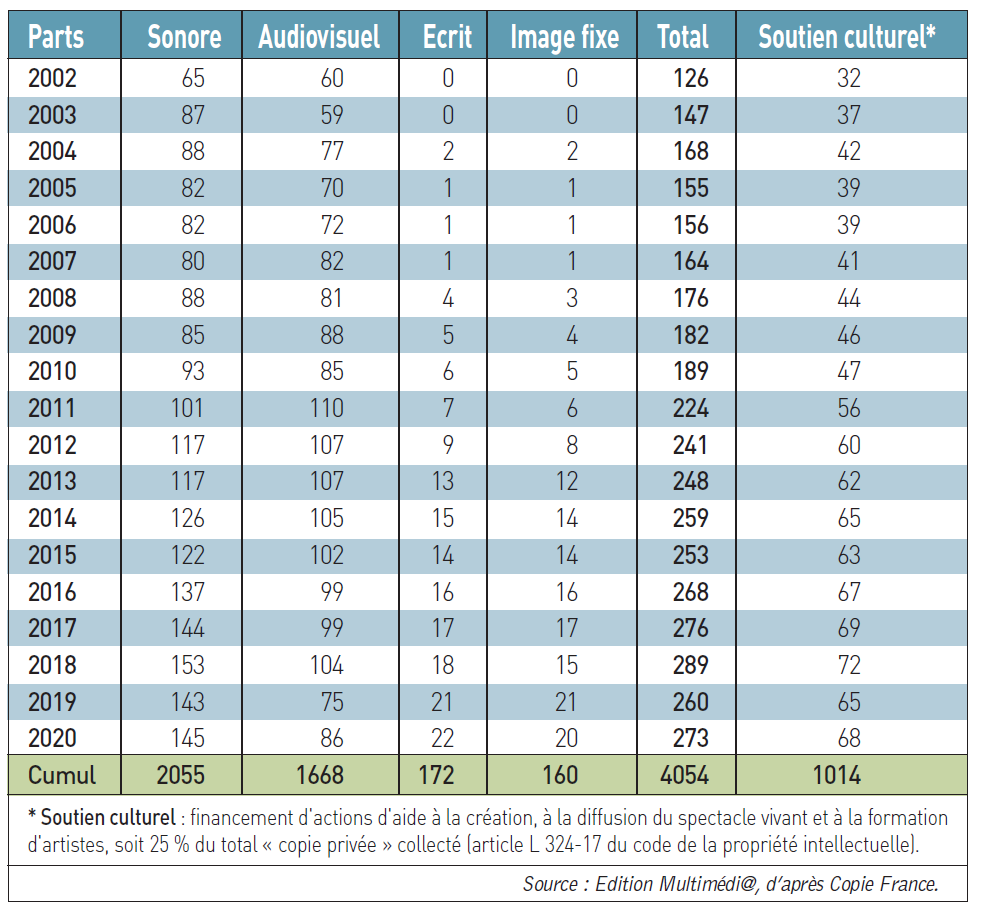Les milliardaires magnats des médias – Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Xavier Niel, Martin Bouygues, Patrick Drahi, … – ont réussi à annihiler les velléités des sénateurs à encadrer voire limiter la concentration des médias en France, en leur assurant qu’ils sont des « David » face aux « Goliath » du Net.
 Les sénateurs Laurent Lafon, président de la commission d’enquête sur la concentration dans les médias en France, et David Assouline (photo), le rapporteur de cette mission, ont présenté le 29 mars le rapport tant attendu destiné à « mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France » et à « évaluer l’impact de cette concentration dans une démocratie ». Finalement, le centriste et le socialiste ont cautionné l’idée, biaisée, selon laquelle la concentration des médias en France – ayant elle-même d’unique au monde de faire de plusieurs milliardaires leurs propriétaires en quête d’influence – se justifie par la concurrence des géants de l’Internet. Autrement dit, veut-on nous faire croire : c’est magnats contre Gafan, ou Gafam (1), soit une question de vie ou de mort pour les médias français. Cette justification à la concentration des médias en France aux mains de milliardaires, dont le cœur de métier ne se situe pas dans les médias mais dans des activités industrielles (ce que le fondateur du Monde Hubert Beuve-Méry désignait dans les années 1950 comme « la presse d’industrie »), est un tour de passe-passe qui a neutralisé cette commission d’enquête.
Les sénateurs Laurent Lafon, président de la commission d’enquête sur la concentration dans les médias en France, et David Assouline (photo), le rapporteur de cette mission, ont présenté le 29 mars le rapport tant attendu destiné à « mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France » et à « évaluer l’impact de cette concentration dans une démocratie ». Finalement, le centriste et le socialiste ont cautionné l’idée, biaisée, selon laquelle la concentration des médias en France – ayant elle-même d’unique au monde de faire de plusieurs milliardaires leurs propriétaires en quête d’influence – se justifie par la concurrence des géants de l’Internet. Autrement dit, veut-on nous faire croire : c’est magnats contre Gafan, ou Gafam (1), soit une question de vie ou de mort pour les médias français. Cette justification à la concentration des médias en France aux mains de milliardaires, dont le cœur de métier ne se situe pas dans les médias mais dans des activités industrielles (ce que le fondateur du Monde Hubert Beuve-Méry désignait dans les années 1950 comme « la presse d’industrie »), est un tour de passe-passe qui a neutralisé cette commission d’enquête.
Bernard Arnault, « sauveur » des Echos et du Parisien
« Ces médias auraient-ils survécu s’ils n’avaient pas reçu l’investissement d’un actionnaire comme LVMH ? Vous me permettrez d’en douter : compte tenu (…) de l’ampleur des révolutions technologiques actuelles », a lancé Bernard Arnault, PDG du groupe Louis Vuitton- Moët Hennessy et propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Echos, lors de son audition du 20 janvier. Et d’assurer : « Le rôle de LVMH en tant qu’actionnaire du groupe de presse Les Echos-Le Parisien consiste essentiellement à accompagner l’adaptation de cette entité face à la concurrence de plus en plus forte des médias numériques planétaires ». En invoquant le spectre des grandes plateformes mondiales du numérique, les tycoons de la presse, de la télé et de l’édition se sont présentés devant les sénateurs comme le moindre mal pour le paysage médiatique français. Face aux géants du Net, les rapprochements entre entreprises de médias au sein de grands groupes sont présentés comme la réponse stratégique.
Concentration des médias : le moindre mal ?
Ce serait le cas de l’absorption annoncée du groupe Lagardère par le groupe Vivendi (fusion d’Hachette et d’Editis incluse), dans le seul but d’atteindre une taille critique. « Contrairement à ce qui se dit partout, nous sommes encore tout petits, bien que nous progressions en effet », a tenu à dire, lors de son audition le 19 janvier, Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Bolloré, ancien président du conseil de surveillance de Vivendi et du groupe Canal+. Et, slides à l’appui : « Notre capitalisation boursière s’établit à 15 milliards d’euros, contre 156 milliards pour Sony, 287 milliards pour Disney, 586 milliards pour Tencent, 2.812 milliards pour Apple. En réalité, le géant Vivendi est un nain ». Le propriétaire de Vivendi mentionnant aussi les rachats de MGM (Metro Goldwyn Mayer) par Amazon et d’Activision-Blizzard par Microsoft. Outre cette concurrence de géants, le milliardaire breton a fait part de son inquiétude : « Le vrai danger provient des Gafa, qui pèsent un poids considérable et passent au travers de tuyaux non contrôlés ou contrôlables. (…) La concentration des médias pose forcément problème. La taille de nos concurrents aussi. (…) Nos concurrents sont énormes. (…) Nos concurrents sont les plateformes de cinéma ou de séries telles qu’Amazon, Apple ou Netflix, plus que Bertelsmann [le groupe allemand qui vend à TF1 son concurrent télévisuel M6, ndlr] ».
Pour expliquer, en le justifiant, que les médias sont progressivement détenus par les mêmes groupes, comme ce sera le cas de TF1 et M6 si l’Autorité de la concurrence donnait son aval à cette fusion, les patrons de médias français – auxquels les sénateurs emboîtent finalement le pas dans leur rapport – invoquent encore « la révolution numérique ». Martin Bouygues, président du groupe Bouygues, maison-mère de TF1 en passe d’absorber son rival M6, ne dit pas autre chose lors de son audition le 18 février : « Le métier de la télévision fait face à la plus grande mutation de son histoire récente et il est indispensable de croître pour résister et construire l’avenir. (…) Les contenus audiovisuels sont de moins en moins accessibles pour les chaînes. Les grands studios américains produisent des contenus exclusifs et les gardent désormais pour leurs propres plateformes » (2). Et Martin Bouygues de tirer la sonnette d’alarme : « L’arrivée d’acteurs de taille planétaire que sont les Gafam change tout. (…) Ces bouleversements peuvent, à terme plus ou moins rapide, tuer le modèle économique de la télévision ». Auditionné le 28 janvier, Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6, a lui aussi mis en balance de la concentration TF1-M6 les géants américains en mouvement : « Des regroupements gigantesques ont [eu] lieu entre Fox et Disney. Netflix vient d’installer à Hollywood son co-CEO. Il n’y a pas de frontières des Ardennes pour l’audiovisuel français. Nous sommes confrontés à ces acteurs, qui sont plutôt avantagés par la réglementation qui leur est imposée ». Et le patron de M6 d’ajouter à l’attention des sénateurs : « On ne peut pas affirmer simultanément que nous sommes trop petits pour lutter contre les Gafam et trop gros au regard de l’audiovisuel français, que nous mettrions à mal ».
De son côté, Patrick Drahi, fondateur et propriétaire d’Altice (maison-mère de BFM, RMC et SFR), en passe de racheter les chaînes TFX et 6ter en cas de fusion TF1-M6, a en outre plaidé le 2 février pour un passage de quatre à trois opérateurs télécoms en France, tout en assurant qu’aucune discussion entre Altice et Free n’avait lieu : « Je pense que ce serait mieux pour le marché français que deux opérateurs français se rapprochent pour être plus forts » (3). Et de lancer : « Comment lutter contre les Gafa ? J’ai une idée. Vous n’allez pas l’aimer. Pourtant, c’est la bonne. (…) Si ces plateformes payaient en fonction du débit qu’elles utilisent, cela générerait des revenus supplémentaires [pour les opérateurs de réseau] que nous pourrions investir pour nous renforcer et nous déployer davantage ».
La commission d’enquête sur la concentration dans les médias en France semble avoir pris fait et cause pour les magnats milliardaires qui se sont présentés à eux fragilisés par les géants du numérique et du streaming. « La logique économique des concentrations est revendiquée et justifiée par leurs promoteurs par l’accélération de l’irruption de grandes plateformes numériques », prend acte la commission d’enquête aux termes de ses travaux qui ont duré près de quatre mois.
« Nous ne quémandons pas votre aide » (Bolloré)
Dit autrement, dans le rapport sénatorial de 379 pages assorti de 852 pages de comptes-rendus d’auditions : « Les mouvements de concentration dans le secteur des médias sont justifiés, selon les acteurs, en grande partie par des impératifs économiques destinés à prendre en compte le bouleversement des usages induits par la révolution numérique ». Le législateur volera-t-il au secours des tycoons français pour assouplir en France les règles de concentration des médias afin de résister aux Big Tech ? « Je n’ai pas demandé que vous nous défendiez contre les Gafam. Nous nous débrouillerons. (…) Nous ne quémandons pas votre aide », s’est défendu Vincent Bolloré. Sur les 32 propositions émises par les sénateurs, aucune n’empêche les médias en France de continuer à se concentrer entre les mains d’une poignée d’industriels. @
Charles de Laubier