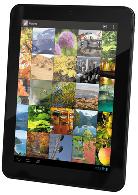En fait. Le 14 juin, la commission TV connectée du Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste) s’est réunie sous la présidence d’Eric Scherer, directeur de la prospective, de la stratégie et des relations internationales de France Télévisions. Vers la fin de la programmation ?
En clair. La télévision de rattrapage (TVR), la vidéo à la demande (VOD) et la télévision connectée (TVC) sont en train de bousculer les grilles de programmation des chaînes. Les télénautes, de plus ne plus nombreux, prennent le contrôle de « leur » télévision sur
le mode « Atawad » (1) pour une consommation en mobilité. « Il y a de moins en moins de vrais directs. Nous sommes au début d’un point d’inflexion. La VOD devient une chaîne. Le public se moque du tuyau, peu importe que cela soit de la télévision, de l’Internet ou
de la vidéo », constate Eric Scherer. Les fonctions de replay, de time-sharing, de reprise de programme en cours depuis le début (2), la navigation en avance et retour rapide ou
la mise en pause sont autant de ruptures dans l’usage que des utilisateurs se font de la télévision. Et l’on est qu’au début de cette dé-linéarisation qui prendra une autre dimension avec le cloud et l’enregistrement vidéo numérique, ou DVR (Digital Video Recorder).
Alors que l’innovation pour le second écran relègue au second plan le téléviseur, les moteurs et les algorithmes deviennent de vrais programmateurs de chaînes personnalisées. Face à cette fragmentation des programmes et de l’audience, les chaînes sont en train de perdre leur pouvoir de contrôle audiovisuel. C’est là que tout se joue :
la recommandation prend le pas sur la programmation. Netflix n’a-t-il pas plus de 900 développeurs pour améliorer sans cesse la pertinence de ses recommandations et en y consacrant un budget de 350 millions de dollars par an ? Des sociétés se sont spécialisé dans la recommandation « content centric » comme le français Spideo, l’israélien Jinni ou l’américain Fanhattan. Fondée en 2010 et en cours de levée de fonds, la start-up Spideo
a déjà apporté son savoir-faire en moteurs de recommandations à CanalPlus Infinity, le service de SVOD de Canal+. « Avec le “content centric”, nous offrons une pertinence à 100 % des recommandations là où les recommandations par statistiques n’obtiennent
que 90 % », affirme Gabriel Mandelbaum, fondateur de Spideo. Mais son ambition est de s’imposer sur toutes les plates-formes avec sa propre application Spideo, s’appuyant sur les catalogues iTunes et Netflix aux Etats-Unis, seulement iTunes en France et bientôt Lovefilm. Apple l’apprécie beaucoup. Au point de le racheter à terme ? « C’est envisageable ! », répond sans rire Gabriel Mandelbaum. @
 « Moi, président de la République, je n’aurai pas la prétention de nommer les présidents des chaînes publiques, je laisserai ça à des instances indépendantes », déclarait le 2 mai 2012 le candidat François Hollande dans sa désormais célèbre anaphore de l’entre-deux tours. Voilà qui sera bientôt chose faite. Les contours du premier texte de réforme de l’audiovisuel – sur les deux voire trois qui sont au total attendus – ont été confirmés en Conseil des ministres du 5 juin 2013 (1). Ce projet de loi sera soumis en première lecture à l’Assemblée nationale le 24 juillet, soit avant la fin de la session parlementaire.
« Moi, président de la République, je n’aurai pas la prétention de nommer les présidents des chaînes publiques, je laisserai ça à des instances indépendantes », déclarait le 2 mai 2012 le candidat François Hollande dans sa désormais célèbre anaphore de l’entre-deux tours. Voilà qui sera bientôt chose faite. Les contours du premier texte de réforme de l’audiovisuel – sur les deux voire trois qui sont au total attendus – ont été confirmés en Conseil des ministres du 5 juin 2013 (1). Ce projet de loi sera soumis en première lecture à l’Assemblée nationale le 24 juillet, soit avant la fin de la session parlementaire.