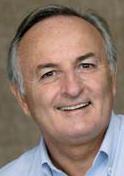En fait. Le 23 mai, le Snep – qui représente notamment les majors de la musique – a publié les chiffres du marché de la musique enregistrée au premier trimestre 2012 : numérique + 24 % à 32,6 millions d’euros, physique – 13 % à 83,1 millions. Un satisfecit décerné à l’Hadopi. Un blâme adressé aux radios.
En clair. Si les radios restent encore les privilégiées en tant que « première fenêtre » de diffusion des nouveautés musicales produites par la filière, elles ne satisfont pas du tout les producteurs de musique. En dressant l’état du marché français de la musique enregistrée pour le premier trimestre, le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) en a profité pour reprocher aux radios de ne pas suffisamment diffuser de nouveautés francophones. « La situation est alarmiste et nous allons interpeller les pouvoirs publics sur le fait que 7 % des titres envoyés aux radios représentent les trois-quarts de leurs diffusions. Il y a matraquage au détriment de la diversité musicale », déplore David El Sayegh, directeur général du Snep. Pour le syndicat des majors du disque (1), le CSA (2) n’y remédie pas. « Cette absence de diversité nous tue autant que la piraterie. (…) Il faut une modification législative », lance-t-il (3). Quant au président du Snep, Denis Ladegaillerie, par ailleurs directeur général du label Believe Digital, il rappelle que « la radio est le premier média de prescription pour la musique » et que « si un titre est diffusé à la radio, ses ventes augmentent aussi sur Internet ». Est-ce à dire que les producteurs de musique continuent à trop privilégier la radio pour la diffusion de leurs nouveautés au détriment d’autres médias comme le Web ? Autrement dit : la radio est-elle à la musique ce que la salle est au cinéma ? « S’il y a chronologie des médias dans la musique, la durée de diffusion d’un titre à la radio est de plus en plus courte : un mois environ, pas plus », répond David El Sayegh à Edition Multimédi@. Alors que pour les films, la première de diffusion est de quatre mois pour les salles de cinéma. « J’aimerais bien que YouTube lance des titres nouveaux comme le font les radios, mais YouTube veut rester un hébergeur et non pas devenir éditeur [avec les responsabilité plus lourde que cela comporte vis-à-vis du piratage, ndlr] », regrette pour sa part Denis Ladegaillerie. Sur le Net, il n’y a d’ailleurs pas de quotas de diffusion (lire EM@56, p. 3). Le Snep espère en tout cas que la radio numérique terrestre (RNT), pour laquelle il se dit favorable, « ouvrira la voie à la diversité ». Or les grandes radios (4) n’en veulent pas. Décidément, le torchon brûle entre les majors et les grandes stations… @