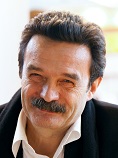En fait. Le 22 juin, le Groupement des éditeurs de contenus et de services
en ligne (Geste) a tenu son assemblée générale annuelle. Elle s’est terminée par une table-ronde : « Boom de la réalité virtuelle, quelles retombées pour les médias ? ». Une récente étude de la Knight Foundation apporte des réponses.
En clair. L’information et la réalité virtuelle vont-elle faire bon ménage au sein des médias ? Une étude publiée en mars dernier par la Knight Foundation (1), une organisation basée à Miami (en Floride) qui finance des projets liés au journalisme et à l’innovation dans les médias, s’est penchée sur le potentiel de la réalité virtuelle dans le journalisme : « Viewing the Future? Virtual Reality in Journalism » (2). Aux Etats-Unis, la VR (Virtual Reality) commence à s’inviter dans les rédactions. « Je n’irais pas jusqu’à dire que la VR est l’avenir de journalisme, comme je n’aurais pas dit que la télé, la radio ou la photographie étaient “l’avenir de journalisme” à leurs débuts. Sans aucun doute, ils étaient révolutionnaires et ont permis d’apporter des facettes supplémentaires aux histoires, lesquelles sont devenues subitement plus réelles aux publics. Mais ce n’est pas comme s’ils avaient anéantis une forme de journalisme ou une autre entièrement », a temporisé Jessica Yu, directrice adjointe de la rédaction du Wall Street Journal dont elle est responsable mondial des images, selon ses propos rapportés dans l’étude. Le quotidien financier américain, filiale du groupe News Corp de Rupert Murdoch depuis 2007, a lancé il y a quatorze mois une application de réalité virtuelle de « montagnes russes » permettant de suivre les hauts et les bas du Nasdaq (3). De son côté, le New York Times interpelle ses lecteurs : « Mettez-vous au centre de nos histoires dans une expérience de réalité virtuelle immersive ». L’application NYT VR, disponible sur iOS ou Android, a été lancée en novembre 2015 pour regarder une vidéo en 360 degrés sur les enfants réfugiés intitulée « The Displaced » (4). Plus de 1,3 million de visionneuses en carton de type Google Cardboard ont été distribuées pour regarder en réalité virtuelle – à partir d’un smarphone inséré dansms ce casque de VR – la vie réelle des réfugiés. Aux Etats-Unis, le Los Angeles Times ou encore ABC News ont fait leurs premiers pas dans la réalité virtuelle avec respectivement « Discovering Gale Crater » (5) et « Inside North Korea » (6).
En Europe, la BBC a créé en juin 2015 une vidéo 360 degrés montant la vie dans un camp de réfugiés syriens dans le Nord de la France, à Calais (7). « La technologie [VR] n’est pas encore prête à la production, et la post-production est trop lente », prévient Cyrus Saihan, directeur du développement de BBC Future Media. Quant au modèle économique…@
 Les actionnaires du groupe Lagardère SCA – société en commandite par actions, dont Arnaud Lagardère (photo) est le gérant (1) – sont convoqués à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 mai au Carrousel du Louvre à Paris. Il s’agira notamment pour eux d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2017, lequel affiche un bénéfice net
Les actionnaires du groupe Lagardère SCA – société en commandite par actions, dont Arnaud Lagardère (photo) est le gérant (1) – sont convoqués à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 mai au Carrousel du Louvre à Paris. Il s’agira notamment pour eux d’approuver les comptes consolidés de l’exercice 2017, lequel affiche un bénéfice net