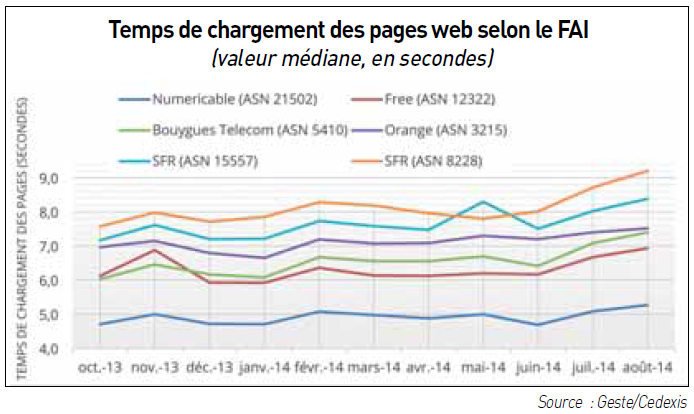En fait. Le 27 septembre, Thom Yorke, le leader du groupe de rock britannique Radiohead, a sorti son deuxième nouvel album en solo disponible sur le nouveau site BitTorrent Bundle pour 6 dollars (4,72 euros). Il expérimente ainsi une distribution directe – passant outre les intermédiaires – sur peer-to-peer.
En clair. Court-circuiter les producteurs et distributeurs des industries culturelles ! C’est ce que prône le principal chanteur du groupe Radiohead. « C’est une expérimentation pour voir si le mécanisme de ce système correspond à ce que le grand public attend.
Si cela marche, cela pourrait être une façon effective de reprendre le contrôle du commerce Internet pour les gens qui créent leurs oeuvres. Permettre à ceux qui font leur musique, leur vidéo ou tout autre contenu numérique de le vendre eux-mêmes.
Et de contourner les distributeurs (gatekeepers) autodéclarés. Si cela marche, tout le monde pourra faire exactement comme nous avons fait », a expliqué en détail le Britannique Thom Yorke, à l’occasion de la promotion à la fois de son nouvelle album en solo mais aussi de la nouvelle plateforme peer-to-peer « Bundle » de BitTorrent. L’album « Tomorrow’s Modern Boxes » est payant mais l’offre en ligne comprend aussi deux titres gratuit en téléchargement. Le musicien l’a fait savoir auprès de ses 588.000 abonnés à son compte Twitter : « J’essaie quelque chose de nouveau ; je ne sais pas comment cela se passera. Mais voici [renvoyant vers la page de son nouvel album sur BitTorrent Bundle]». Radiohead n’en est pas à sa première tentative de distribution directe par Internet. En 2011, l’album « The King of Limbs » avait été d’abord proposé aux internautes. Dès 2007, le groupe britannique avait proposé sur Internet un autre de leurs albums, « In Rainbows ». Cette initiative de Thom Yorke intervient une quinzaine de jours après que le groupe irlandais U2 ait mis gratuitement sur iTunes (1) son nouvel album « Songs of Innocence », le chanteur leader Bono ayant présenté cette offre aux côtés du PDG d’Apple, Tim Cook, au moment du lancement de l’iPhone 6. Mais cette tentative de Thom Yorke de s’affranchir des « intermédiaires auto-proclamés » arrive à la suite du différend qui oppose depuis le printemps dernier les producteurs de musique indépendants réunis dans la Worldwide Independent Music Industry Network (WIN)
– où est représenté le label indépendant XL de Radiohead – à YouTube (2).
Et ce, au moment où beaucoup de musiciens et d’artistes d’interrogent sur leur juste rémunération à l’heure du Net. Le chanteur français Grégoire s’était, lui, fait connaître directement sur Internet après s’être inscrit sur le site My Major Company fin 2007… @
 Les organismes, entreprises ou établissements publics ont l’obligation légale de garantir la sécurité des données à caractère personnel qu’ils traitent ou qui sont traitées pour leur compte par des prestataires. Cette obligation résulte de la loi « Informatique et Libertés », selon laquelle « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient
Les organismes, entreprises ou établissements publics ont l’obligation légale de garantir la sécurité des données à caractère personnel qu’ils traitent ou qui sont traitées pour leur compte par des prestataires. Cette obligation résulte de la loi « Informatique et Libertés », selon laquelle « le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient