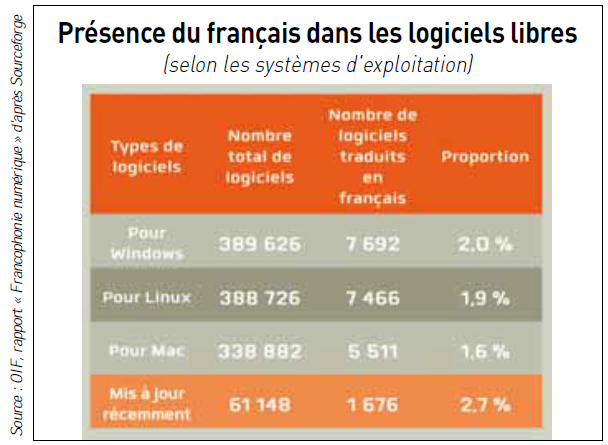La Norvège a accueilli durant une semaine (23-27 juin 2025) la 20e édition de l’Internet Governance Forum (IGN), organisé sous tutelle de l’ONU, sur le thème cette année de « Construire ensemble la gouvernance numérique ». La géopolitique n’a jamais été aussi menaçante pour l’Internet ouvert.
 « L’année 2025 est une étape importante pour le Forum sur la gouvernance de l’Internet, car elle marque l’occasion du 20e anniversaire du forum, et c’est un moment charnière pour façonner et améliorer le dialogue multipartite pour les années à venir », souligne Karianne Oldernes Tung (photo), ministre norvégienne de la Numérisation et de la Gouvernance publique. Son pays vient d’organiser durant une semaine (23-27 juin 2025) la 20e édition de l’Internet Governance Forum (IGN), à Lillestrøm, ville située à environ 18 km au nord-est de la capitale de la Norvège, Oslo.
« L’année 2025 est une étape importante pour le Forum sur la gouvernance de l’Internet, car elle marque l’occasion du 20e anniversaire du forum, et c’est un moment charnière pour façonner et améliorer le dialogue multipartite pour les années à venir », souligne Karianne Oldernes Tung (photo), ministre norvégienne de la Numérisation et de la Gouvernance publique. Son pays vient d’organiser durant une semaine (23-27 juin 2025) la 20e édition de l’Internet Governance Forum (IGN), à Lillestrøm, ville située à environ 18 km au nord-est de la capitale de la Norvège, Oslo.
Internet ouvert et fracture numérique
« Ensemble, nous renforcerons la diversité et la collaboration grâce à une gouvernance numérique inclusive, qui est essentielle à un écosystème numérique dynamique et durable », poursuit-elle dans son message de bienvenue, sur le site web dédié à l’événement international (1). Cette vingtième édition de l’IGN, sur le thème cette année de « Construire ensemble la gouvernance numérique » (2), s’est tenue à six mois de la prochaine réunion du « SMSI+ 20 » qui se déroulera en décembre 2025.
Ce grand rendez-vous planétaire de fin d’année doit tirer le bilan des deux décennies qui se sont écoulées depuis le premier Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) qui avait eu lieu en 2005 à Tunis, en débouchant sur l’« Agenda de Tunis » (3) approuvé par les 175 membres des Nations Unies (ONU). Ce document de consensus politique, qui n’est pas un traité international, désigne (suite)