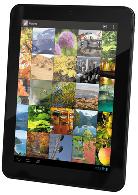La gestion des ressources rares, au-delà d’alimenter des discussions savantes entre économistes, a toujours des répercutions sur notre vie quotidienne. Certaines, comme l’eau, l’air, les métaux précieux ou l’espace pour les transports urbains sont très concrètes et nous percevons chaque jour un peu plus leur rareté. D’autres sont très longtemps restées dans l’ombre. Les fréquences hertziennes sont de celles-là, invisibles et discrètes pendant des décennies, puis s’invitant régulièrement dans les débats avec l’explosion des services mobiles et la multiplication des chaînes de télévision. Une pression telle que certains n’hésitèrent pas à prédire l’écroulement des plans d’allocation des fréquences ! La pression est en effet montée régulièrement à partir des années 2000 et à chaque changement de réseaux hertziens. Le basculement d’un Internet fixe vers
La gestion des ressources rares, au-delà d’alimenter des discussions savantes entre économistes, a toujours des répercutions sur notre vie quotidienne. Certaines, comme l’eau, l’air, les métaux précieux ou l’espace pour les transports urbains sont très concrètes et nous percevons chaque jour un peu plus leur rareté. D’autres sont très longtemps restées dans l’ombre. Les fréquences hertziennes sont de celles-là, invisibles et discrètes pendant des décennies, puis s’invitant régulièrement dans les débats avec l’explosion des services mobiles et la multiplication des chaînes de télévision. Une pression telle que certains n’hésitèrent pas à prédire l’écroulement des plans d’allocation des fréquences ! La pression est en effet montée régulièrement à partir des années 2000 et à chaque changement de réseaux hertziens. Le basculement d’un Internet fixe vers
un Internet mobile, l’usage massif de la vidéo et surtout le développement exponentiel
des usages et du nombre des mobinautes, ont engagé les opérateurs et les Etats dans une course à la puissance des réseaux mobiles. Une course en escalier, où chaque marche correspond à une nouvelle génération de réseaux : 3G, 4G et 5G. Et pour chaque transition, tous les dix ans en moyenne, la question incontournable des fréquences disponibles pour satisfaire cette faim dévorante de spectre radioélectrique. N’oublions pas que, depuis 2010, le volume de données échangées sur les réseaux mobiles du monde entier a été multiplié par plus de 30, pour se monter aujourd’hui à 130 milliards de gigaoctets.
« Cette fameuse bande des 700 Mhz était
l’occasion de permettre une harmonisation spectrale
à l’échelle européenne mais aussi mondiale. »