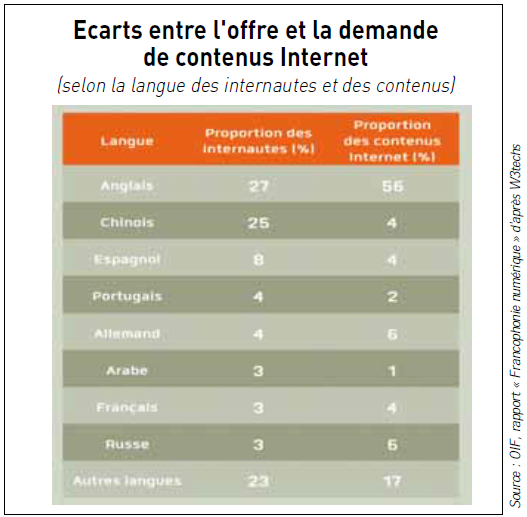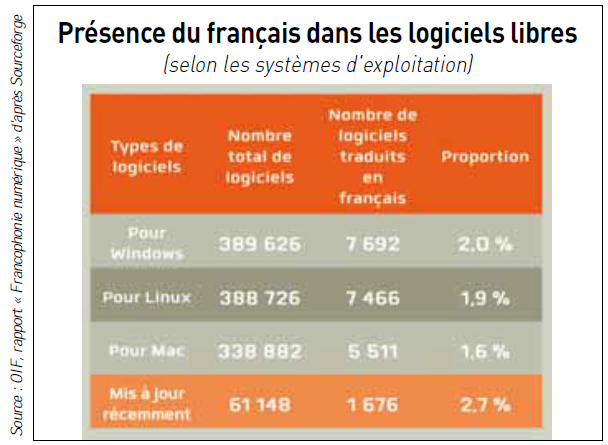En fait. Le 26 février, la majorité des membres – trois des cinq – du régulateur
des télécoms américain, la FCC, a voté pour de nouvelles règles plus strictes
en faveur de la neutralité de l’Internet aux Etats- Unis. Barack Obama s’est dit satisfait. Mais cela suppose de légiférer devant un Congrès hostile.
En clair. Comme les trois membres de la FCC (Federal Communications Commission) sont démocrates comme le président Obama, lequel avait pris position le 10 novembre 2014 en faveur d’une « stricte » neutralité du Net dans un « President’s Statement » (1), c’est à la majorité qu’ont été adoptées les nouvelles règles « Open Internet ».
Deux membres de la FCC, républicains, ont voté contre. Ces nouvelles règles, qui doivent encore être examinées par le Congrès américain dominé par les républicains, se résument en trois « no » : « no blocking, no throttling, no paid prioritization » (aucun blocage, aucun étranglement, aucune priorisation payée). Autrement dit : pas d’Internet à deux vitesses aux Etats- Unis. Cela veut dire que si un internaute ou un mobinaute – car cette neutralité stricte s’applique au fixe et au mobile – demandent l’accès à un site Web ou à un service dont le contenu est a priori légal : le fournisseur d’accès à Internet (FAI) ne pourra bloquer cet accès ; les contenus ne pourront être discriminés au profit d’autres ; les sites web n’auront pas besoin d’acheter des lignes prioritaires ou les FAI le leur proposer. En désignant le haut débit fixe et mobile « services publics » (lire EM@117, p. 4), la FCC se donne le pouvoir d’imposer la neutralité du Net. Cette
« stricte » neutralité du Net – exigée par Barack Obama (2), moins de deux ans avant son départ en janvier 2017 – provoque l’ire des opérateurs télécoms américains : AT&T vient de suspendre le déploiement de son réseau de fibre optique ; Verizon, Comcast et d’autres FAI sont aussi vent debout contre « Open Internet ». En revanche, les géants du Web – ayant le soutien des démocrates et du président des Etats-Unis – applaudissent des deux mains et demandent à ce que la stricte neutralité d’Internet entre maintenant en vigueur. Amazon, eBay, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo
ou encore Samsung, tous réunis au sein de la CCIA (Computer & Communications Industry Association), ainsi que Netflix, Apple et les autres OTT (Over-The-Top), y
sont favorables. Les nouvelles règles « Open Internet » pourraient s’appliquer dans quelques semaines ou mois, selon les recours devant la justice de la part des opérateurs télécoms ou les tentatives législatives des républicains pour invalider
ces règles. Mais Barack Obama détient une arme devant le Congrès américain :
son droit de veto. @
 Edition Multimédi@ : Vous dénoncez le partage
Edition Multimédi@ : Vous dénoncez le partage