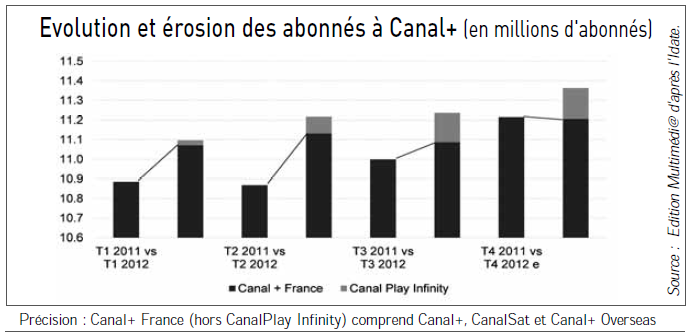En fait. Le 11 mars, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis sur les
conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobile : au nom
de la « concurrence par les infrastructures », l’accord d’itinérance entre France Télécom et Iliad ne doit pas être prolongé au-delà de 2016 ou 2018.
En clair. L’Autorité de la concurrence a d’emblée motivé son avis en « réaffirm[ant]
son attachement à la concurrence par les infrastructures ». Bien que l’avis du 11 mars
ne porte que sur les réseaux mobile, les sages de la rue de l’Echelle évoquent plus largement, en introduction, le « paradigme » de la concurrence par les infrastructures
« dans le secteur des télécommunications », entendez mobile ou fixe notamment.
Or, en marge d’un point presse, organisé le 11 mars par le président de l’Autorité de la concurrence, son président Bruno Lasserre n’as pas voulu nous dire si, l’extinction du réseau de cuivre au profit de la fibre optique, n’allait pas dans le fixe à l’encontre de ce principe de « concurrence par les infrastructures ». En effet, alors que le VDSL2 va être autorisé pour faire évoluer la boucle locale de cuivre vers du très haut débit, le gouvernement prévoit – d’ici à 2025 ? – l’extinction de ce réseau historique en vue de
« couvrir 100 % de la France en très haut débit d’ici à 2022 » et « très majoritairement »
en FTTH (1) – moyennant 20 milliards d’euros (2). Cette extinction du cuivre pourrait se faire au détriment de la concurrence, dans la mesure où peu d’opérateurs (Orange, SFR, Free, Numericable et Bouygues) auront les capacités d’investir dans leur propre réseau de fibre optique.
Pourtant, l’Autorité de la concurrence le rappelle : « Dans le secteur des communications électroniques, la concurrence par les infrastructures a été le type de concurrence privilégié de façon constante jusqu’à aujourd’hui », souligne l’avis en préambule. Cela suppose, rappelle-t-elle, que « chacun [des opérateurs télécoms mobile ou fixe, ndlr] s’appuie à terme sur son propre réseau ». L’Arcep est, elle aussi, très attachée à cette concurrence par les infrastructures, mobile ou fixe, comme elle l’a exprimé dans son avis à l’Autorité de la concurrence rendu le 20 décembre : « Plusieurs exemples, dans le passé, attestent de l’effet bénéfique pour les consommateurs de la concurrence par les infrastructures, parmi lesquels l’arrivée [de] Bouygues Telecom en 1994, ou, sur le fixe,
la mise en oeuvre progressive du dégroupage [sur le réseau fixe de cuivre, ndlr] depuis
le début des années 2000 ».
Si la concurrence par les infrastructures se renforcera à partir de 2016 ou 2018 dans les mobiles, elle devrait, paradoxalement, s’affaiblir dans le fixe. @