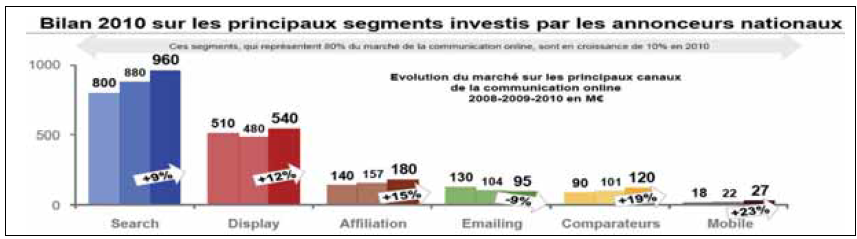En fait. Le 9 janvier, se sont refermées les portes de la grande foire internationale de Las Vegas de l’électronique grand public et du tout-connecté à l’Internet.
Les mobiles, les tablettes, les téléviseurs, les gadgets, la maison, les objets,
… Il y aura vraiment de plus en plus de monde sur la ligne.
En clair. C’est à se demander si les réseaux de communications électroniques pourront supporter tous ces terminaux et objets connectés, tant ce fut une débauche d’innovations technologiques au Consumer Electronics Show (CES). Mais à Las Vegas, la question de l’explosion des flux sur Internet ne se pose jamais. Et la question du
« Qui finance le réseau ? » sur fond de débat sur la Net Neutrality encore moins ! Même si les tablettes multimédias ne représenteront pas les volumes qu’atteignent
les smartphones dans le monde, elles ont tenu la vedette au salon international des technologies grand public (Xoom de Motorola, Sliding de Samsung, Streak 7 de Dell, LePad de Lenovo, PlayBook de RIM, Iconia d’Acer, …). Par leur puissance multifonction, elles ont même relégué au second plan les liseuses (Kindle d’Amazon, Nook de Barnes & Noble, …) qui avaient fait l’affiche du précédent CES. Les contenus multimédias des tablettes laissent ainsi présager une augmentation dans l’utilisation de la bande passante de l’Internet déjà bien sollicité. Les fabricants de téléviseurs connectés, ou « Smart TV » (LG, Samsung, …) rivalisent pour offrir – Over The Top (1) – du contenu Web innovant et attractif. Sony par exemple a présenté Qriocity, un service de diffusion de films en streaming (flux continu) sur ses téléviseurs connectés Bravia. Cela promet là aussi des flux continus supplémentaires sur les réseaux, même si Apple TV a encore brillé par son absence à Las Vegas (2) et si Google TV a retardé la disponibilité de son offre. Les smartphones, eux, montent en puissance (microprocesseur « double cœur » chez Motorola et LG) et promettent d’être plus gourmant en capacités réseaux sur l’Internet mobile. A cela s’ajoute la maison qui se raccorde elle aussi au réseau des réseaux avec des appareils dits « intelligents » dans toutes les pièces (électroménager, surveillance, gestion d’énergies, robots ménagers, …). Bref, ça se bouscule au portillon. En 2010, dans le monde, il s’est vendu 260 millions de smartphones, 30 millions de TV connectées et 20 millions de tablettes. Après un crû CES 2011 encore exceptionnel en appareils en tout genre raccordables au Net, le risque de saturation des réseaux face à l’explosion du trafic devrait monter encore d’un cran. De quoi apporter de l’eau au moulin des opérateurs télécoms qui veulent instaurer plus de péages sur leurs infrastructures. @