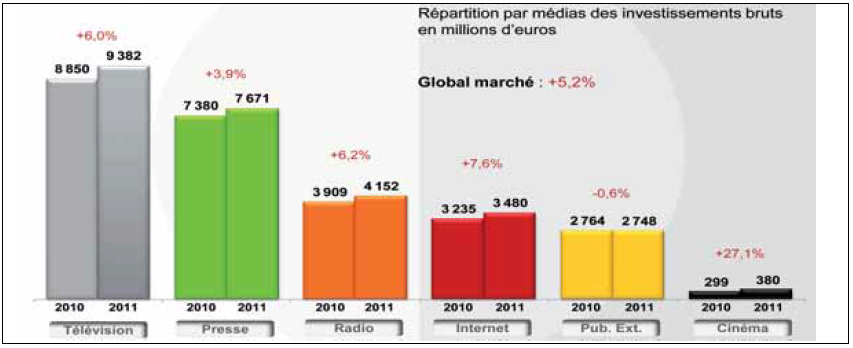En fait. Le 4 janvier, Le Parisien a augmenté son pris de vente à 1,05 euro (+ 4,8 % de hausse). Le 2 janvier, Libération est passé à 1,50 euro (+ 7,1 %). Le 3 janvier,
Le Figaro a procédé de même à 1,50 (+ 7,1 %) que Le Figaro et Le Monde appliquent depuis le 27 décembre 2010. La Tribune aussi.
En clair. C’est la fuite en avant. Pour assurer leur équilibre économique, lorsque ce n’est pas pour résorber leur déficit financier, les quotidiens nationaux français n’hésitent pas à augmenter une énième fois leur prix de vente au numéro. Qui aurait cru que son quotidien papier allait coûter près de « 10 francs » en kiosque ! Le journal payant serait-il devenu un produit de luxe face à l’info gratuite du Web ? « Pour assurer la meilleure qualité à l’information que nous vous proposons dans notre journal et sur nos supports numériques, nous devons assurer l’équilibre économique de notre entreprise. C’est la raison pour laquelle nous sommes amenés à augmenter le prix du Parisien », explique la direction du groupe Amaury en une du journal publié le 4 janvier. Ainsi, l’on comprend que le lecteur doit désormais remettre la main à la poche pour non seulement contribuer aux coûts de fabrication, de papier, d’impression et de diffusion – lesquels représentent jusqu’à 60 %
du prix de vente d’un quotidien –, mais aussi pour participer aux investissements Internet et mobile de leur journal. Et, qui plus est, même s’il se contente du papier… Déjà perçus comme trop chers par le public, et notamment les plus jeunes, les quotidiens prennent le risque tarifaire de ne pas enrayer l’érosion de leur diffusion papier – voire d’accroître le rythme de leur déclin. « L’information de qualité existe toujours, demeure plus que jamais nécessaire. Mais elle coûte cher à produire. A nous de faire en sorte, journalistes comme lecteurs, qu’elle ne devienne jamais un luxe », écrit en première page de l’édition du 2 janvier Nicolas Demorand, directeur de rédaction de Libération.
Malheureusement, elle l’est devenue. Résultat, selon une étude Lightspeed Research (1) parue le 13 décembre, ils sont seulement 11 % des sondés en France (2) à consulter l’actualité sur les journaux payants imprimés. Talonnée par Facebook consulté pour l’actualité par 6 % des sondés, auxquels s’ajoutent 1% de ceux préférant un autre réseau social et 1% ayant choisi Twitter, la presse écrite papier payante est ainsi délaissée au profit du Web et des 47 % consultant les sites d’information en ligne. La télévision (59 %), la radio (34 %) et les journaux gratuit papier (12 %) s’arrogeant le reste de l’audience d’actualités. Le pari du tout-Web pris par France Soir, et peutêtre bientôt par La Tribune, n’est pas perdu d’avance. @