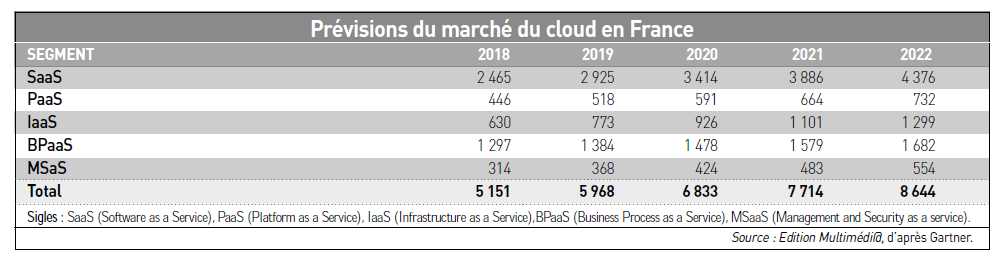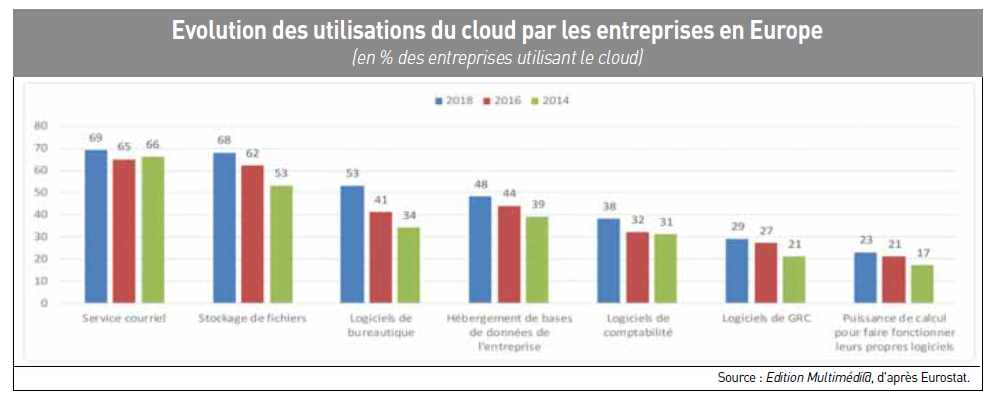L’institut de mesure d’audience Médiamétrie aura un nouveau président pour ses
35 ans. Bruno Chetaille avait fait savoir, dès fin 2017 à son conseil d’adminis-tration, qu’il souhaitait partir. La personne qui lui succèdera fin mars 2020 va être désignée
le 25 septembre prochain. C’est un poste hautement stratégique mais exposé.
 La troisième personne qui présidera Médiamétrie, après sa fondatrice Jacqueline Aglietta et son successeur Bruno Chetaille (photo), sera connue dans les prochains jours. « La décision sera prise lors du conseil d’administration de septembre. Le process suit son cours », indique à Edition Multimédi@ Raphaël de Andréis (1), président du comité de nomination de Médiamétrie, dont il est membre du conseil d’administration. Selon nos informations, cette réunion d’intronisation est fixée au 25 septembre. Bruno Chetaille avait signifié dès fin 2017 son souhait de partir. Afin de procéder au recrutement dans la plus grande sérénité et d’assurer le tuilage, la décision avait été prise en juin 2018 de prolonger le mandat de l’actuel PDG jusqu’à fin mars 2020.
La troisième personne qui présidera Médiamétrie, après sa fondatrice Jacqueline Aglietta et son successeur Bruno Chetaille (photo), sera connue dans les prochains jours. « La décision sera prise lors du conseil d’administration de septembre. Le process suit son cours », indique à Edition Multimédi@ Raphaël de Andréis (1), président du comité de nomination de Médiamétrie, dont il est membre du conseil d’administration. Selon nos informations, cette réunion d’intronisation est fixée au 25 septembre. Bruno Chetaille avait signifié dès fin 2017 son souhait de partir. Afin de procéder au recrutement dans la plus grande sérénité et d’assurer le tuilage, la décision avait été prise en juin 2018 de prolonger le mandat de l’actuel PDG jusqu’à fin mars 2020.
Les auditions des candidats se sont déroulées durant cet été devant le comité de nomination par délégation du conseil d’administration, au sein duquel siègent aussi Delphine Ernotte (présidente de France Télévisions), Nicolas de Tavernost (président
du directeur du groupe M6), Ara Aprikian (directeur général adjoint de TF1 chargé des contenus), Sibyle Veil (présidente de Radio France), Frank Lanoux (vice-président d’Altice Media) ou encore Jean-Luc Chetrit (directeur général de l’Union des marques).
Nomination scrutée par les clients et coactionnaires
C’est que tout le monde médiatique et publicitaire que compte la France surveille comme le lait sur le feu le processus de désignation du troisième président de cette entreprise,
dont les mesures d’audience sont aussi déterminantes pour les grilles des programmes
que sensibles pour l’économie publicitaire des chaînes de télévision, des stations de radio, des sites web et même des salles de cinéma.
Chez Médiamétrie, rien ne se fait sans l’aval et le consensus des professionnels des médias, des annonceurs et des agences, dont certains détiennent chacun une participation minoritaire du capital de l’entreprise : côté médias (65 % du capital), Radio France, Europe 1 (Lagardère), SFR Média (Altice), TF1, France Télévisions, l’Ina, Canal+ ou encore M6 ; côté publicité (35 %), l’Union des marques, DDB (Omnicom), Dentsu Aegis, Havas Media, Publicis ou encore FCB. Désigner la personne qui présidera aux destinées d’un Médiamétrie de plus en plus digital, data, global et international nécessite une grande précision, afin de trouver le mouton à cinq pattes capable de relever les défis qui se présenteront à lui. Au moins trois noms ont circulé : Yannick Carriou (PDG de Teknowlogy/ex-CXP, ancien d’Ipsos Connect), Sébastien Danet (président d’IPG Mediabrands France, ancien de Publicis Media) et Denis Delmas (président du Cnam Incubateur, ancien de TNS-Sofres et d’Havas). Convaincants ? Aucun commentaire chez Médiamétrie.
Après les fortes turbulences du « Fungate »
La personne retenue devra avoir les épaules solides pour assumer la lourde responsabilité de ce tiers de confiance médiatique très exposé. Bruno Chetaille, PDG de Médiamétrie depuis décembre 2006, en est à son quatrième mandat. Sur les treize années passées à la tête de cet institut de mesure d’audience, ce fut sans doute le plus difficile. L’affaire dit « Fungate » a été éprouvante. Fun Radio (RTL Group/M6) s’est rendue coupable en 2016 d’avoir gonflé ses mesures d’audience au détriment des ses concurrentes, un animateur ayant conseillé à ses auditeurs de mentir aux enquêteurs de Médiamétrie. NRJ (NRJ, Chérie, Nostalgie, Rire & Chansons), Lagardère (Europe 1, RFM, Virgin Radio), Skyrock, les Indés Radios (131 radios) et NextRadioTV (Altice Média) s’en sont plaints et ont fait faire une enquête au Centre d’étude des supports de publicité (CESP). En décembre 2016, ils ont déposé plainte devant la justice pour « concurrence déloyale ». Cependant, au cours des deux années suivantes, quatre des plaignants – sans que RTL Group ne les désigne dans son dernier rapport annuel où il fait le point sur cette affaire – ont mis un terme à leur action en justice.
Le reste de la procédure est suspendue en attendant le rapport de l’expertise judiciaire demandée par Fun Radio en décembre 2017 et accordée par la Cour d’appel de Versailles. Selon RTL Group, ce rapport d’expertise judiciaire portant sur les corrections effectuées par Médiamétrie sur les audiences de Fun Radio qui les conteste, était attendu pour « le deuxième trimestre 2019 »… pas de nouvelle. Mi-2016, Médiamétrie avait suspendu les résultats d’audience de Fun Radio, avant de les réintégrés mais en les corrigeant à la baisse du premier semestre 2016 au premier semestre 2017. L’institut a justifié ces correctifs sur un an pour prendre en compte « un effet halo ». Contestant la méthode de calcul aboutissant, selon elle, à de « très lourdes corrections » de son audience, la radio « dancefloor » de RTL Group avait alors engagé un bras de fer judiciaire avec l’institut en l’accusant de « traitement discriminatoire depuis plus d’un an ». L’issue de ce « Fungate » dépendra donc des conclusions de l’expert. Par ailleurs, le 5 août dernier, des radios privées comme NRJ, RFM, Skyrock ou encore Virgin Radio ont contesté les sondages de Médiamétrie… en Corse. Ironie de l’histoire, Bruno Chetaille quittera Médiamétrie après cette zone de turbulences, lui qui a pris la succession de Jacqueline Aglietta dans une période également agitée. A l’époque, au printemps 2006, les chaînes de télévision et des agences de publicité avaient vivement reproché à Médiamétrie son retard dans la mesure des nouvelles chaînes de la TNT et dans les nouvelles technologies. Ces critiques auraient précipité le départ de sa fondatrice. Sous l’ère « Chetaille », l’entreprise de mesure d’audience a modernisé ses méthodes de calcul, étendu ses compétences aux nouveaux médias et est passée de 43 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2005 à 102,7 millions en 2018. En janvier 2011, Médiamétrie publie les premières audiences TV intégrant le différé (2) grâce notamment à l’automatisation par watermarking. A partir d’octobre 2014, le fameux « Médiamat » (ex-Audimat) intègre le replay (catch up ou télé de rattrapage). Puis en janvier 2016, les résultats des chaînes cumulent les audiences en live (à l’antenne), en différé et en catch up TV (3). Depuis mars 2017, la durée d’écoute globale à domicile de la télévision comprend la consommation « 4 écrans » (téléviseur, ordinateur, tablette, smartphone), en live, en différé et en replay. La nouvelle génération d’audimètres est au format d’une tablette (appelée TVM3). « En 2020, la consommation hors du domicile sur un écran de TV (bar, gare, aéroport, lieux publics, etc.), mais aussi en vacances, en week-end ou encore dans la résidence secondaire, sera intégrée à la mesure de référence. Puis, elle intègrera aussi l’audience des programmes TV consommés sur les trois écrans Internet (ordinateur, tablette, smartphone) », indique Médiamétrie à Edition Multimédi@. Cette mesure hors domicile et plus individualisée est rendue possible grâce à un petit audimètre portable dont sont équipés 10.000 personnes constituant le panel.
Cependant, dans son audit annuel du Médiamat publié le 26 juillet dernier, le CESP recommande une meilleure prise en compte des plateformes OTT (4) telles que Netflix, et des nouveaux équipements comme les TV connectées, Apple TV ou encore Chromecast. Pour l’heure, Médiamétrie applique progressivement la mesure TV « 4 écrans » à certains OTT : depuis 2017 à Molotov et depuis 2018 à myCanal. Les services de SVOD Netflix et Amazon Prime Video devaient suivre. « Nous travaillons avec d’autres acteurs pour en étendre le périmètre », nous indique Médiamétrie, qui a déjà lancé en juin le « baromètre Netflix » des films et les séries les plus regardés sur ordinateur et mobile. Concernant la plateforme YouTube, elle est la première à intégrer la mesure Internet vidéo « 3 écrans », laquelle remplace depuis janvier la mesure vidéo Internet. La première publication de la mesure YouTube interviendra courant septembre.
Vers un standard commun de la data média
Côté radios, la mesure s’est faite jusque-là sur l’écoute directe sur poste de radio, autoradio, ordinateur, smartphone, baladeur ou encore tablette. Depuis cette année, le « Global audio » analyse désormais l’écoute de la radio, des web radios, des podcasts natifs, des plateformes de streaming musical ou encore des livres audios (5). Data, géolocalisation et programmatique se sont installés au coeur de la stratégie de Médiamétrie, qui, avec ses data scientists, a l’ambition de créer un standard commun de la data média en France. Une nouvelle ère s’ouvre. @
Charles de Laubier