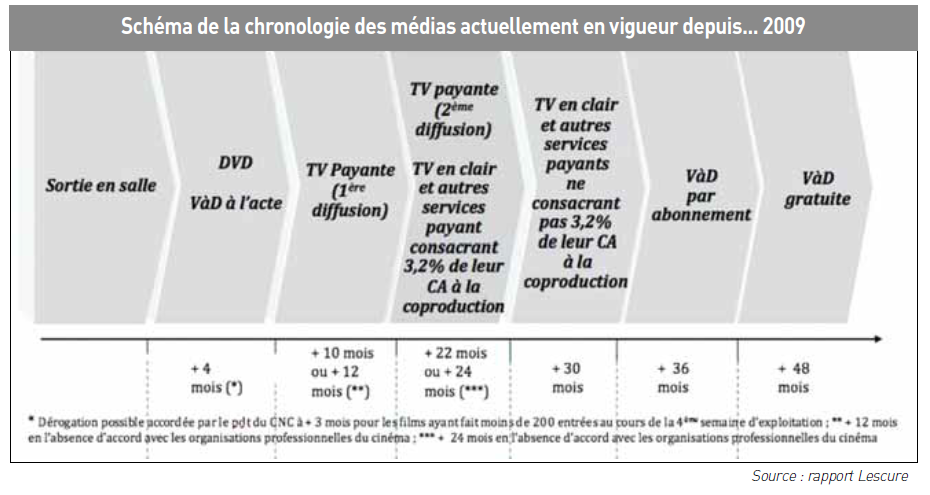Acheté il y a tout juste 10 ans pour 200.000 dollars, Facebook.com pèse aujourd’hui 212 milliards de dollars en Bourse. Grâce au « don » – gracieux –
que lui accordent ses 1,4 milliard d’« ami(e)s », le réseau social a empoché
12,46 milliards de dollars l’an dernier. Mais il y a un vrai « déséquilibre ».
 C’est en août 2005 que Mark Zuckerberg (photo)
C’est en août 2005 que Mark Zuckerberg (photo)
et ses coéquipiers ont acheté le nom de domaine
« facebook.com », qui fut créé huit ans auparavant
et qui remplacera « thefacebook.com » d’origine.
Dix ans plus tard, la firme de Palo Alto est un géant du
Net – le « F » de GAFA – avec 3 milliards de dollars de bénéfice net l’an dernier (1). Pourtant, le réseau social
– aux 1,4 milliard d’utilisateurs dans le monde – est gratuit mais il brasse des milliards grâce aux recettes publicitaires.
Déséquilibre flagrant en faveur de Facebook
Or chacun a fait « don » de ses données personnelles, sans contrepartie financière mais seulement en échange de l’utilisation gratuite de cet outil. Pour certains juristes,
il y a là un déséquilibre qui ne pourra pas durer. « Facebook déclare qu’il est propriétaire de l’ensemble des données – à la fois dans sa valorisation boursière et dans sa valorisation contractuelle. Il y a bien une monétarisation qui n’est plus basée sur le don mais bien sur l’échange de valeurs. Cette rupture entre cette logique du don est un système biface sur le plan économique : une face en don et une face en échange. Le système est en train de se déséquilibrer », affirme Alain Bensoussan, avocat et président de la société éponyme (2). Ardent défenseur de l’idée de propriété des données à caractère personnel, il dénonce ce déséquilibre et considère Facebook comme emblématique. « Il n’y a de capacité d’exister dans une démocratie que s’il y
a une propriété. Or, si quelqu’un fait de la valeur avec mes données, et surtout mes données évoluant dans le temps, cette valeur-là ne peut pas être asymétrique en droit. Il va bien falloir, à un moment donné, passer de la logique du don à la logique de l’échange », a-t-il plaidé le 19 novembre dernier, lors d’un séminaire au DigiWorld Summit de l’Idate. Or, fait-il remarquer, la propriété des données personnelles n’existe nulle part dans le monde, alors que tout le monde dit : « Ce sont mes données, mes informations ». Il y a un possessif énorme (« mes coordonnées », « mon nom », « mon adresse », « ma signature », …) et pourtant ce « droit naturel » n’existe pas. Pas plus qu’il existe de protections juridiques des données personnelles telles que les brevets pour les inventions ou de droit d’auteur pour les contenus. Mais il y a bien un débat qui commence 2008 avec le réseau social de Mark Zuckerberg : « Le premier à donner des droits universels [sur nos données personnelles] et à les reconnaître, c’est Facebook ! Les Etats dans le monde ne les ayant alors pas encore mis en place. Pourquoi Facebook fait-il cela ? Tout simplement pour créer de la confiance dans l’utilisateur, lequel pense qu’il a un droit de reprise – alors qu’il n’a aucun droit de reprise – et qu’il
a un droit d’accès – alors qu’il a faiblement des droits d’accès. Facebook a créé les éléments d’une création d’un “juris-système”, parce que ce droit-là est parfaitement opérationnel », a expliqué Alain Bensoussan. Les 1,4 milliard de personnes ont
accepté l’économie du don : « Je te donne mes données qui m’appartiennent et,
en contrepartie, tu me prêtes tes services ». L’économie numérique commence par cette économie du don, laquelle apparaît aujourd’hui asymétrique et déséquilibrée.
Or, l’avocat, fait remarquer que « dans le contrat mondial de Facebook, il y a un article 1 qui stipule : “Vous restez propriétaire de vos données et Facebook n’a qu’une licence gratuite et non exclusive” ». En conséquence : « En vous accordant une licence à vos données, Facebook reconnaît implicitement que vous êtes propriétaire d’une propriété qui n’existe pas légalement ! ». Google, YouTube, Twitter, LindedIn, Instagram et les autres réseaux sociaux ont copié à leur tour Facebook. Tous reconnaissent le droit universel de chacun d’entre nous à être propriétaire de ses données, sachant qu’il n’y aucun Etat régalien qui le reconnaisse encore… Certains disent qu’il est impossible d’être propriétaire des données personnelle parce que ce sont des éléments qui tiennent à la qualité de l’homme : un droit de la personnalité, oui ; un droit de propriété, non. On ne vend pas ses organes ; on ne peut pas vendre ses données.
Vers un droit à la maîtrise de ses données
Pour Alain Bensoussan, il y a là un paradoxe d’analyse : « Je défends l’idée que
l’on est chacun propriétaire de ses données à caractère personnel, et que les droits naturels naissent avant les droits légaux. C’est un problème de droits de l’homme numérique ». La question est posée, même si le Conseil d’Etat – dans son rapport
« Le numérique et les droits fondamentaux » de septembre 2014 – recommande de
ne pas aller vers le droit à la propriété des données personnelles, lui préférant « un droit à l’autodétermination » (3). Or cela pourrait être un premier pas vers l’extension
de la propriété – consacrée en 1789 – aux données personnelles. Ce serait alors une révolution ! @
Charles de Laubier